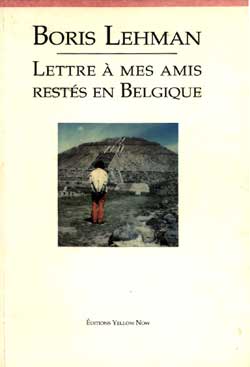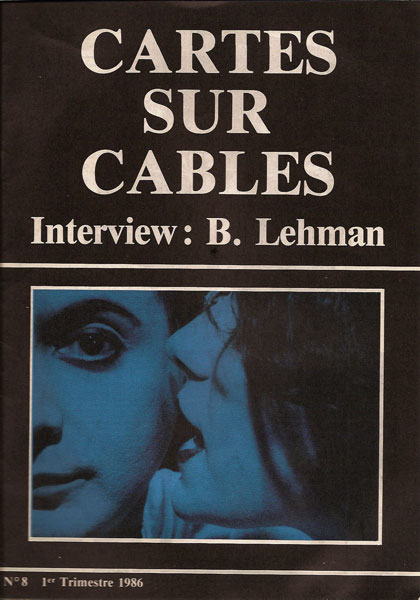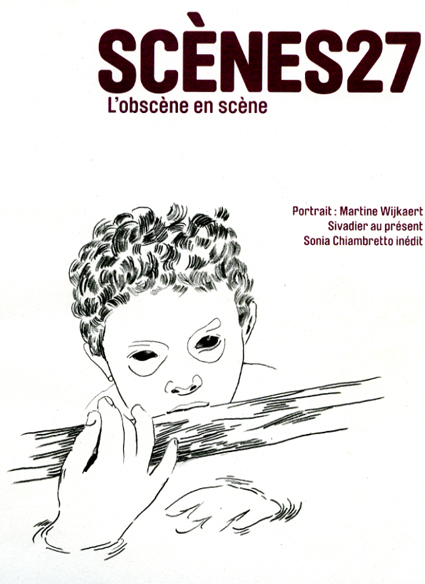|
|
|
PRESSE |
|
 1. Lac Lehman Belgique (Dominique Marchais/ Les Inrockuptibles,1997)
Dominique Marchais (les Inrockuptibles)
Rétrospective Boris Lehman à la galerie nationale du Jeu de Paume, du 22 mars au 6 avril 1997, place de la ConcordeLE CAS LEHMAN L'historien du cinéma belge Francis BoIen exprimait en ces termes tout le maI qu'il pensait des classifications linguistiques dans le domaine qui l'occupait .«Pour nous, il n’y a que des films belges, c'est-à-dire des films reflétant la position culturelle d'un pays d'entre-deux». Nonobstant la récente conversion du cinéma belge au prêt-à-filmer international, force est de constater que sa veine la plus authentique s'incarne chez les petits façonniers qui cultivent précisément cet entre-deux. Boris Lehman est sans doute l'exemple le plus radical de ces cinéastes éminemment belges qui n'aiment rien tant que contrevenir aux critères dominants de reconnaissance nationale ou esthétique. D'abord parce que Lehman, d'origine juive, est né en Suisse (en 1944), ensuite parce qu'il pratique un cinéma - pour le réduire à sa forme maîtresse - de l'autoportrait et de l'exploration intime qui connaît moins les faveurs de la distribution classique que celle des circuits parallèles ou institutionnels (le Musée du Jeu de Paume, à Paris, lui a consacré une vaste rétrospective au printemps 1997). L'oeuvre, profuse, inquantifiable et en même temps d'une rigoureuse cohérence, est inaugurée en 1963 et principalement marquée par la recherche de l'amour défini comme alchimie ésotérique et douloureuse (Couple, regard, positions, 1983), la métaphysique douce-amère d'un poisson ritualisé (Muet comme une carpe, 1987), la variation mégalomaniaque sur le thème du Golem ( L’Homme de terre, 1989), ou Ia quête des origines (À la recherche du lieu de ma naissance, 1990). Mais l'épine dorsale de cette oeuvre est un projet confusément titanesque répondant au nom de Babel. Conçu en 1979 comme une tétralogie devant durer vingt-quatre heures, il est censé embrasser tous les genres cinématographiques et relater, naturellement, la vie quotidienne d'un cinéaste qui prépare un film sur Babel. Les premiers épisodes de ce work-in-progress, intitulés Lettre à mes amis restés en Belgique (1986-1992), compose un des plus beaux portraits de Lehman tel qu'en lui-même il se filme, mais également des centaines d'hommes et de femmes qui y figurent à titres divers, et par la même occasion de Bruxelles. Sous la mise en jeu narcissique et la provocation paranoïaque, quelque chose comme une préoccupation et un amour aigus du réel et d'autrui apparaît . Ainsi que le remarque subtilement Dominique Noguez dans sa présentation du dernier film en date du cinéaste - Mes entretiens filmés (1996), où il convie des amis critiques à parler de son cinéma - «on ne fait jamais ce qu'on croit, on fait même parfois le contraire. Boris Lehman croit faire un cinéma en première personne mais peut-être qu'il a en réalité entrepris le meilleur cinéma en deuxième personne de ces trente dernières années».
Jacques Mandelbaum (Le Monde)
On ne peut plus guère parler aujourd'hui de "documentaire" à propos des films de Boris Lehman, tant il s'est ingénié depuis des années à brouiller toutes les pistes, mélangeant à loisir tous les genres, les formats et les durées, façonnant de plus en plus un genre unique, multiforme qui englobe toutes ses images, leur donnant une aura singulière, davantage cosmique et philosophique que purement cinématographique. Avant, il était clair que des films comme Le Centre et la Classe, Ne pas stagner, Magnum Begynasium Bruxellense relevaient du genre documentaire, même si Boris tirait ses films vers la fiction et vers la poésie. On appela cela tantôt documentaire-fiction, tantôt fiction documentée, point de vue de l'auteur sur la réalité, ou le «réel», Boris se situait pleinement dans la lignée des films de Flaherty, Rouch, Eustache ou Pelechian. Simplicité et pauvreté dans la prise de vue en direct, modernité de l'écriture, montage structurant et signifiant. Mais avec les années, l 'oeuvre a pris un autre tournant, plus autobiographique. Boris est devenu la matière même de ses films et, sous des formes diverses, ses films sont devenus des entretiens, des confidences, des portraits et autoportraits, des esquisses, notes et fragments de journaux intimes. Un cinéma de quête, on ne peut plus initiatique. Depuis 5 ans au moins, depuis Leçon de vie qu'il a considéré comme son testament cinématographique, Boris a tourné sans relâche des kilomètres de pellicules, sans argent, sans subsides, sans production véritable, mais dans la liberté totale du poète. II conviendrait donc peut-être de désigner ces matériaux comme des archives personnalisées ou des souvenirs inachevés. Le cinéaste se refuse aujourd'hui à fabriquer des films (il en a réalisé plus de 150) que l'on produit et consomme en salle ou en cassette. Boris est devenu l 'artisan de ses propres oeuvres. À la fois producteur, réalisateur et acteur, il est aussi le montreur et le projectionniste de ses films, qu'il porte toujours avec lui et accompagne où il se présente, suscitant les rencontres et les échanges avec les spectateurs. Il ne faut pas oublier qu'une de ses expériences importantes fut la réalisation de films avec des malades mentaux, au sein du Club Antonin Artaud, à Bruxelles. Pendant 18 ans, il a animé des groupes de personnes en difficulté, avec le cinéma comme moyen d'expression thérapeutique", et ce travail de constante attention avec des non-professionnels, il l'a poursuivi plus tard dans son propre cinéma, ne faisant jamais appel à des comédiens, mais demandant toujours à ses amis de jouer en quelque sorte leur propre rôle à l'écran. Mais Boris ne se contente jamais de faire un simple portrait de ses amis, il les inscrit dans sa vision du monde qui donne chaque fois une dimension inattendue, poétique, magique. Cette attention à l'autre l'a amené souvent à collaborer avec d'autres, tels, John Cage, Roman Opalka, Christian Boltanski, Arié Mandelbaum, Paulus Brun, Raoul Ruiz… sans qu'il en fasse pour autant des "films sur l'art" mais plutôt pour s' interroger sur la question de la création et de l'identité. Babel résume sans doute le mieux toute son œuvre poétique: "Ma vie est devenue le scénario d'un film qui lui-même est devenu ma vie". Journal filmé et reconstitué (Boris est le personnage central, visible à l'écran), œuvre gigantesque dont un seul volet sur les quatre prévus (Lettre à mes amis restés en Belgique, qui dure à lui seul plus de six heures) est terminé, Babel fait le portrait du cinéaste tel qu'en lui-même il vit ses journées et sa vie, nomade en déambulation permanente dans sa propre ville, en quête de voyage et d'amitié. Ici le "grand voyage" (qu'on ne voit presque pas) se situe chez les Indiens Tarahumaras, dans le nord du Mexique, sur les traces du poète Antonin Artaud. Le film déroule le temps comme une tapisserie au rythme de la marche et de la respiration, s'attardant tantôt sur les problèmes de santé (visite chez le médecin, visite chez la dentiste) tantôt sur les problèmes du pays (travaux de démolition, manifestations, élections, vie et mort de la Belgique), disséquant toutes sortes d'événements sur son passage, en rapport bien sûr avec les préparatifs et les hésitations du voyage, traquant le détail et l'anodin, composant ainsi, à force de collages, d'analogies, de citations, de lieux, de personnages et d'histoires une sorte d'almanach et une véritable encyclopédie des gestes et comportements. En cela bien sûr, l'oeuvre de Boris Lehman est foisonnante, vibrante et rayonnante de vie. Boris ne cache rien, ni sa calvitie, ni ses maladresses, ni le processus même de la fabrication de son film, qui semble se dérouler au présent à chaque projection. Cinéma de l'intimité, Babel doit être aussi considéré, à juste titre, comme une oeuvre hautement expérimentale, en ce qu'elle apparaît aussi comme fiction romanesque, romantique ou mélodramatique, et en ce qu'elle donne immédiatement à tout un chacun d'en faire autant... Sa méthode de tournage est des plus simples: tournage rapide, en 16 mm, toujours sur pied, avec son direct, en décor naturel et lumière ambiante, avec juste un éclairage d'appoint, une équipe de deux ou trois personnes au maximum, pouvant se déplacer vite à l'intérieur d'une seule voiture. Pas de scénario ni de plan de travail, encore moins de découpage ou de storyboard. Les choses s'improvisent, se filment au fur et à mesure, dans la chronologie. Le film se scénarise et se monte au moment du tournage. Chaque séquence forme une pièce du grand puzzle... Pas de temps, dans ces conditions, pour la recherche esthétique gratuite, pas d'argent non plus pour des effets inutiles. Retour au cinéma des premiers temps où tout s'inventait au fur et à mesure des idées, des désirs, des moyens et des besoins. Maintenant, si on s'en tenait strictement à une définition communément admise de ce que pourrait ou devrait être le film documentaire, Boris Lehman en aurait réalisé des dizaines, dont quelques chefs-d'œuvre incontestables: Magnum Begynasium Bruxellense, À la recherche du lieu de ma naissance, Muet comme une carpe. Cependant, si on réfléchit un peu à quelques scènes clés de films comme Couple, Regards, Positions, I'Homme de Terre ou Leçon de vie (peler une pomme avec des ongles, mordre une joue, embrasser ou décapiter une statue), on doit reconnaître qu'elles sont d'essence essentiellement documentaire. Qu'il filme un accouchement ou une circoncision, un enfant jouant avec un poisson dans une baignoire, un drapeau en berne ou un train entrant dans une gare, Boris nous entraîne à regarder sans préjugés et sans conditionnement, comme si nous regardions pour la première fois les choses au temps du paradis (un thème cher à lui). Ses films sont des leçons de regard, et, dans le meilleur sens du terme, comme Proust et Montaigne l'entendaient, et peut-être Godard dans ses Histoire(s) du Cinéma, des essais.
Daniel Fano
Le dictionnaire du documentaire 1999 LES FICTIONS INTIMES DE BORIS LEHMAN Boris Lehman ne fait pas de films: il n'arrête pas de filmer. Il a réalisé, produit et diffusé, à ce jour, environ deux cent cinquante films de façon artisanale, principalement en 8 et 16 mm. Courts, longs, documentaires, fictions, essais, expérimentations, autobiographies, journaux sont les étiquettes qu'on leur colle aléatoirement et qui ne sauraient rendre compte d'une pratique cinématographique hors-normes. «Tout tient du journal filmé, c'est-à-dire de notes qu'on écrit, qu'on filme au jour le jour, des petits morceaux, de façon chronologique. A un moment, on peut les rassembler, les monter, les sonoriser. Et ça devient malgré soi un film ou plutôt un projet de film, un film en devenir, un film infini que l'on peut toujours continuer.» Parmi les rares projections publiques de ses films, celle de Histoire de ma vie racontée par mes photographies (2000) au Forum des images le 2 décembre est celle d'une copie de travail au montage provisoire. «Si je montre des morceaux inachevés, des work-in-progress, c'est parce que ce sont des projections de travail qui me permettent d'éclaircir les choses, de ne pas les fixer, les figer trop vite. C'est le produit-film qui veut que les choses soient terminées trop vite. Jonas Mekas parle de tout ce temps qu'il faut pour voir ses propres images avec distance et recul, pour avoir le temps de les oublier et de les retrouver. Je procède de la même manière car le temps est incompressible.» «Ma vie est devenue le scénario d'un film qui lui-même est devenu ma vie».
Pour terminer Babel/Lettes à mes amis restés en Belgique (1991), son film-fleuve (380 min), Boris Lehman aura mis dix ans. «Babel, c'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais déprimé. Je ne savais pas très bien quoi faire. Je voulais aller au Mexique, faire le voyage d'Antonin Artaud chez les Indiens. J'ai commencé à filmer ma vie quotidienne, les préparatifs du voyage et c'est le fait de filmer qui m'a décidé, obligé à faire le voyage.» Une phrase placée en exergue de Babel illustre à merveille le rapport fusionnel qu'entretient Boris Lehman avec son cinéma: «Ma vie est devenue le scénario d'un film qui lui-même est devenu ma vie.» «Je ne fabrique pas un produit-film» explique-t-il. «Ce que je fais n'a aucune intention, aucune préméditation. Je ne sais pas expliquer à mes collaborateurs ce que je fais, je ne le sais pas encore moi-même. On ne peut que m'accompagner, que me faire confiance, tenter l'aventure avec moi. C'est comme si on explorait une terre inconnue. Je ne peux pas expliquer où on va. Bien sûr, la conscience du film vient au fur et à mesure qu'on filme. Ça part d'une vision personnelle. Je filme ce que j'ai devant moi. Mes collaborateurs (une équipe technique minimale) doivent être une espèce d'excroissance de moi-même, c'est un seul corps multiplié par deux ou trois. Car s'ils n'entrent pas un peu dans ma vie, dans ma façon de vivre, c'est très difficile. Ce n'est pas difficile techniquement (on est dans l'élémentaire) mais je ne peux pas entrer chez n'importe qui avec n'importe qui. Comme la caméra est aussi une excroissance de moi-même, qui sort de mon œil, de mon ventre, je suis toujours près des gens. C'est quelque chose de tactile, je ne peux pas tourner au téléobjectif. Comme je suis souvent avec mes amis, je filme mes amis. Lorsqu'on mange, je filme ce qu'on mange. Si on se balade dans le parc, je filme la balade dans le parc. C'est pourquoi dans ce genre de cinéma, on filme beaucoup de choses qui sont évacuées dans l'autre cinéma. Les temps morts, les petites choses de la vie quotidienne. Il y a évidemment un lien entre ce cinéma et le cinéma d'amateurs ainsi que celui des origines. Les pionniers, ceux qui inventaient le cinéma, faisaient le cinéma en l'inventant. Il n'y avait pas d'esthétique préalable, il n'y avait pas de style ou de grammaire. J'en suis toujours là même si on n'est pas complètement vierge.»
Des films sans argent. Si le montage de Histoire de ma vie racontée par mes photographies n'est pas tout à fait terminé, c'est aussi, parmi d'autres raisons, à cause de problèmes financiers. C'est à ce stade là que Boris Lehman doit trouver le plus d'argent puisqu'au moment du tournage il ne dépense presque rien, fonctionnant de manière autonome avec son propre matériel. «La plupart des cinéastes se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent. Je n'en ai pas, sûrement moins que ceux qui se plaignent. Je n'ai pas de revendications à faire, je n'ai pas non plus de justifications à formuler. Je fais le cinéma que je peux faire avec les moyens que je trouve. Mon cinéma n'est pas fait avec de l'argent. Il est fait avec des amis. C'est un langage que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. «Où est-ce qu'il trouve l'argent?» se demandent-ils. Je fais des films sans argent même si cela leur semble impossible, voire impensable. Je ne fais pas partie du système et je ne veux pas être pris en sandwich entre Claude Lelouch et Claude Chabrol. Je ne fais pas partie de cette famille-là. Je fais aussi du cinéma pour ne pas être seul et il me sert à vivre, à me faire rencontrer des gens. La caméra est aussi un médium, un objet qui est entre des personnes et établit un lien entre elles. Chez Chabrol, la caméra sert à raconter une histoire, à diriger des acteurs. Ça n'a pas ce côté thérapeutique, existentiel. Pourtant, une fois projeté, un film ressemble à un autre film. Je dis que je ne fais pas de films, Mekas le dit aussi, mais quand c'est projeté à la Cinémathèque, c'est un film. Exactement comme Chabrol. Il y a une différence de style, de contenu mais c'est la même chose. Il y a des images, des sons, des mouvements de caméra, de la lumière. C 'est pareil, c'est du cinéma. Je suis contre ces catégories: petits films, grands films, cinéma expérimental, marginal. Faire des films, c'est aussi faire partager une expérience, transmettre quelque chose et donner envie à d'autres de faire des films. C'est pour ça que j'ai évacué la notion de genre ou de catégorie et aussi de jugement. C'est comme la politique des auteurs qui n'a plus la même signification aujourd'hui que dans les années 60. La notion d'auteurs a été récuperée, y compris par Hollywood puisque c'est intéressant économiquement parlant. Avant, ce n'était peut-être pas intéressant de dire un film de Howard Hawks. Il suffisait de dire un film de John Wayne.» Eloge de la marche. Qu'il retourne à Lausanne dans A la recherche du lieu de ma naissance (1990), qu'il déambule dans Bruxelles ou s'envole au Mexique dans Babel ou qu'il parte à Moscou, Boris Lehman arpente le monde, casquette sur la tête, sacoche sur l'épaule et appareil autour du cou. «Comme dans le cas de Serge Daney et de quelques autres, la marche est fondamentale pour moi. Ce n'est pas le mode de circulation, de transport normal. Un cinéaste a plutôt une voiture (Wim Wenders). La marche est plutôt du côté de l'écrivain, de l'écrivain-vagabond, d'un certain type d'écrivain (Jean-Jacques Rousseau). C'est vrai que j'ai ce rythme-là, ce regard-là. Le regard d'un piéton n'est pas le même que le regard d'un automobiliste. C'est évidemment plus lent. On a le temps de rencontrer des gens au coin de la rue, de s'arrêter, de regarder. C'est mon rythme: terrasses de cafés, librairies, appartements. On a beaucoup parlé du cinéma de l'errance (Wenders, Chantal Akerman) qui était un cinéma des trajets filmés (les trains, les voitures). Chez moi ce sont plutôt des petits sauts, d'une personne à une autre. Les trajets sont là mais concrètement ils ne sont pas souvent filmés. Je suis partout chez moi. Mais ce n'est pas juste une idée, c'est une réalité. Cela découle de mon état de nomade, d'errant, de Juif errant. Je ne fais que passer, je ne m'installe jamais quelque part. Je suis aussi un peu le messager. Je prends des nouvelles et je les rapporte. Avec ma caméra.»
Propos recueillis par Nicolas Azalbert le 30 octobre 2000 à Paris
BORIS LEHMAN N'EXISTE PAS Quiconque a accompagné Boris Lehman au fil des années s'est toujours trouvé sur une ligne de partage. Quel cinéaste plus encombré que lui par lui-même - et tantôt plongeant en son être pour en extraire on ne sait quelle vérité, tantôt s'affichant dans son paraître pour se lamenter d'être méconnu. Se rend-il muet comme une carpe, va-t-il surprendre quelque artiste dans son atelier, se fait-il homme de terre que le moindre orage fera fondre comme neige, c'est pour revenir au partage entre l'être et le paraître. Et tantôt on ne peut que maudire cette obstination à déclasser «Je suis», cet égocentrisme ravageur et têtu, et s'émouvoir simultanément que ce «Je suis» est toujours un «Je parais» qui s'étonne à la fois de sa consistance intérieure et de son inconsistance matérielle. Or le cinéma, par sa donnée matérielle même, est l'inconsistance. Images fugaces enroulées dans une bande de celluloïd et qui sur un écran de ridicule apparence donne l'illusion d'un espace tridimensionnel. Dans A la recherche du lieu de ma naissance, dans la vanité même de la rétrospection, dans les reculons à long cours, Boris Lehman soudain perplexe se dépossède enfin de sa problématique. On a vu certains auteurs substituer l'un à l'autre pour un même personnage deux acteurs. Bonaparte Barrault restitue à Sacha Guitry l'empire de Napoléon. Le professeur Taranne de Raul Ruiz se mystifie en divers visages et voix. Mais Boris Lehman s'escamote au fur et à mesure et s'irréalise en un jeune gamin à la moue boudeuse, inscrit dans un ventre anonyme son destin embryonnaire, et s'invente, au gré de son regard, les visages incertains d'une mère. Certes il récapitule avec minutie ses étapes personnelles: le passé juif de ses parents, les hasards helvétiques de sa naissance, les images de ce temps de bottes et de massacres, mais ces étapes lui échappent. Et la déconvenue finale est finalement burlesque, mais extrêmement émouvante. Comme ailleurs Gertrude Stein, il s'avère que chaque autobiographie est finalement l'autobiographie de tout le monde, que la représentation que chacun fait de soi-même est une fiction, bref que Boris Lehman n'existe pas. Et le plaisir du spectateur tient à cela, c'est que lui-même est comme sommé de replonger vers son enfance, de remonter à l'origine, tout en savourant le parcours indécis que fait de lieu en lieu Boris Lehman, de retrouver enfin la preuve joyeuse de sa propre inexistence. Je, d'évidence, est un autre. Boris Lehman fait du cinéma comme personne d'autre. Chacun de ses films dit zut à l'ensemble de la production cinématographique régnante et ouvre aussitôt une voie inédite. Le plus curieux, c'est que le cinéma, de temps à autre, le rattrape, confirmant ainsi qu'il est non seulement un innovateur, mais un pionnier au sens propre. Comme l'était Chaplin, l'un de ses dieux, quand il inventait, lui, le septième art, tout simplement. La fausse avant-garde n'est jamais qu'épigonale par rapport à des tentatives dont elle se contente de singer les apparentes facilités. La vraie, c'est celle qui part dans l'inconnu, sans biscuits, et en revient avec des images improbables. Toutes les expériences de Lehman donnent ce sentiment. Et, du coup, traversent hardiment les années, au point de nous devenir familières. Comme ces films de Greenaway qui déconcertaient tant au début, et qui maintenant font partie de notre paysage, ou ces textes de Handke qui semblaient tellement en rupture et qui aujourd'hui nous trahissent mieux que tout ce qui paraissait alors.
Jacques de Decker (Le Soir)
CONVERSATION AVEC UN CINÉASTE Une rencontre cinéma-psychanalyse. Q.: Boris Lehman, la rencontre de la psychanalyse et du cinéma n'est pas une chose des plus fréquentes. B. L.: On constate une certaine méfiance des psychanalystes à l'égard du cinéma, ce qui n'est pas le cas pour d'autres domaines artistiques, comme la peinture, la littérature ou le théâtre. Sans doute est-ce dû à ce que le cinéma est un art trop nouveau, trop jeune, souvent masqué par ses aspects «industrie» et «divertissement populaire». Les psychanalystes ne veulent pas le prendre au sérieux. Le cinéma a cependant beaucoup à voir avec la psychanalyse. Un film peut être la mise en scène de fantasmes, il peut agir comme un miroir révélateur, il met en jeu des processus d'identification, de régression, de sublimation, de transfert, etc., parce que les cinéastes parlent de leur désir et de leurs manques. Le cinéma travaille sur l'imaginaire et le symbolique, c'est une machine à fabriquer des rêves, disait Cocteau. Q.: Qu'entends-tu par «imaginaire» et «symbolique» au cinéma? A ces deux termes Lacan en ajoute un troisième, le réel. Que penses-tu de cette dernière catégorie au cinéma? B.L.: On dit souvent que je fais des films documentaires, que je «capte» le réel. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus. D'abord, le réel, la vérité, ça ne se capte pas comme ça. Il y a eu au début des années 60 un mouvement lié à l'apparition des caméras légères insonorisées et des enregistreurs portatifs synchrones qu'on a appelé «cinéma-vérité». Jean Rouch notamment, ethnologue, croyait qu'en enregistrant en direct la parole et les images de l'autre, il obtiendrait sa vérité. Mais la vérité ne vient pas comme ça, parce qu'on a mis un micro devant la bouche des gens, c'est plus compliqué que ça, c'est comme la folie, ça ne se voit pas, c'est dans la tête des gens, c'est à l'intérieur. Il y a des cinéastes qui partent loin, en Afrique ou au Japon, parce qu'ils veulent trouver des images extraordinaires. Mais les paysages ici ou là-bas, c'est pareil. Seulement si vous regardez la peinture d'un paysage faite par un belge, un africain ou un japonais, là c'est très différent. C'est l'imaginaire des gens qui est différent, non le sujet. Prenez la pluie. Filmée par Lelouch, par Oshima, Bresson ou Tarkowski, ce sera très différent. C'est pourtant chaque fois le même sujet, parfois la même image. Un film n'est jamais la reproduction du réel, ni son double. Il n'en est qu'une représentation, qu'une image. Q.: Il y aurait donc dans une image ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on ne voit pas, un hors-champ? B.L.: Le hors-champ, oui. Il faut croire que cette question m'obsède depuis très longtemps, puisqu'en 1963 déjà, je réalisais un film intitulé La Clé du Champ qui était l'histoire d'un type qui, désirant rejoindre une femme de rêve, n'arrivait pas à sortir du champ de la caméra. Dans un film, il y a tout ce qui se passe devant la caméra, dans le champ, ce qu'on voit finalement sur l'écran, et il y a aussi tout ce qui se passe derrière. Et le film est finalement le rapport entre les deux. La caméra sert de médium. Or, le cinéma courant, narratif, industriel, commercial, a pour but d'effacer tout ce qu'il y a derrière, afin qu'on s'identifie seulement à ce qui est montré. Mais dans un autre cinéma, celui de Godard par exemple, on dévoile le côté fabrication de l'œuvre, sa difficulté de création et de fonctionnement, on met en évidence ces aspects généralement occultés dans les films traditionnels. En quelque sorte, on montre le hors-champ comme faisant partie intégrante de l'œuvre. Par exemple, dans mon film Symphonie, on voit à deux reprises l'équipe filmant le personnage principal (Romain, seul interprète du film, sensé être seul). J'insiste par là sur le fait que Romain ne parle pas seul, mais qu'il est en face de gens qui l'écoutent et l'enregistrent, c'est-à-dire déjà des spectateurs-voyeurs. C'est la caméra et le filmage qui engendrent en quelque sorte le discours-monologue de Romain qui, sans cela, n'existerait pas. Q : Ce que tu dis là n’est pas sans rejoindre la visée de la cure analytique du point de vue lacanien, qui précisément n'est pas de l'ordre de l'identification. Peux-tu définir, quant à toi, ce que tu cherches dans ta démarche cinématographique par ce refus de la facilité de l'identification? B.L.: Si je savais ce que je cherche, je ne le chercherais déjà plus. On dit souvent de moi que je ne sais pas ce que je veux. Ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas de message à délivrer, je n'ai pas de discours tout fait. Le sens de mes films apparaît toujours à la fin, parfois même malgré moi. Evidemment, j'ai un savoir, des a priori, je suis des pistes, des intuitions. On ne fait rien innocemment. Un cinéma qui montre: Q.: Tu travailles volontiers sur toi. On a qualifié ton cinéma d'autobiographique. B.L.: Je dirais plutôt que je fais du cinéma «thérapeutique». Cela est fortement lié probablement à mes expériences cinématographiques au Club Antonin Artaud, mais aussi à la manière dont j'utilise le cinéma, en marge et parfois même à l'encontre du système où le film est conçu davantage comme un produit de consommation. Là, on se contente généralement de «mettre en boîte» un scénario. Ça peut faire un bon ou un mauvais film, là n'est pas la question. Mais là, pas question de hors-champ. La mère du réalisateur peut mourir pendant les prises de vues, le contenu du film n'en sera pas modifié. Dans le cinéma que je pratique, je me mets en scène (même si je n'apparais pas nécessairement dans l'image), je cherche une image de moi-même. Cela me donne parfois des surprises, bien entendu, je suis parfois étonné de révéler des aspects intimes ou négatifs de moi-même, que je ne voulais pas montrer. C'est ce qui m'a amené plus récemment à jouer dans mes films, parce que j'avais là l'image-même de mon propre corps, que je voulais mettre à l'épreuve. On a appelé ça ma phase «narcissique». Qu'est-ce que je filme? Et bien, dans Babel, par exemple, qui est un film-autoportrait en forme de journal intime plus ou moins reconstitué, je filme des «moments» de ma vie. Ce sont des moments évidemment uniques, il n'est pas question de recommencer, comme dans un cinéma de fiction, où on peut répéter la scène autant de fois qu'on le désire. Ici, les moments cinématographiques sont liés à des morceaux de ma vie, et c'est une entreprise impossible, parce qu'on ne peut pas vivre et en même temps filmer, alors je dois adapter ma vie au film, et vice-versa, ce qui rend tout très compliqué, et ne peut durer très longtemps. Dans ces mises en situation (plutôt que des mises en scène), je trouve des signes de moi-même dans les choses et les gens qui m'entourent. C'est ça qui fait mon discours, mon sujet. Je cueille ces éléments, pour les travailler, les structurer ensuite au montage. À propos de mon film Album 1 (qui est construit sur l'idée de «je filme et je suis filmé» c'est-à-dire l'alternance de plans des autres filmés par moi et de plans de moi filmés par les autres), Trinon disait que c'était plus moi quand on ne me voyait pas dans l'image. Et c'est vrai: quand je filme une tasse de café, je filme vraiment mon rapport à l'autre, et cette tasse de café c'est moi, c'est le résultat de mon regard. Q.: Ce que tu fais, c'est te montrer et inviter les autres à se montrer. B.L.: Oui, et ça me pose chaque fois un problème moral, éthique. Exactement comme pour le cinéaste documentariste, parce que comme lui, je travaille avec des personnes qui «jouent leur propre rôle». Ce ne sont pas des acteurs interprétant des personnages autres qu'eux-mêmes. Alors je dois me demander tout le temps: qu'est-ce que je peux montrer, jusqu'où je peux aller, me dévoiler, me servir des autres pour parler de moi, etc.? Couple, Regards, Positions est d'abord un film sur mes rapports avec Nadine, sur le couple que nous étions alors. Nous sommes partis de faits autobiographiques, mais nous les avons théâtralisés en une série de «tableaux vivants» composés en studio, sans décor, sur fond noir. Il y a par exemple une scène où je m'arrache les cils et une autre où elle s'arrache la peau d'un doigt, jusqu'à ce que le sang vienne. Castration et automutilation, si l'on veut. Le film est tout entier construit sur un mode symbolique, il n'y a pour ainsi dire aucun référent réel (exceptées, dans une séquence qui nous rassemble, deux photos de nous enfants). Place du manque: Q.: J'ai l'impression qu'il y a deux directions dans tes réponses: d'une part, il y a ce qui va dans le sens de ce que tu veux montrer, et même de ce que tu découvres, ignorant ce qui allait se montrer, et d'autre part, tu parles de tout ce qui t'échappe, et qui est quand même là. B.L.: Ce qui apparaît sur l'écran n'est presque jamais ce que j'avais imaginé. Le film m'échappe et me piège. Mais je l'assume, du moins partiellement. J'ai encore le pouvoir de manipuler, de censurer mes images au montage, de choisir ce que je montre et ce que je ne montre pas. Il y a donc un va-et-vient entre une certaine audace et une certaine timidité, de toute façon une impossibilité de montrer ce qu'on avait eu comme projet de montrer. Cette chose n'est jamais satisfaisante, elle n'est jamais épuisée. Mes films sont toujours incomplets. C'est la raison pour laquelle il faut chaque fois recommencer un autre film pour essayer d'y mettre ce qui n'a pu l'être dans les précédents. Q.: Tes films sont incomplets, dis-tu. Il leur manque quelque chose. Il y a donc cette dimension de l'inachèvement. B.L.: C'est lié à l'insatisfaction de l'artiste pour son œuvre une fois achevée. On ne peut jamais mettre tout dans l'œuvre. Et il faut toujours recommencer. C'est ce qui pousse des cinéastes comme Godard, Fassbinder ou Ruiz, qui tournent beaucoup et vite, à ne jamais s'arrêter. C'est ce qui poussait Léonard de Vinci à continuer toute sa vie le portrait de la Joconde. Ou Kafka ou Welles à ne jamais terminer, l'un ses romans, l'autre ses films. C'est un problème de création. Pour Babel, avec lequel je suis occupé depuis trois ans, j'ai accumulé jusqu'à présent cinquante heures d'images et de sons, que je n'ai pas encore montés ni structurés. J'ai un problème, celui d'en finir, de le terminer. C'est probablement une peur de figer le sens, de figer l'image de moi-même. Q.: Ça évidemment, c'est ce qui, pour nous, rejoindrait l'inconscient. C'est ça qui fait le moteur de tes films, cette chose qui n'est pas épuisée. Peux-tu nous en dire plus sur ce processus? B.L.: Ce qui m'intéresse sans doute, c'est d'en savoir plus sur moi-même. En faisant des films d'abord, et en les montrant ensuite, pour essayer d'avoir quelque chose en retour des autres (des spectateurs, ou des critiques éventuellement). Parce qu'en fin de compte, ce que je demande, en faisant des films, c'est qu'on m'aime. C'est une façon détournée de le demander. J'en fais sans doute parce que je n'arrive pas à me faire aimer autrement. Mais à obliger le spectateur à m'aimer me rend parfois insupportable à ses yeux et peut l'amener à me détester davantage. C'est les risques que tout artiste doit prendre. Je ressens le besoin d'accompagner mes films, qu'on organise des colloques, etc. C'est que mes films n'arrivent peut-être pas à se défendre tout seuls. Mais c'est le cas des films de Straub ou de Duras, par exemple, leur lecture n'est pas aisée, immédiate, parce que leur langage est moins codifié, alors que les films de Spielberg n'ont pas besoin de ça, ils sont immédiatement compris par tous. Il se peut aussi que je n'arrive pas à me détacher tout-à-fait de mes films Q.: Tu ne veux pas livrer un sens unique. D'où le refus du narratif, de l'anecdote, du psychologique. Tu lances des signes, sans en donner la clé. Tu invites à une lecture, tu incites le spectateur à regarder «au-delà» des images. B.L.: Je me suis inventé une écriture qu'on pourrait comparer à des hiéroglyphes, des images-signes-alphabets qui courent tout au long de mes films: rails de tram brisés, pierres tombales, fenêtres murées, grillages (comme dans Magnum Begynasium Bruxellense) qui pour moi signifient l'enfermement, la claustration, le ghetto, la mort présente partout, thématique qu'on retrouve dans presque tous mes films. Ce sont là des choses qui m'attirent, qui m'intéressent plus que le sujet, je peux retrouver cela dans n'importe quel sujet. Je ne dirai pas que mes films sont comme des taches de Rorchach. De pareils films existent. Mais c'est vrai qu'ils renvoient les questions aux spectateurs. Ils ne donnent pas de réponse, de solution. Mon cinéma est donc considéré comme «difficile», parce qu'il demande un travail, une participation du spectateur trop souvent habitué à consommer passivement. Je ne fais pas un cinéma rassurant.
Entretiens réalisés par
Christian Vereecken et Rachel Fajersztajn Quarto - juin 1987  UN GRAND FRÈRE POUR LIO La jeune femme avale un noyau de cerise, le vieil homme regarde par la fenêtre, la casquette et le manteau attendent l'heure de la sortie. On ne distingue pas la photo de l'image de film. C'est qu'il y a peu de cinéastes comme Boris Lehman, et encore moins de photographes comme lui. Cinéaste au cœur du cœur du cinéma, il conjugue une certaine démarche documentariste (Magnum Begynasium Bruxellense) avec les exigences de l'expérimentation conceptuelle, plastique (Babel), il s'inscrit dans une mouvance de l'art contemporain qui va de Cocteau à Warhol et Broodthaers. A l'instar des précités, c'est un touche-à-tout de génie: il est musicien, acteur, dessinateur, écrivain, photographe... Un photographe qui ne joue pas le jeu des fantasmes, des idées fixes à la mode. Rien de mortifère, de pétrifié, de tombal dans ses photos, on a le sentiment d'être confronté à des moments de films arrêtés, qu'il y a une histoire avant, après, derrière l'image et qui est bien plus qu'une anecdote, quelque chose qui touche au mystère de l'âme. Ou encore, on se dit que ces instantanés, c'est une affaire de temps éternisé, il arrive qu'on pense aux tableaux de Vermeer. D'aucuns évoqueront Doisneau à cause de l'humour et d'une certaine atmosphère quotidienne, mais Doisneau photographie à leur insu des gens qu'il ne connaît pas, qui ne font que passer. Boris Lehman, lui, ne photographie que des individus attachés à son propre univers, chaque image est la trace d'une rencontre, elle implique une conversation, une intimité, une connivence. Il pourrait se revendiquer de Diane Arbus: même approche brute, directe, sans voyeurisme, même refus de se tenir en retrait par rapport au sujet. Avec douceur, discrétion, il rephotographie à des mois, des années de distance, tous ceux qui font partie de la famille qu'il s'est constituée; on note son côté rapsodie, harmonie, il privilégie un type de femmes, il revient sans cesse sur «ses» thèmes: les graffitis, les nourritures, les chapeaux, les sommeils... Il ne recadre pas les clichés, ne les manipule pas, reste fidèle à la prise de vue. Il y a parfois une légère mise en situation, jamais de mise en scène théâtrale, emphatique: la pile de bobines dans le fauteuil en osier, il ne les a pas placées là, elles y étaient; idem, la pomme sur la cuisinière à gaz. Boris Lehman ou l'amour des images: «Elles me sont indispensables dans mon rapport au monde. Sans elles, je ne peux parler ni vivre. Il a une sœur, Lio, comparse de l'héroïne dans le deuxième album de la bédé Barbarella, une gamine qui meurt si elle n'a pas toujours avec elle sa collection d'images.
Daniel FANO (Le Ligueur 28 juin 1991)
POURQUOI BORIS LEHMAN FAIT UN CINEMA DE FICTION Dans mes films, vous aurez remarqué, si vous les avez vraiment vus, qu'aucun plan n'est jamais tourné à la main, ou à l'épaule. Tout est filmé strictement sur trépied. Plans fixes donc, généralement. Et s'il y a des mouvements de caméra, ceux-ci sont toujours effectués à l'aide d'un chariot glissant sur des rails, ou au moyen d'une grue. Pourquoi? Ce n'est là pur caprice de réalisateur. ll s'agit au contraire d'une volonté de mise en scène, de délimiter un champ où l'action puisse se situer. Espace précis, encadré, qui me permet de maîtriser tous les mouvements à l'intérieur du plan, et aussi de diriger les personnages dans les limites du lieu. Travail de fiction on ne peut plus. On dit: Boris Lehman travaille à la frontière du documentaire et de la fiction. Mais je ne donne pas la parole aux exlus, aux marginaux, aux fous, du moins directement. Je ne fais pas du reportage. Il n'y a jamais d'interviews dans mes films. Au contraire, je travaille sur la forme - le JE-, sur la narrativité, les expérimentations sur les nouvelles façons de raconter. Et donc, finalement, je raconte des histoires. Bien sûr ce ne sont pas des scénarios académiques imposés par le système des coproductions. Et puis, je ne travaille pas souvent avec des acteurs professionnels. Mais Tati ou Bresson et beaucoup d'autres l'ont fait avant moi. En réalité, la fiction chez moi vient toujours s'immerger sur un fond documentaire, parfois même ethnographique, parce que je m'intéresse beaucoup aux gestes du quotidien, aux rituels humains, à tous les petits détails qui rendent compte de la place de l'homme dans le monde. C’est le cas de tant de cinéastes, de Rossellini à Kiarostami, de Pasolini à Eustache. Jamais pour ces cinéastes, le malentendu ou la confusion entre cinéma documentaire et cinéma de fiction ne s'est posé. J'irais même plus loin, en déclarant que Vertov et Flaherty surnommés les pères du cinéma documentaire, faisaient aussi de la fiction, comme Eisenstein. Et c'est d'autant plus vrai qu'on décèle chez eux une écriture, un style, un point de vue, une manière personnelle de filmer. Peut-être faudrait-il rapprocher mon travail des cinéastes comme Chris Marker, qui font un cinéma un peu hybride, qui tient de l'essai cinématographique, à cheval sur la philosophie, les beaux-arts et la poésie. Il ne viendrait à l'idée de personne de dire que l'œuvre de Borgès, de Pérec, de Greenaway, de Raul Ruiz, de Boltanski, de Paul Auster, de Pessoa avec lesquels je suis apparenté à plus d'un point, soit documentaire. Mes films sont comme des fables, avec pour décor le réel. Ils empruntent la forme simple du journal intime et ils sont autobiographiques, puisqu'ils parlent très souvent de quête d'identité et de recherche d'origine, et que j'y apparais très souvent comme sujet, et comme personnage. Mais cette quête et cette recherche sont constamment fictionalisées, scénarisées et mises en scène, comme le témoignent par exemple Couple, Regards, Positions, Babel, et mes films les plus récents: A la recherche du lieu de ma naissance et Leçon de vie. BORIS LEHMAN, CINÉASTE DE LA PREMIÈRE PERSONNE Comme l'écrivain qui applique l'adage «Pas un jour sans une ligne», Boris Lehman filme tout le temps. Il avoue même avoir plusieurs fers au feu, mener plusieurs projets de front, même s'il admet que cette continuité est plus malaisée pour l'homme de film que pour l’homme de plume. «Je ne suis pas un cinéaste du dimanche» , dit-il avec son petit sourire en coin, «je ne tourne pas dans les intervalles entre des cours à donner, par exemple. Le cinéma est ma priorité de vie. Pendant des années, je l’ai approché à travers d'autres arts, la musique, le dessin, maintenant j'y suis complètement immergé...» Les films de Boris Lehman ne sont pas souvent programmés en salle ou à la télévision. Il récuse cependant la marginalité qu'on lui accole quelquefois. Il se défend d'étre un artiste underground. Même s'il a débuté dans cette mouvance, à la fin des années soixante, il ne fait pas du cinéma «contre». Ceux qui ont adopté cette démarche se sont souvent laissé récupérer ensuite, ont abandonné la lutte ou sont tout simplement «rentrés dans l'ordre». Lui, ce qu'il défend, c'est une vraie liberté de l'artiste, ou de l'artisan. Une œuvre s'est édifiée ainsi, que l'on peut voir au grand complet ces-jours-ci au Musée du Cinéma, depuis L'Histoire d'un déménagement, qui date de 1968, à L'Homme de terre, qui aura, au préalable, connu sa grande première ce mardi soir, au Passage 44. Par ailleurs, le Musée du Cinéma lui a demandé de faire la sélection des films qui lui importent, et qui relèvent tous, de Cocteau à Dwoskin, de Paradjanov à Wenders de ce «cinéma à la première personne» qui définit aussi sa démarche personnelle. Le cinéma lui sert avant tout à une quête d'identité qu’il poursuit depuis des années. «Dans Babel, j'utilise la forme du journal filmé, dans Muet comme une carpe j'ai recours au souvenir d'enfance, dans L'Homme de terre, je pars du thème d'un double de moi qui serait l'œuvre de quelqu'un d'autre.» L'idée lui est venue lorsqu'un sculpteur de ses amis, Paulus Brun, a voulu faire son portrait. Il lui a d’abord demandé de pouvoir filmer le processus. Et puis ce qui aurait pu n'être qu'un documentaire de plus sur l'art a été entraîné vers une chose plus fictionnelle, plus symbolique, sur laquelle est venue se greffer sa manière de voir le monde. Comme son effigie est constituée de terre, fatalement le thème du Golem s'est imposé, avec toute la place qu'il occupe dans la tradition juive. Et il ne s'est pas refusé le plaisir d'insérer dans son film des images du film que Wegener a tiré du roman de Meyrink, où d'ailleurs le cinéaste joue lui-même le rôle du Golem. «La confession, le journal intime me passionnent au cinéma, dit-il, peut-être parce qu'ils y sont assez tabous. Chaplin apparait dans ses films, mais sous le masque de Charlot, Woody Allen n'est pas, dans ses fictions, le même que dans la vie. Dans mon cas, quelqu'un qui ne me connaitraît pas pourrait recevoir mes films comme des fictions romanesques. Leur statut est différent, pourtant, et cela pose des problèmes d'impudeur, d'intimité, de morale. Il m'arrive de montrer des choses qui m'échappent, ou, à d'autres moments de me censurer...» Il travaille le plus souvent en 16 mm refusant les ressources de la vidéo. «Le fait qu'en vidéo l'image se liquéfie en quelque sorte me dérange, de même que les facilités que l'on a à la manipuler. Je continue à croire que le cinéma participe d'une magie, cela a quelque chose de primitif d'archaïque, mais que je revendique entièrement: le gadget ne m'intéresse pas». Il sent la brèche s'élargir entre sa pratique et celle de la grande industrie. Avant, il faisait ses films avec le vingtième du budget d’un film ordinaire, maintenant il doit se contenter du centième. «Et pourtant, mes moyens augmentent», reconnaît-il. Si le ministère ne l'aide pas beaucoup, des ateliers comme Wallonie Images Productions ou le Centre Bruxellois de l'Audiovisuel, plus souples, le soutiennent. La Sept, la ZDF lui ont également passé des commandes. Mais il regrette que le cinéma n'offre pas la liberté de l'édition. «Au moins pour une certaine littérature, les Editions de Minuit existent » soupire-t-il. Cela ne l'empêche pas d'être invité dans les festivals, de s'y faire des amis, comme Raul Ruiz, qui a écrit le texte de L'Homme de Terre. Il ne se sent pas incompris, ni maudit. «Mais lorsque l’on refuse de faire du cinéma selon les normes, quelles difficultés cela entraîne, et quelle persévérance cela suppose! Boris Lehman continuera son combat: cet homme de terre est un homme de fer...
Jacques de Decker (Le Soir, 26 septembre 1989)
DEUXIÈME QUINZAINE INTERNATIONALE DU CINÉMA JUIF - 1984 Du 4 au 16 décembre 1984, se tenait à la Cinémathèque Québécoise la deuxième Quinzaine Internationale du Cinéma Juif conçue et programmée en étroite collaboration avec la cinémathèque par le Festival International du Cinéma Juif de Montréal: celui-ci est un organisme indépendant formé de spécialistes du cinéma et de cinéphiles désireux de faire connaître les oeuvres cinématographiques créées par des cinéastes juifs ou à thématique juive. Ces deux semaines présentaient un programme de 35 films provenant de France, de Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada, de Suisse, d'Allemagne, de Pologne et d'Israël. À ces pays s'ajoutait la Belgique représentée par un jeune cinéaste juif, Boris Lehman, dont plusieurs films furent projetés, et ce, en sa présence. La programmation comprenait des courts et des longs métrages dont onze constituaient une première canadienne. Dans cette série, on peut dégager certains films marquants. En avant-première, Jacques Bensimon, cinéaste à l'ONF et dont l'œuvre a traité à plusieurs reprises des thématiques rattachées à l'émigration du Maroc et de l'adaptation des Juifs Sépharades à Montréal, présentait son film «Carnet du Maroc- Mémoire à Rebours». Ce film constitue la première partie d'un ensemble à deux volets qui retrace l'histoire du Maroc, des origines à aujourd'hui. À travers un montage se déplaçant constamment du présent au passé, des films d'archives aux images fortes de la réalité marocaine contemporaine, le cinéaste, présent tout au long du film dans le commentaire en «voix off» et, par moments, par l'image, a tenté par ce retour de se resituer dans le contexte historique du Maroc, de se rattacher à cette judéité marocaine dont l'insertion en terre islamique s'est vue occultée et déformée par la colonisation française. Journal à la fois personnel et épique, cette œuvre intéressante, témoignage sensible d'un retour aux sources, nous met en attente de la seconde partie qui achèvera ce cycle important dans l'itinéraire de ce cinéaste sépharade. Notons aussi la présentation d'un court-métrage, «Le Jardin (du Paradis)» réalisé en 1983 par Raphaël Bendahan, œuvre abstraite renvoyant au déracinement et au déplacement entre les cultures, les villes et les langues. La présentation des films de Boris Lehman, né en 1944 à Lausanne de parents juifs polonais venus s'installer à Bruxelles, a constitué un des moments importants de ce festival. «Ne pas stagner», «Le grand Béguinage de Bruxelles», «Symphonie», «Couple, Regards, Positions» et «Bruxelles Transit», démontrent la versatilité de I'utilisation de la caméra, moyen d'expression à fonction thérapeutique, outil de description des réalités sociales contemporaines, médium poétique et biographique dont Boris Lehman fait une démonstration de virtuose. Il faut noter aussi, dans un autre registre, le film de Morton Silverstein, «The Golden Age of the Second Avenue» dont la rétrospective sur le théâtre yiddisch nous fait découvrir les échos de cette période disparue, marquée par les chefs-d'œuvre comiques et les acteurs qui ont exprimé cette réalité juive des premières vagues d'immigration aux Etats-Unis, et qui survit sous des formes édulcorées mais reconnaissables dans la comédie musicalé américaine et certaines tendances cinématographiques contemporaines. Parmi les longs métrages, le film de Marhus Imhoof, «La barque est pleine», est remarquable. Grâce à une mise en scène très simple, des comédiens excellents et une intrigue sobre, ce cinéaste suisse réussit à décrire de façon poignante l'odyssée de ces quelques réfugiés juifs allemands, fuyant le nazisme et obligés, à cause des lois suisses de l'époque, de retourner dans leur pays d'origine où ils perdent la vie. Métaphore de toutes les tragédies qui frappent tous les réfugiés du monde, ce film met en lumière la froide raison d'état pour qui les individus doivent s'effacer devant des lois bureaucratiques où la compassion n'a pas sa place. Dans la même perspective, notons aussi «Falasha - Agency of the Black Jews», d'actualité quotidienne, et «Comme si c'était hier» sur le sauvetage d'enfants juifs en Belgique occupée. Thème aussi contemporain, le film «Pour les Palestiniens, une Israélienne témoigne» montre la vie des habitants de Cisjordanie, leurs contradictions internes, coincés entre l'occupation israélienne et les grands propriétaires arabes. «Paratroopers» de Yehuda Judd Neeman fait, quant à lui, le procès de I'armée israélienne à travers une peinture d'un camp de parachutistes, ce qui démystifie les héros. «Description d'un combat» de Chris Marker, documentaire sur l'lsraël des années 60, constitue, par son traitement humoristique, ses images significatives, sa valeur de prophétie, un des chefs-d'oeuvre du cinéma de reportage. Parmi les films réalisés par des metteurs en scène non-Juifs, sur une thématique traitant, en tout et en partie, du monde juif «Austeria» de Jerzy Kawalerowicz et «La Terre de la grande promesse» de Wajda, tentent d'analyser, en tombant par moments dans des formes caricaturales, les différents courants juifs dans la Pologne du XIXème et du XXème siècle. Programme fort intéressant par son contenu, cette Quinzaine a permis d'affirmer la présence d'un cinéma à thématique juive. On doit cependant constater que, pour la plupart des films, la salle était peu remplie, démontrant que, pour le public juif en particulier, un tel festival ne constitue pas encore un point de référence. Faut-il y voir seulement une question de diffusion de l'information? Une volonté de ne pas explorer le lieu de culture excentré que constitue la cinémathèque par rapport aux centres culturels juifs? Quoi qu'il en soit, ce festival représente une volonté d'inscrire dans le paysage culturel de Montréal une réalité cinématographique encore mal connue et dont la valeur doit être reconnue. En plus du signataire de cet article, les membres du comité comprenaient Stanley Asher, Michel Afriat, Suzanne Dadoun, Pierre Lasry, Serge Ouaknine et Michèle Saal.
Yossi Lévy
 Art Press: hors série N° 14 (1993) UN SECOND SIÈCLE POUR LE CINÉMA Les films que j’ai faits et qui n’existent pas Voir et entendre Voir ne me suffit pas. Filmer, pour moi, c'est d’abord montrer ce que j’ai vu, c'est donc faire partager une expérience, et donner quelque chose que j’ai pris qui existait avant, que j’ai trouvé, ou (re)constitué: transmission, mise en scène, création. Ces vues et ces sons - morceaux de vie/ fragments de temps - sont alors ramassés par l’autre - spectateur, public - qui, à son tour, prend et transmet. Et ainsi de suite. Filmer, c'est bien sûr fixer sur la pellicule, sur un support (celluloïd ou magnétique). Mais souvent la technique n’est pas prête, n’est pas là au moment où je vois. Le film se déroule sans pouvoir être fixé, et disparaît tout aussitôt. Des milliers d’images ainsi vues et disparues, perdues à jamais, tout au long de mon itinéraire quotidien. Mais je n’ai pas de regrets. L'aventure commence précisément au moment même où la conscience de leur perte me pousse à les rechercher, à les retrouver. Quelques films naissent ainsi, et témoignent de tous les autres qui n’existent pas. L'œuvre renvoie toujours à quelque chose d'extérieur à elle, de plus essentiel, qui reste insaisissable. L'original vécu. Il ne me servirait à rien de me greffer une caméra aux yeux, de filmer tout le temps. Car tout filmer revient à ne rien filmer du tout. Je n’ai que faire de toutes ces techniques actuelles (la vidéo par exemple) qui permettent de «filmer mieux et plus vite». Le temps de la création ne pourra jamais être réduit. Comment j'ai filmé certains de mes films En dehors de la question de l'impossible (du) rapport sexuel, la question centrale posée par mes films serait: où mettre les cendres de ce qui part en fumée, comment faire pour qu'elles ne se dispersent pas, comment transmettre. Souci non de pérennité, d’éternisation, mais de traces , de laissées, de mémoire. Ma filiation et ma paternité en quelque sorte. Je ne filme pas l'éphémère pour le rendre éternel; c'est un pari de transmission, je lance des bouteilles à la mer. Aujourd'hui plus qu'hier, tout disparaît très vite, devant nos yeux. Livres rongés par l’acide, films réduits en poudre, bandes magnétiques effacées, maisons, monuments, paysages menacés de destruction et d’effondrement, corps humains ravagés par le cancer, par le sida... Nous assistons impuissants à la perte des origines et à l’impossible d’un futur. Rien qu'un présent pressé, qu'un feuilletage accéléré, qu'une vie réduite à la consommation d’où toute pensée, toute jouissance, sont désormais exclues. Ce présent, je le filme tout le temps, en même temps qu’il disparaît. Je deviens malgré moi l’archéologue de demain. Dans l’Homme de Terre, Paulus Brun fabrique mon double en terre et je filme cette construction avant de la détruire, de l’effacer, de l’anéantir. De même la carpe (dans mon film Muet comme une carpe) est-elle d'abord pêchée, puis dépecée avant d’être mangée. Quelque chose toujours apparaît, puis disparaît. Je sème de nombreux miroirs, fragiles, qui finissent par se briser, emportant les morceaux défaits de moi-même, que quelqu'un, quelque part, quelquefois ramasse et reconstitue. Ces franges de présent fixées, captées puis conservées, ressembleraient aux ossements que le paléontologue étudie avec patience pour reconstruire l’animal perdu ou disparu. Comment dire comment je fais? Ce que je veux? Je ne veux rien. Je ne peux pas le dire. Parce que le dire c’est ne pas le faire. J’y vais, c’est tout. Je vais voir, et je me débrouille. Un moment, la peur et le trac sont vaincus. Filmer, attendre, passer souvent aux mêmes endroits... je tisse des liens, je filme quelque chose qui me permet de filmer autre chose, de revenir, de poursuivre mon travail. L’approche est timide et progressive. Je commence par filmer le plus facile, le plus évident, et, sans doute, le plus superficiel. J’ai besoin de me sécuriser, de m'exercer, de me tester. Si ça ne va pas, je n'insiste pas, j’abandonne, je vais voir ailleurs. Sinon, je persévère, je reviens, je tourne autour de ce qui me fait face, avec quoi je finis par fusionner. Ma vision est cosmogonique. Lorsque je filme une tasse de café, je filme l’univers. Sans doute me suis-je donné une tâche impossible. Chacun de mes films est un défi, une utopie, un projet mégalomaniaque. Mon désir de totalité, ma tentation de l’encyclopédisme allant de pair avec ma peur de tout rater, m'entraînent dans une espèce de transe où seul le cinéma me sauve de mes découragements, de mon insatisfaction, de mon désespoir. Je me plonge dans un travail fou qui n’a ni début ni fin. Je ne commence plus rien ni ne finis plus jamais rien. Je continue, sans plus vouloir m'arrêter. Les malentendus subsisteront.
On vous a dit «cinéaste». Il a fait un film sur Arié Mandelbaum.
Non, je ne suis pas cinéaste. Qu'est-ce qu’un cinéaste, me direz-vous? Sans jouer sur les mots, je dirais que je filme - et même que je n’arrête pas de filmer. Quant à faire des films, cela m’a toujours semblé une besogne appelée à la médiocrité, et forcément inscrite dans un système mercantile et/ou artistique. Si je suis cinéaste, malgré tout, alors je ne suis pas un cinéaste comme les autres. Formule creuse et prétentieuse sans doute, qui peut être dite par tous sans engager personne. Filmer est devenu pour moi un acte tellement sacré et quotidien. Un acte tellement nécessaire, au même titre que bouger, manger, dormir. Est-ce qu’on peut comprendre que je fasse dix mille kilomètres pour filmer en gros-plan une goutte d’eau, que j'attende dix ans, et même davantage, pour filmer un bouton de chemise ou un morceau de mur, que j’ai besoin d'une caméra lorsque je vais chez le médecin? Des images, j’en fais tous les jours. Pas besoin de scénario ni de commande ni d’avance sur recettes, ni de droits d’auteur ni de palme d’or. Les choses qui sont là me suffisent, comme à Cézanne des pommes. Je ne fais pas mes films; je suis fait par eux.
Je voudrais bien supprimer tout intermédiaire inutile entre l’image et moi. Que le projet soit le film, débarrassé de tout ce qui l’encombre: I’argent, les intentions, la prétention, l’art, la psychologie..., pour me battre uniquement avec le système archaïque du mécanisme-cinéma: lourd, répétitif, hypnotique et bruyant. La solitude - et la souffrance - du cinéaste (et sa joie donc) commence par le poids des bobines qu’il transporte. Porter la matière première de son œuvre (je ne sais pas pourquoi, mais j’ai toujours essayé d’imaginer comment Beethoven portait en lui toute une symphonie), porter le matériel de prise de vues, de prise de son, me permet de sentir ce que signifient un point de vue, et un déplacement. Un plan, un mouvement de caméra, doivent être pour moi la récompense d'un effort physique. Ce que tu portes te façonne. La lourdeur a toujours été, je le pense, quelque chose de positif. Voyez les photographes du siècle passé, les premiers cinéastes d’actualité. Il fallait placer l’appareil sur un pied, poser longtemps sans bouger. Les images gagnaient en force, en précision, en évidence et en vérité. Aujourd'hui, la tendance est à la paresse et à la vitesse. On ne touche plus les instruments. Quand le résultat est trop immédiat, il est aussitôt oublié. Sans délai, il n'y a plus ni rêve ni magie.
Marcher, filmer.
À l'opérateur qui me demande: «qu'est-ce qu'on tourne?», je ne peux que répondre: «on tourne!» Avant d'imaginer mon film, il me faut l’éprouver.
Et pour le faire, j’ai besoin de prendre des routes sinueuses, de partir, déménager, faire mille détours, revenir plusieurs fois sur les mêmes lieux, m'égarer... La marche est mon mode de fonctionnement naturel. La promenade n'est-elle pas le prélude au voyage (réel et imaginaire), en même temps qu'une espèce de dévoilement de l’être? En marchant, on avance, de sa naissance à sa mort, on sort de l’ombre, de l’obscurité, de sa cachette, de sa tanière, pour s'égarer, petit poucet imprévoyant, dans la nature et dans le monde. Marcher. S’arrêter et regarder. Vision vierge, sans scénario. La pensée vient en marchant. Péripatéticiens. Herzog, Rousseau, vagabondage, Walser, Lenz... Le piéton serait-il affaire de littérature (tandis que le cinéma en appelle inévitablement à d'autres moyens de locomotion: cheval, train, voiture et avion)? Ne serais-je donc qu'un écrivain de cinéma ? Une des plus belles manières de respecter la nature est de la filmer. La prendre sans la prendre, la caresser sans la toucher, sans arracher ses plantes ni tuer ses insectes. La transporter en la laissant intacte. Juste une trace de mon passage, une empreinte. Un acte d'amour. Qu’ai-je fait? qu'ai-je pensé? qu'ai-je été? Ici maintenant et là, jadis. De mon errance et de mes sensations, que reste-t-il? Si je ne filme pas, je ne vois rien, je ne retiens rien, ni les arbres, ni les visages. Si je les filme, je peux les oublier, mon film est ma mémoire, un catalogue de faits et gestes, un inventaire (très incomplet) de ma vie. Etre là à ce moment-là. «Pourquoi as-tu montré cela?» (c'est la question habituelle du spectateur, mais aussi du monteur et du producteur). Je l'ai fait parce que j'étais là à ce moment-là. Je ne savais pas que j’allais le faire avant de le faire. «En somme, à quoi t'intéresses-tu?» À tout ce qui me traverse. Je suis curieux de tout. Je ne m’intéresse pas particulièrement à ma naissance, ni au quartier du Béguinage, ni à la préparation de la carpe farcie, ni à la peinture d’Arié Mandelbaum. Tous ces films ont surgi à la suite de rencontres, de découvertes, de circonstances. Il m’a fallu à chaque fois une impulsion, puis une production, une discipline, un entêtement, beaucoup de patience... Je ne me suis jamais posé la question du sujet. Le vrai sujet a toujours été moi. Je ne veux pas de cette image du cinéaste, de celui qui fait et montre des films. Même quand je m'arrête de filmer, je fais encore du cinéma. Mes films ne s'arrêtent pas à des tournages. Ils continuent, tout le temps, à chaque instant. Je ne me repose jamais d'un tournage. Quand je vais me promener avec une amie à la campagne, je filme encore. Quand je mange un morceau de tarte à mon café habituel, je filme, j’invente de nouveaux plans, je prends de prochains rendez-vous. Ni préparation, ni repos. Mes films m'accompagnent tout le temps. Préparation Je ne prépare pas un tournage. Il vient, il survient. Il faudrait parler plutôt d'attente: j'attends que le tournage vienne à moi. Encore qu'il ne faille pas confondre préparation avec préparatifs. Cette préparation, ce mûrissement, se réalise effectivement, non par une paresse, mais bien par une oisiveté active, un passage obligé du temps. Une tension plus exactement, qui atteint son apogée. Comme l'observateur aux aguets qui espère voir surgir un rapace fondant sur sa proie, ou le brame du cerf. Il faut être là, au bon endroit et au bon moment. Sans scénario, j'insiste. Car il y a nécessité de garder neuve et intacte l'idée, et même la peur, l'angoisse de la mettre à jour. Le cinéaste ne peut se transformer en écrivain, ni en comptable, ni en représentant de commerce (même s'il m'arrive, bien sûr, de cumuler toutes ces fonctions). Le scénario n'est qu'un garde-fou, une pièce à séduction, une assurance-tous-risques destinée aux fonctionnaires chargés de les juger, de les classer (selon leur viabilité, leur rentabilité, leur chance de succès...), aux metteurs en scène incapables de mettre en scène et aux producteurs, afin de protéger leurs capitaux contre les imprévus, contre les fantaisies, contre les intempéries. Or la création n’est faite que d'imprévus, de tâtonnements, d’hésitations, d'erreurs et d'improvisations, d'intuition, de poésie et d'inventions, toutes choses qu'on ne peut expliquer, ni contrôler, ni préparer, ni maîtriser. Les étapes de la réalisation, chez moi, sont intimement liées, mêlées, inextricablement: écriture, repérage, production, enquête, tournage, montage et scénario se font en même temps, au fur et à mesure. La préparation, c’est aussi le film. Les idées viennent à chaque instant, il n’y a pas une chose puis une autre puis une autre. Le film est toujours matière à transformation, un film en devenir. L'itinéraire jusqu'au sujet est même partie prenante du sujet, c'est le sujet. Plus important que le sujet lui-même est sa recherche, sa quête, sa révélation. Qui fait le film? Le cinéma, art collectif. Un générique de film qui crédite tous les participants - et en oublie beaucoup - contient des centaines de noms. Ces noms sont accompagnés de fonctions. Qu'ont-ils fait? Qui sont-ils? Où est l'auteur? Dans mes films, la division des tâches existe peu. Tout le monde fait un peu tout. Il faut bien désigner, pour la commodité, un responsable de l'image et un responsable du son. Et «le grand responsable», celui qui le dernier reste dans le navire (ou la barque), celui qu'on aime ou qu'on hait quand le film est fini. Ensuite il y a des rôles, ceux qui apparaissent sur l'écran, et ceux qui, derrière la caméra, m'aident à organiser, à orchestrer, à tenir les ficelles et les clés du puzzle, assistants, régisseurs, producteurs, metteurs en scène. Chacune des personnes apparaissant dans mes films joue en quelque sorte « son propre rôle » - je ne travaille pas avec des comédiens professionnels -. Ces personnes me donnent une partie d'eux-mêmes, qui pour moi représente plus qu’un scénario, un vrai cadeau, cette part de moi-même que je cherche justement à capter, qui m'attire et que je ne peux trouver qu’à travers l'autre. En finir avec les films-produits. A la question: «que fais-tu Boris?», j'ai toujours l’impression de pouvoir répondre que je tourne, que je suis très occupé, et qu’en même temps je ne fais rien, que je suis totalement disponible. Dans le fond, ça reviendrait au même de dire: « Je suis en vie, je respire». On voudrait que le travail soit toujours quelque chose d’autre que la vie, un «à-côté», une «occupation», un «loisir», une «profession». «Ma vie est devenue le scénario d 'un film qui lui-même est devenu ma vie». Filmer ma vie, ou plutôt vivre en filmant, telle a été ma devise, ainsi que mon art poétique pendant le tournage de Babel - qui a duré presque dix années -, devise qui s'est répercutée sur mes autres films, cette confusion - sinon fusion entre ce qu'on vit et ce qu'on filme, rend évidemment caduque toute notion de normes, de genre et de durée. Mes films ne sont ni courts ni longs. Il ne s'agit ni de documentaires, ni de fictions. Ils ne sont qu’un même film, un film unique, un ciné-journal écrit au jour le jour, par petits morceaux, par miettes accumulées (ma devise: «un peu chaque jour»). Je ne vois rien de moderne à cela, mais il est vrai que cette démarche, artisanale, est proche de celles de Jonas Mekas, de Joseph Morder ou de Chris Marker. On voit bien la difficulté que j’ai à planifier, à engager des techniciens, à rattacher mon cinéma à une organisation pratique professionnelle (équipe, horaire, production). Cette disponibilité totale demandée, ce temps-à-perdre, est rejetée par presque tous, puisque contraire à toute éthique, esthétique et économie du cinéma. Cinéma-vie.
A quoi ressemble mon cinéma? Qu'est-ce que le cinéma de Boris Lehman?
Peut-être est-ce un cinéma qui se cherche justement une définition, qui hésite entre documentaire ethnographique, film scientifique, fiction expérimentale, film thérapeutique et film autobiographique? C’est un cinéma mal à l'aise, assis entre deux chaises, qui dérange. Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi. Je suis tout le contraire d'un provocateur. Je crois qu'on m'en veut pour mon comportement, pour mon désordre, ma rébellion, ma résistance, et aussi pour l’inachevé de mes actions, le fait que ça dure, qu'on ne sait pas quand ni comment ça va finir. Mon attirance va certainement vers des formes extrêmes et primitives du cinéma, vers un degré zéro, perceptible surtout dans le cinéma des origines, dans celui des amateurs, ou dans un certain cinéma d'avant-garde. Mais cela n’est que l’aspect formel. Il y a autre chose. Mes images ne diffèrent pas tellement de celles des autres cinéastes. Les artistes en général se sentent obligés de faire des œuvres, et leurs œuvres une fois terminées se détachent de leurs auteurs, qui en sont dépossédés, leur film peut être montré sans eux, c’est- à-dire hors d'eux. Je ne puis accepter cela, puisque mon œuvre c'est moi.
Boris Lehman (Art Press Un second siècle pour le cinéma, N° 14, 1993)
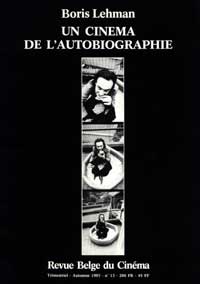 B.L. Cela commença par quelques images en Super 8. L'épreuve était lointaine, déjà: plus d’une dizaine d’années. J’ignorais (est-ce bien vrai?) qu'un certain B.L enregistrait un album de portraits alors que, de mon côté, je filmais des paysages et quelques visages. Ce devait être dans l’air du temps: 1968 venait de frapper les esprits et toutes sortes de soi-disantes minorités (car elles n'étaient pas si mineures que ça) sortaient de l’ornière. B.L travaillait à BXL. Je me trouvais - me trouve - à Paris. Je ne sais plus quand je vis, pour la première fois, une image B.L.ienne. J’étais surtout sous l’emprise, à ce moment-là, d’un certain L.L. (Lucien Leuwen) d'un autre B.L. (écrire BEYLE). Comme toujours, c'est le temps qui arrange les choses, c’est-à-dire les rencontres. Disons que les films de B.L entrèrent dans ma vie de la façon la plus naturelle et plus évidente qui soit: par la porte de l'écran. Il m’amena donc des portraits et une étrange vision de la mémoire. B.L devenait ainsi une sorte de Belge Loubavitchien qui chantait la Symphonie de la folie du passé. Justement, la folie. C’est là sans doute où il me marqua. Il n’était pas le seul: d'autres Bruxellois participaient de la même entreprise, et sans être forcément aussi Juifs et Polonais que lui et moi. Les nuages belges portent quelque peu sur la tête et aiguisent l’art de la folie générale. Cela donne de vrais artistes, cela provoque de véritables tours de Babel. BaB.L C'est ainsi que ses images s'amoncellent dans mon esprit. Je vois des gens, des visages/ paysages qui me parlent, du fond de leur antre. Théâtre, représentation, recréation. Naissance du haut d'une pyramide à Waterloo. L’eau. Le feu, Masques de couple. Tout ceci est bref. Mais tout ceci pourrait ne pas avoir de fin. Appelons cela la B.L. touch.
Joseph Morder
J'ai rencontré Boris au Festival de Figueira da Foz où sa présence qui n'était pas commandée par la mondanité paraissait du coup presque incongrue, son apparence en tous cas l'était, sinon incongrue, déplacée, en imperméable nordique au bord de la mer, en short sous l’imperméable, il évoquait irrésistiblement un commis-voyageur égaré, il révélait par son aspect son appartenance à la face cachée de ce rêve américain de conquête de la lune qu'est le cinéma, où, à côté des guerriers des étoiles circulent des commis-voyageurs fatigués, représentants d‘eux-mêmes, dont les films ont toujours une saveur anachronique, non pas passéiste mais d‘un futurisme miné par le regret d‘un temps moins exact, plus artisanal, et aussi achevés soient-ils, paraissent toujours des échantillons d'une marchandise que l'on ne verra jamais, peut-être parce qu’elle n'est pas vraiment une marchandise, avec un air souffreteux qui contamine les images léchées jusqu’à ôter toute saveur des autres films, comme Boris contaminait par sa gentillesse déplacée la mondanité de ce Festival ou de celui de Porto où nous nous sommes retrouvés, et par sa seule présence, l‘hôtel de luxe conçu pour loger uniquement des ambassadeurs de grandes puissances dans lequel il s’installait comme dans un hôtel borgne, ses films comme unique bagage, valise d’échantillons jamais placés, toujours déplacés comme cette fois-là au milieu de films de vampires et de science-fiction comme un élixir inquiétant parce que sa présence leur communiquait son inquiétude, en la vertu de jouvence desquels sa fatigue ôtait toute crédibilité, fatigue plus que visible voyante, en blouson rose, d'une voyance nécessaire pour effacer la communicativité du découragement, pour attirer l’attention indispensable à la survie, c'est-à-dire à la réalisation d’un prochain film pour lequel Boris accumulait les notes et les documents, rédigeait des notices publicitaires pour faire passer pour marchandise ce qui n'est qu’échantillon, pour passer enfin de l’échantillon au chant, au chant total où entrerait toute son histoire, I’histoire de Bruxelles, I’histoire d'un siècle, un fragment synthétique de l’histoire du monde actualisée au présent, à un présent qui est déjà irrémédiablement passé, emporté par un temps lent qui voudrait sans doute se mordre la queue mais ne la trouve pas, un temps serpent dont chaque écaille est une image à conserver, ruban d'images à l'intérieur duquel le tri ne pourra s'effectuer qu’après coup, selon un choix que le film, autre serpent, anneau dans l’anneau, en s’éveillant comme quelque œuf antédiluvien que la mémoire impose, rendant caduque l’infinie collection des milliers d'ossements fragmentaires qui en constituaient le projet, et Boris-Jonas rapidement avalé par ce serpent avant même de l’avoir enfanté, Boris toujours à l’intersection de deux anneaux dont il espère qu’ils ne seraient que les deux boucles d’un seul anneau de Moebius le long duquel il avance sans savoir s’il parcourt le temps ou son film, essayant de les nouer de quelque manière, posant en guise de bornes des chaînons en forme d’alliance pour le mariage de l’eau avec le feu, en forme de travelling circulaire dans l’atelier d’Arié, selon un écheveau inextricable où vie et films se confondent, amis et collaborateurs, Bruxelles et Babel, la lumière réfléchie et les images projetées, Boris projette son ombre patiemment sur chaque pavé de la ville, sur chaque écran de la planète et son ombre nous illumine.
Saguenail Abramovici
CINEMATON 7 ans après... Mon cher Boris, Puisque tes images et tes sons intéressent de plus en plus de monde en Belgique et ailleurs, puisqu’un livre les concernant est en préparation, puisque tu m'as demandé d'apporter un peu de mes connaissances et de mon expérience de filmeur à cette entreprise, je me permets de t'envoyer ces quelques notes scripto-visuelles. Et puis je me suis dit qu'on allait encore une fois se faire piéger par la terreur de l'écrit. Alors, j'ai cherché les images que nous avions faites ensemble et j'ai essayé d'y déceler les raisons pour lesquelles, un jour, un matin, une nuit, le jeune Boris, a choisi la voie royale et tapissée d'embûches du cinématographe. Pour cela, il m'a simplement suffi d'aller y voir du côté de Cinématon puisque tu as donné deux fois de ta présence devant la caméra. Le 14 octobre 1978 et le 13 février 1985. Presque 7 ans. Novembre 1978. C'est la dernière année du festival de Paris. Tu errais dans les couloirs de l'Empire... Nous étions allés sur le parvis de Beaubourg quand il était encore désert et tu t’étais prêté au jeu du Cinématon. Pendant que je filmais, tu avais sorti ton armada d'appareils photos. Tu avais fait un polaroïd, instrument dont tu ne te séparais jamais à l'époque (et maintenant?). J'arrête un moment car me vient une anecdote. C'était quelques mois après ce Cinématon, quand nos routes s'étaient à nouveau croisées, à Berlin, un soir, devant une salle de cinéma. Eddie Constantine attendait là, dans le froid. Tu avais figé Monsieur Lemy Caution sur la pellicule. Tu étais heureux. Heureux comme tu l'étais chaque fois que tu déclenchais un appareil photo ou une caméra. Je suis persuadé que tous ces polaroïds que tu accumules depuis des années constitueront un film, un film-cousin de Cinématon. (A moins que Cinématon soit un film-cousin de ces polaroïds du fait de l’antériorité de ces derniers!). Bien sûr, ce Cinématon des origines - de la première année - est rempli d'insouciance et de légèreté. De ton côté. Et du mien. Etait-ce de la dérision lorsque tu choisissais comme unique action (avec le fait de photographier) de te peigner? Je le crois et je t’en félicite. Tu jouais complètement le jeu. Bravo! J’ai toujours dit que je commençais à filmer quand les autres n’avaient pas encore commencé ou quand ils avaient déjà fini. L’action de se peigner est, par excellence, le moment de la préparation avant le tournage. De ce cinématon de la première heure peut-être ne pensais-tu pas qu'il serait un maillon d’une collection singulière mais tu présageais bien par ton comportement face à la caméra que LE CINEMA, EH BIEN, IL NE FAUT PAS LE PRENDRE A LA LEGERE car une image, ou 100, ou 1000, ou 3600 (le nombre d'images que constitue un cinématon) ça compte et ça reste, ça ne s'évapore pas par un tour de passe-passe. Au moment où, moi, j’étais en train de filmer, tu te faisais prendre à la magie du cinématographe. Ciné-miroir, voilà tout. Que 7 ans plus tard nous ayons voulu « remettre ça » ne change rien de fondamental à ce qui avait été inscrit dans l’image du cinématon 34. Toute la spontanéité, la naïveté, le culot est remplacé par la maîtrise, le contrôle, la précision, la minutie. C'est ça le cinématographe ! Plus on apprend, plus on contrôle la «mise en scène», plus on perd de la réalité, de la vérité (COMBIEN DE VERITE LA-DEDANS... Je ne sais pas), je dirai même de la vie. Que tu aies réussi la gageure de te cacher entre les images pour ne faire apparaître que du texte est un joli pied de nez à l'essence même du cinématographe... et de Cinématon. Après tout, c’est une position courageuse vis-à-vis du premier portrait. Je le répète: on ne fait jamais mieux que la première fois, que la première prise. Deux fois, c'est trop. Et en parlant de Deux fois, je me demande bien ce que vient faire cette affiche de New York story, cette image de Jackie Raynal retroussant ses dessous, émergeant du flou et se perdant avec l’image reflétée du cameraman-cinéaste-cinématonneur. Deux fois, c'est vraiment trop. L’impossible représentation... C'est vrai, en 7 ans, tu as été en transit à Bruxelles, tu as rencontré Romain Schneid. Tu as compris qu'on ne peut pas tout montrer, qu'on ne peut pas tout filmer. C'est peut-être la leçon que t’ont apporté ces 7 années. C'est sans doute la différence entre les seventies et les eighties, I’insouciance et la gravité, le rêve et la peur.
Gérard Courant
Les 33 phrases de mon CINEMATON JUIF (un grand moment de vérité) 1. J'avais eu le désir d'être filmé une deuxième fois 2. sept ans après 3. pour qu'on me reconnaisse 4. est-ce que je le désirais vraiment? 5. je me cache derrière ces feuilles 6. pourquoi ? 7. timidité ? orgueil ? bêtise ? excès de narcissisme? 8. et j'ai envie pourtant qu'on me voie 9. envie 10. il fait froid 11. l’image est-elle nette ? 12. ma bobine pour une cassette 13. est-ce que c’est du cinéma ? 14. cinéma-viol 15. ça va finir 16. finir 17. ça va bientôt finir et j’aurais loupé ma chance 18. je ne veux décidément pas qu’on me voie 19. Ia prochaine fois peut-être 20. peut-être plus jamais 21. en réalité vous ne faites que m'entendre 22. premier cinématon sonore 23. sans voix 24. combien de vérité là-dedans? 25. à 18 images par seconde 26. à une image près 27. un grand moment de vérité 28. écrit de ma main 29. devant le miroir 30. Ia lumière me rend aveugle 31. mon dieu le temps passe vite 32. avez-vous eu le temps de me voir? 33. est-ce qu'on me reconnaît? UN CINEMA DE L'AUTOBIOGRAPHIE Mauvaise conscience du cinéma belge, Boris Lehman transporte avec lui une image de cinéaste pur et dur que ni les chantages à l’argent ni l’argument terroriste du grand public et de ses prétendus intérêts ne peuvent infléchir dans sa demande expérimentale. Critique, musicien, habile rhétoricien, Lehman est pourtant le contraire d'un poète maudit. S’il parvient à persévérer dans la voie difficile qu’il s’est choisie, c’est que ce créateur timide se double par le jeu d’une dialectique surprenante, d’un homme d’affaire d’une détermination habilement modeste et surtout que sa recherche atteint souvent au fondamental, donnant à ses entreprises une solidité incontournable. Dans son exploration du monde de la folie, il a ramené une attention aux personnages qui fit la force des peintures urbaines dans lesquelles il poursuivait une expérience des limites du documentaire. Loin de jouer l’irritante hésitation fiction/reportage qui fait actuellement l’essentiel de la pseudo-réflexion sur le réalisme à l’écran (et surtout au petit écran), Lehman faisait au contraire surgir l’odeur de la fiction d'une intransigeance dans son approche du réel. Aujourd’hui, sa démarche s'est enrichie d’un pan narcissique qui n’a rien de paradoxal: si l’auteur se met en scène, ce n’est pas pour s’amuser d’un effet de vertige, mais tout simplement parce que le champ sincère de sa caméra omnipotente ne peut ignorer le metteur en scène lui-même. C’est ainsi que Lehman conserve sa place de leader dans la famille qu’il s’est constituée et au bénétice de laquelle il ouvre les chemins de l’autobiographie en tant que genre.
Philippe Reynaert
BORIS LEHMAN Homo Photographicus A l'occasion du cycle "Le tour de Boris Lehman en 80 bobines", qui aura lieu du 19 mars au 7 avril 2003 à Beaubourg, durant lequel notamment il commentera en direct tous ses inédits et films. Boris Lehman y présentera également le travail de ses amis et proches, de Beckett à Varda, en une quinzaine de films choisis par lui. Enfin, pour parachever le tour du cinéaste, on pourra également le voir jouer dans quelques films de Samy Szlingerbaum, Marie André, Christel Milhavet… Zakhor! / Souviens-toi! Deutéronome Sois fidèle jusqu’à la mort Apocalypse, II, 10 "La société s’emploie à assagir la Photographie, à tempérer la folie qui menace sans cesse d’exploser au visage de qui la regarde. Pour cela, elle a à sa disposition deux moyens. Le premier consiste à faire de la Photographie un art, car aucun art n’est fou (…) L’autre moyen d’assagir la Photographie, c’est de la généraliser, de la grégariser, de la banaliser, au point qu’il n’y ait plus en face d’elle aucune autre image à laquelle elle puisse se marquer, affirmer sa spécialité, son scandale, sa folie (…). Telles sont les deux voies de la Photographie. A moi de choisir, de soumettre son spectacle au code civilisé des illusions parfaites, ou d’affronter en elle le réveil de l’intraitable réalité "/ Roland Barthes, La chambre claire, Cahiers du Cinéma, Gallimard Seuil, 1980 Drôle de petit bonhomme, classant, déclassant follement, marchant, démarchant sans relâche ni éreintement. A la voix sûre, au timbre doux (d’une douceur presque enfantine), au nez aquilin, au regard perçant, à la silhouette tranquille: Boris Lehman, avant d’incarner l’une des démarches cinématographiques contemporaines parmi les plus stimulantes à observer et penser, est d’abord un corps remarquable et attachant auquel manque (mais il n’est pas le seul) terriblement (ça fait déjà moins de monde) l’image originelle d’entre toutes, celle de sa venue au monde avalisant (parce que Lehman se trouve être proche philosophiquement de Heidegger) son "être-pour-la-mort". C’est donc aussi l’autre image déjà manquante, la seule qu’il est certain de ne jamais voir de ses propres yeux, celle de "l’instant de sa mort" (Maurice Blanchot). La question que pose implicitement Lehman est celle-là: quel avenir pour ma mort? Conséquemment, parce qu’il ne veut rien perdre de sa vie (ni une dent, ni un cheveu, ni une photographie de lui, de ses amis, de gens qu’il ne connaît pas ou dont il ne se souvient plus), parce que sa vie s’origine dans la mémoire du Lager (ses parents ont été des rescapés des Camps), Boris Lehman est devenu le mémorialiste de sa propre existence fragmentée, démultipliée, objectivée par la technique photographique. Son œuvre: les archives mouvantes (littéralement il s’en imprègne comme d’une eau régénératrice, véritablement on aime s’y perdre) du Moi, son obsessionnelle récollection. (1) Une psychanalyse extensive sans psychanalyste. En quoi ce matériel peut appeler de l’altérité, susciter de la communauté, créer ou réactiver du lien ou du souvenir, rapprocher du loin comme éloigner du près dans l’espace comme dans le temps, c’est-à-dire produire du champ? Voilà les questions posées par les circulations lehmaniennes de la vie qui se présente, à l’image (de la vie) qui (la) représente. Mais il y a surtout cette question-là, axiale, cruciale: en quoi cette matérialisation du vécu (avec laquelle le cinéaste se vêt, dont il se nourrit) qui ne saurait mourir, que l’on ne saurait assassiner (encore des images, toujours des images pour dire ce que l’on cherche à réduire en cendres, en poussière, au silence), peut entretenir cette vérité fondamentale, à savoir que moi c’est tous les autres que moi en plus de ce moi qui, photographiquement, à chaque tirage photographique, devient toujours un autre? L’éthique du cinéaste, c’est un "Moi qui est un Nous", "un Nous qui est un Moi" car "la conscience de soi atteint sa satisfaction seulement dans une autre conscience de soi" (G. W. F. Hegel, La Phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier, 1992, vol.1, p.152-154). Trouble de l’image: qui est sur l’image? C’est un peu de perte consubstantielle aux mécanismes de la mémoire (la mort qui travaille) qui ne demande qu’à être comblée par l’aide d’un autre que moi: l’image réclame beaucoup de choses sauf de l’extrême solitude. Jouissance de l’image: celle de la reconnaissance. L’image interpelle, fait parler, rend le mouvement interne à la parole à la fixité ontologique de la photographie, plongeant l’instant capturé au cœur de la durée de laquelle la photographie l’avait précédemment extrait. Paradoxe : Boris Lehman est un pur cinéaste parce qu’il n’a besoin de l’image photographique que comme inducteur de la parole charriant des souvenirs et des émotions, des hésitations, des craintes et des tremblements que le plan cinématographique, dans toute sa durée, donne ou redonne à entendre et à lire dans les plis du corps parlant. L’instance du je et l’instance du tu, respectivement, échangent le jeu de leur flux réflexif. L’image cinématographique comme saisie réactive de l’affect pur vectorisé par la photographie. Rien de moins narcissique qu’une telle attitude fondant le champ de l’esthétique dans celui du social - qui, Lehman l’a bien compris, est un corps - et visant à l’avènement heureux d’un nous partagé. Quelque part entre Penser / classer de Georges Perec et les installations " mémoratives " de Christian Boltanski, Boris Lehman pratique en forme de donation pure et simple l’art d’un être-ensemble dont le présent du " Je me souviens " signe l’indéfectible promesse, sans finitude ni interruption permise tant qu’il y aura des femmes et des hommes pour faire de la mémoire le lieu vivant d’un collectif ne sachant ni dissoudre ni surexposer le sujet, d’un " Je me souviendrai " à venir. Contre l’autre promesse, paralysante celle-ci, et consignée par la photographie, celle de notre mort à venir. Contre les effets institutionnalisés d’amnésie ou de paramnésie produits massivement et continûment par les médias et les politiques de confiscation administrative (les archives introuvables), de réification silencieuse (les monuments) et de tintamarre annuel (les commémorations) d’une histoire murée qui ne doit pas finir par être le seul champ pratique des experts et des spécialistes (2). Contre enfin les obscurs promoteurs de la révision et de la négation idéologiques de la mémoire (Garaudy, Faurisson) comme de " la fin de l’histoire " moins hégélienne que néo-libérale (Fukuyama). "C’est la communauté elle-même qui est, rigoureusement parlant, le concept de la possibilité même d’un sujet de " se " subjectiver (…), [qui est] la représentation que se font les singuliers d’eux-mêmes (…) clivés par leurs auto-désignations. Toute violence, politique ou autre, s’origine dans les confusions entretenues sur cette violence première [celle de l’exercice communautaire] " (Mehdi Belhaj Kacem, De la Communauté virtuelle, Sens & Tonka, 2002, p. 11 et 15). La photographie comme passe-temps, passeuse de temps, gain de temps (préciosité acquise du temps photographique contre sa morne banalisation sous forme de fétichisation technique ou d’obéissance aux normes sociales et familiales), temps de la désignation et de la violence ritualisée et initiatique de celle-ci, temps non de la fascination mais du discours. Tels de petits cailloux blancs posés dans l’existentielle forêt de notre (sur)modernité, ceux scintillants (la photographie comme balise) d’un itinéraire de vie, qui les vaut toutes et que toutes valent, et qui se confond avec son geste de cinéma. Le geste de celui qui veut (qui peut?) tout connaître sauf sa propre fin. A jamais inachevable ce geste qui vise (et arrive) à substituer " l’être-pour-l’œuvre " (Babel, le chantier de toute sa vie) à " l’être-pour-la-mort " sur le modèle de Marcel Proust et de La Recherche. On imagine alors très bien le cinéaste commencer son œuvre en disant de sa voix si calme: " Longtemps j’ai photographié de bonne heure ". Mais comme Boris Lehman le dit lui-même très bien dans Histoire de ma vie racontée par mes photographies (1994-2001) que la chaîne Arte a eu la bienheureuse idée de diffuser cet été 2002, s’il fait sans cesse des photographies, il n’en est pas moins photographe. Plutôt le plus grand cinéaste vivant en Belgique avec Chantal Akerman (et dont la judéité commune innerve au plus haut point tous leurs travaux (3). Un Titan du Réel, un Atlas du Temps : le temps comme espace réel d’une parole abritée (le locus, le lieu) et d’un collectif réalisé (le rêve, forcément inavouable – Maurice Blanchot – d’une communauté au sens fort du terme), la croyance en un avenir retrouvé. Boris Lehman: site du réalisateur Centre Pompidou : Le tour de Boris Lehman en 80 bobines 1) A la différence d’un Romain Goupil par exemple qui, grâce aux films réalisés en super 16 mm. par son père lorsqu’il était jeune, disposait pour le seul Mourir à trente ans en 1982 d’une mémoire " médiate " (volontaire comme dirait Walter Benjamin) afin de relire à l’aune de ce matériel la fin douloureuse d’une époque, Boris Lehman est l’auteur intégral depuis une bonne cinquantaine d’années, avant même d’avoir envie d’en faire une œuvre de cinéma, de ce type de mémoire-là. 2) Sur ce point, nous nous permettons de conseiller de voir ou de revoir Eloge de l’amour (2001) de Jean-Luc Godard comme de renvoyer au livre de Jacques Derrida Le Mal d’archive (Galilée, Paris, 1995). 3) " Ce qui serait le moins juif, le plus " non-juif ", le plus hétérogène à la judéité, ce ne serait pas un manquement au judaïsme, un éloignement (…) mais la non-croyance en l’avenir – c’est-à-dire en ce qui constitue la judéité (jewishness) au-delà de tout judaïsme. Au-delà des précautions et des conditions, il y a donc là une affirmation soustraite à toute discussion à venir, une affirmation inconditionnelle: le lien entre la judéité, sinon le judaïsme, et l’espérance dans le futur " (Jacques Derrida, opus cité, p.117 et 118).
Par Saad CHAKALI et Violaine GIRARD
http://www.objectif-cinema.com/analyses/101.php BORIS LEHMAN, LE FILM A VENIR Nul ne peut prétendre avoir vu tous les films de Boris Lehman ni pouvoir en faire le compte. Pas même lui. Le chiffre de 300 a été prononcé il y a déjà quelques années. Incertain, il est de toute façon dépassé aujourd’hui. Nul ne peut prétendre pouvoir identifier, classer, ranger dans des catégories reconnues, acceptées, les dizaines de titres que l’on peut connaître. Tous les supports, tous les formats ont été utilisés, tous les genres pratiqués, toutes les durées (quelques secondes, plus de six heures). Nul ne peut affirmer avoir vu tel ou tel film, seulement une de ses versions – entre «l’inachèvement» (un fragment) et le surcroît (les rushes). Ni compris le sens de telle image ou tel objet, car ils peuvent revenir dans des films ultérieurs. Faut-il déduire de ces décourageantes affirmations, que l’œuvre de ce cinéaste est un chaos, une accumulation aléatoire, des flux incontrôlés? Nullement. D’abord, ces affirmations s’entendent par rapport à des catégories en usage dans le cinéma, des codes de classement (dictionnaires, encyclopédies, manuels, filmographies, registres professionnels, commissions d’aide au cinéma, unités de production télé, audiovisuelle ou multimédia…). Ensuite, Boris Lehman est le contraire d’un improvisateur, d’un sismographe. Simplement le principe d’ordonnancement de ses images et de ses sons, la logique de création qui est la sienne, les chemins qu’il emprunte, la collecte qu’il fait de ses matériaux, répondent à la fois à la plus grande liberté – puisqu’ils requièrent une disponibilité complète – et à la plus grande rigueur – car ils sont pensés, ruminés, élaborés. Le cinéma d’ordinaire, répond à des principes d’ordre qui sont extérieurs à la création proprement dite: celle-ci doit composer avec eux. Ce sont des contraintes: de récit, d’argent, de temps, de disponibilité des collaborateurs. On fait avec. La logique narrative emporte toutes les imprécisions, les bévues, les bavures, les aveuglements dans son «généreux» courant. On noie le poisson. Le cinéma que pratique Boris Lehman, à l’inverse, s’attache à des détails. Au lieu de soumettre son «sujet» à une structure narrative (le scénario!), celle-ci, sinueuse parfois, déployée ou au contraire très elliptique ou minimale, procède des matériaux, des situations et du sujet, développe les potentialités narratives, dramaturgiques qu’ils contiennent. Il sait aussi se donner des contraintes qu’aucun film industriel n’est en mesure de se donner. Par exemple, dans la Chute des heures, progresser dans le temps d’une journée (midi-minuit) en passant, dans l’espace donné d’une ville, d’une horloge à l’autre en ne disposant que de 15 mn d’intervalle. Exercice sans repentir, exercice d’équilibre. Ou, dans Couple, regards, positions, évoquer (en 60 min) les rapports érotiques d’un homme et d’une femme sans n’impliquer jamais les organes sexuels, ni même une étreinte. Exercice de déplacement et de fragmentation. Roman Schneid dans Symphonie (Soliloque) raconte et affabule sa vie de juif reclus pendant l’occupation allemande de Bruxelles. Pas une image extérieure à son énonciation et à la théâtralisation qu’il en donne. Chaque film exemplifie une contrainte particulière, celle que le matériau exige ou suggère – si tant est qu’on a quelque respect pour lui, qu’on ne le veut pas «à sa merci»! On est donc plutôt du côté de Snow, Straub, Frampton ou Nekes que d’Eastwood et tant d’autres. Le film a déjà commencé Boris Lehman porte toujours un ou plusieurs «prochains films» avec lui. Cette expression peut paraître légère:mais je n’ai pas écrit «en lui». Comme en témoignent Homme portant son film le plus lourd et Histoire de ma vie racontée par mes photographies, il s’agit souvent d’un portage très concret. Il en est qu’il a entrepris il y a plusieurs années et qui restent en chantier, d’autres qui sont envisagés et accomplis dans la même journée, d’autres qui se modifient pendant une année ou deux, au gré de projections à des amis et de discussions. On ne sait jamais ce qu’il fera des réactions dont on lui fait part dans ces cas-là, ni des lettres ou cartes ou e-mails qu’on lui envoie. Il écoute, il reçoit, il note, colle dans ses carnets et soudain les choses ressurgissent dans une configuration qu’on n’avait pas imaginée. La sienne. Cette variabilité sans fin de ses films, de ses projets se mesure ou s’éprouve également dans la résurgence d’images, d’objets, d’êtres, de thèmes d’un film à l’autre. C’est aussi pourquoi la projection de ses films devant un public n’a rien d’une abstraction (nombre de spectateurs? nombre de salles? nombre de semaines?): il s’agit de rencontres qui souvent changent le film. Celui-là ou un autre. Peut-être faut-il commencer par dire que, pour ce cinéaste, le film est engagé en entier, totalement, dès le projet, l’idée ou l’envie de le faire. Il n’y pas de scénario, de découpage comme autant d’étapes qui amèneront à la réalisation au gré d’accomplissements successifs, de commencements et de fins, de clôtures et de rebonds. L’industrie du cinéma et de la télévision se fonde sur ce cloisonnement où des personnes différentes peuvent se succéder sur un projet de film. Un/des scénaristes, un metteur en scène, une seconde équipe, un/des monteurs, mixeurs, musiciens, etc. On peut enjoliver cela en disant que le film «meurt et ressuscite» à chaque étape, mais on peut aussi demeurer dubitatif sur la fécondité d’un système ainsi fragmenté où il est, certes, un maître d’œuvre – le réalisateur (et encore: selon les régimes de production il est loin d’occuper toujours cette place!) –, mais qui doit négocier à chaque étape, jusqu’au laboratoire, jusqu’à la distribution de son film, une série de compromis. La même industrie a aujourd’hui trouvé le moyen de commercialiser ces blocages, repeints, sacrifices et autres en les offrant sur DVD au titre de boni, de suppléments, prétendant nous faire entrer dans le processus de production ou de création – ce qui implique la construction en béton d’un Auteur et l’escamotage de l’Autorité: l’auteur, bardé d’intentions qu’on réaliserait enfin en manipulant, après sa mort, le film qu’il avait signé dans des circonstances données, et l’oubli des rapports sociaux et des conflits qui organisaient ces circonstances. En janvier 1924, devant des étudiants à Montpellier, Epstein déplorait de ne pouvoir retoucher, corriger, faire des variantes d’une édition à l’autre du film (c’est-à-dire d’une projection à l’autre), de ne pouvoir continuer à «modeler son film au gré de son idée» continuer «à le créer». Avant même d’être achevé, le film nous est «enlevé». C’est là une économie, un mode de fabrication, comment pourrait-on «compléter» ou «achever» un film réalisé dans ces conditions sans le travestir une seconde fois? L’«idée» du film est le premier moment de la réalisation. Une telle affirmation ne doit pas être prise au sens métaphorique: c’est la situation dans laquelle se trouve Boris Lehman – ou celle où il se met – qui donne la chiquenaude initiale. Le film s’ensuit avec des régimes de réalité et de réalisation très divers: notes sur les carnets, collectes d’objets ou de traces, photos. Si les circonstances font qu’il y a une caméra, il pourra y avoir d’emblée image filmique, si l’un de ses complices en prise de son est de la partie, il y aura d’emblée du son. Au minimum une situation vécue, fortuitement: un repas chez des amis, un événement chez une connaissance (un bébé), une rencontre dans la rue enclenchent le mécanisme. Faute de caméra et de magnétophone, il y aura une photographie, ou bien on re-mettra en scène plus tard ce moment retenu. La prise d’un cliché isole un instant, le filmage un morceau de temps, la répétition engendre évidemment des distorsions, des ratages ou des déplacements. Il n’y a pas de redoublement: le film a commencé. Le film a donc toujours «déjà commencé» comme disait Maurice Lemaître (à propos de la projection); et, corrélativement, le film est toujours «à venir». La poétique de Boris Lehman s’exerce entre ces deux pôles et, pour cette raison, elle se fonde sur une certaine impossibilité, une échappée continuelle. A la fois on est confiant et tranquille puisque tout est film, on y est déjà, la vie fournit à chaque seconde la matière du film, et, à la fois on est lucide sur le fait de voir fuir ce qu’on cherche à fixer. On ne peut qu’arriver trop tard, revenir après-coup, on n’a affaire qu’au factice, au jeu. Mais ce factice est la condition du cinéma et de la vérité. Pour mieux comprendre l’ampleur de ce phénomène – encore une fois loin d’être une figure de style –, il faut prendre en compte le nomadisme du cinéaste – et peut-être aussi son monadisme. Hier, de passage à Paris, il arrive de Montréal où Daudelin l’a accueilli et New-York où Jonas Mekas a montré quelques-uns de ses films (qu’il emportait dans sa valise); il repart dans deux jours à Bruxelles et se rendra à Rotterdam avant Berlin. Le voyage comme principe de filmage, donne lieu à une série: Mes voyages, après des variations multiples (Ne pas stagner, Marcher, Babel…). Ce nomadisme accentue encore la précarité des projets, leur dispersion mais aussi – monadisme – leur unité de l’un à l’autre, car ils ne tiennent qu’à lui, il les emporte avec lui, y travaille sans cesse, où qu’il soit et les enrichit de ses déplacements. Un montage ininterrompu. Boris est un glâneur, il aurait pu figurer dans le film d’Agnès Varda: il récupère, il thésaurise, il squatte, il se faufile, insiste, s’incruste, disparaît sans avertir, revient par la fenêtre. Pourtant son cinéma ne ressemble pas à celui de Varda qui n’a pas son pareil pour finir ses films, ses séquences, les boucler élégamment en nous laissant heureux d’avoir vu ce qu’elle nous a montré, désormais attentif à des faits et gestes qu’elle a relevés. Boris ne boucle pas, il n’est pas un cinéaste «heureux» qui achève son œuvre à chaque film, au contraire. Ce n’est pas que le film lui échappe, mais il est infini: Babel, 6 heures, Mes entretiens filmés 6 heures 1/2., Magnum Begynasium Bruxellense, 2 heures 1/2, Histoire de ma vie racontée par mes photographies, 3 heures 50, etc. Tout film est le film d’une difficulté voire d’une impossibilité à commencer (Portrait du peintre dans son atelier: le geste suspendu devant la toile, l’élan, l’amorce du geste, on frôle la toile, rien ne s’y inscrit). Le film ne peut pas finir ou sa fin est un re-commencement: A la recherche du lieu de ma naissance, film kaléidoscope où se mêlent les temps dans un présent de narration: la naissance – une naissance, puisqu’il est trop tard pour avoir filmée la sienne; la circoncision – une circoncision; l’enfance – une enfance; la première brasse… On cherche à reconstruire cette mémoire enfuie, qu’on n’a jamais eue. En interrogeant un témoin, en interrogeant des papiers, des cartes, des visas. C’est le cinéma du sujet en quête de lui-même, jamais là où il se cherche, éclaté ou qui s’échappe. Plus il y a de traces, plus le tracé s’obscurcit, plus on a de précision, plus le portrait devient compliqué, part de tout côté. A la fin tout recommence, on repart à reculons. Ceci est mon corps. Peut-on parler de la supériorité du cinéma improprement appelé «à la première personne» – que, quelques temps, l’art-video a relayé, généralisé – sur la littérature qui dit JE? L’ambiguïté du pronom personnel – qui n’est que langage, «c’est donc l’autre, c’est lui, c’est toi, et c’est”moi”en tant que IL… JE n’a pas de référent. JE est un outil grammatical dont la fonction principale est d’être sujet de verbe…»(Daniel Oster) – n’y a pas lieu d’être. Le cinéaste qui se filme ne dit pas JE, il se filme comme un autre, fatalement, il est le premier surpris de l’image de ce «soi» qui est autre que le «je» qui a décidé de «se» filmer, qui, en esprit, a une idée cohérente, une image de lui ou qui croit en offrir une «pour-autrui». D’abord le film, la photo le représente comme un corps matériel dans l’espace, parmi les choses et les êtres, tandis que le «moi» «intérieur» est in-corporel, incorporé. «Mille fois Valéry fait remarquer avec agacement que c’est le même mot qui sert pour dire”mon”chapeau, ou bien”mon” corps, ou”mon”idée,”mon” passé,”mon” être. Usages ridicules. Le mot MOI fuit devant la recherche qu’il fait de soi-même.”(Cahiers, XIX, 772)» (Daniel Oster). Le cinéma traverse ces paradoxes en mettant d’évidence un signe d’égalité entre «mon» chapeau et «mon» corps. Il évince, par nature, l’intériorité de la littérature et périme la phénomènologie qui parle de l’«expérience du corps», quand c’est au «moi» qu’elle a affaire. Le corps filmé, fût-il celui du cinéaste, fait disparaître le «moi». Disparition élocutoire du poète. Qu’il (re)prenne la parole pour le restaurer, il ne fait percevoir qu’un dissensus. L’épreuve de la photographie. Le cinéma lehmanien met de telles convictions, de telle croyances à l’épreuve, en particulier dans Histoire de ma vie…: c’est le corps «à l’épreuve de la photographie». D’abord dans la représentation, en «se» filmant. Le corps du cinéaste est soumis à une série d’épreuves physiques, d’exercices, d’obstacles: on le voit juché sur une colonne de boîtes de films ou au contraire portant des bobines, écrasé par elles, exploré par la caméra médicale jusque dans l’œsophage,on lui écarquille les yeux. Il se livre aux techniciens du corps: chirurgien, dentiste, ophtalmologiste… Le corps anatomique, physiologique a une histoire dans le cinéma: Marey, Vertov, et dans une certaine mesure tout le cinéma comique (Rigadin, Chaplin…) et d’aventure (Fairbanks, Flynn, Belmondo), c’est un corps fonctionnel, mécanique, que l’on peut fragmenter, c’est le corps «moderne» qui est tout extériorité. Ce corps filmé que nous livre la pellicule, combien se sont essayés à l’ouvrir, en soulever les voiles donnant sur l’âme, l’aura, la photogénie, l’invisible, en faire un corps «expressif». Boris Lehman, parce qu’il est devant l’impossible, l’échec à représenter, nous montre ce corps-apparence, opaque, cette marionnette mais il ne ne se borne pas à nous démontrer que fendu, trituré, brûlé, il n’ouvrira sur rien (l’Homme de terre, impossible Golem). Par déplacement sur la parole ou les gestes des autres, les objets, les paysages muets, il parvient à convoquer le «corps d’enfance, le corps imaginaire du désir» (Fédida) – repérez les scènes de bain, d’eau, d’allègement ou, à l’autre bout, de fécondation, génération ou mise au monde. Corps déployé, «objectivé», exporté, dépris de ses affects, de ce qui serait de l’ordre de la confession et donc de la construction imaginaire du «Moi», déplacé dans le regard ou le discours des autres, distribués dans tout un monde de proches ou d’étrangers qui le renvoient en mille facettes.
François Albéra
LE COLPORTEUR Il est des metteurs en scène dont on ne connaît pas le visage, tant le mouvement du cinéma les pousse à disparaître dans les limbes inatteignables du hors champ. Il en est d’autres qui aiment se glisser dans leurs films, le temps d’une scène, d’un clin d’oeil, d’un reflet de miroir. Il en est certains, enfin, qui occupent le cadre, l’arpentent, cherchent à fixer leur image dans le flux à remous d’un lieu et d’une époque. Boris Lehman est de ces “faiseur de films” (filmmaker), qui fabrique ses propres souvenirs avec et pour le cinéma. Et si l’idée lui vient parfois de redevenir un enfant vierge de toute histoire (enfilant son bonnet de bain, il joue à usurper la place du petit-fils de son amie A comme Adrienne ), il ne faut prêter à Lehman aucune naïveté mal placée. Il sait que le cinéma sculpte la vie, organise le quotidien, transforme le précaire en récit immortel. Il sait que la mécanique spirituelle de la caméra a pour vocation ontologique de faire de la fiction, et que le prédicat consistant à croire qu’il est possible de se contenter d’enregistrer “ce qu’il a devant ses yeux” est un leurre. L’artifice s’installe. Des dispositifs aussi: Lehman nu serré par des bandelettes de pellicule (le devenir égyptien du cinéma dont parlait déjà Bazin), mangeant des bouts de photos servies dans une assiette, ou projetant des bouts de films sur son corps nu-écran. Ce dernier dispositif vire alors au happening flamboyant. L’image projetée ploie sous les flammes, laissant croire, par un jeu de surimpression, à la désagrégation du “faiseur de films”. Pourtant, même cerné de longues traînées brûlantes, son visage reste intact. Lehman illusionniste, met en scène sa (fausse) destruction, convaincu que le cinéma lui donnera l’éternité, et le protégera des déflagrations du monde. Son oeuvre est une bulle permettant la survivance de motifs affectifs (photo, emblème, cheveu, ride), et empêchant l’absence et le manque de s’installer. Ce que Lehman colporte sur les routes européennes, américaines ou mexicaines, c’est la croyance dans un éternel recommencement des images: éternellement filmées, éternellement montrées, éternellement rencontrées. Ces images compilées en films, unis par des chaînes invisibles, construisent in fine une sorte de Filmer’s Digest hétérogène. Un plan en attire un autre, comme la mise bout à bout de perles organiques, que viennent scander des leitmotivs, intertitres ou visage de Lehman dans son bain moussant, revisitation de l’antique Diogène dans son tonneau. La figure du regardé et du regardeur se confondent à tel point que le spectateur finit lui-même par “se lehmaniser”. Vampirisme? Schizophrénie? Ces jeux de miroir qu’exaspèrent les revirements de caméra (braquées à l’endroit, à l’envers, sans que l’on sache si le sujet est dans le clap off, le visage en gros plan, ou les images latentes du passé perdu - il tient dans la coexistence des trois), créent un chamboulement de l’ordre habituellement établi par la doxa cinématographique, visant à installer Lehman dans une intimité particulière avec ceux que son cinéma regarde et ceux qui regardent son cinéma. Ainsi, interviewe-t-il dans Mes entretiens filmés aussi bien son chef opérateur, son monteur, qu’un directeur de cinémathèque, un critique de cinéma, ou un spectateur de ses films (peut-être serez-vous le suivant?). Tous sont sa famille de substitution. Lehman s’en approche, s’en détache, se filme avec eux ou pas, en extérieur ou pas, selon les aléas de ses itinéraires. Il montre brièvement leur quotidien, avant de les rendre captifs de ses interrogations incessantes, qui viennent traquer, dans les expressions du visage ou les modulations de la voix, le symptôme d’une vérité. Jusqu’à venir s’interroger lui-même. Qui “lui-même”? Quel masque pour quelle autobiographie décalée? Le comédien qui interprète, le personnage keatonesque, le “faiseur de films”, le juif errant? La colombe (“dove” en anglais) ou l’ours (“dov” en hébreu)? Le contemplateur de la ruine qui fragmente ou de l’infini qui s’installe? Entre apparition et disparition, ici et ailleurs, Lehman joue avec le temps, à la fois son allié et son ennemi. Après avoir évoqué, à Porto, avec ses amis Saguenail et Corbe, l’idée d’un temps mythique, il s’amuse, dans l’entretien suivant (Mes entretiens filmés, deuxième partie), à tapoter le petit sablier qu’utilise la psychanalyste Rachel Fajersztajn pour cuire ses oeufs. Lehman apprivoise le temps selon des angles d’attaque différents, et réactive son objet d’un bord à l’autre de la mosaïque filmique. L’ironie succède à la poésie, la blague à l’essai, sans perdre de vue l’idée centrale : une scène filmée est une image du filmage. L’espace est une image du temps, le voyage une image de l’anamnèse. Toutes les villes visitées, filmées comme une suite de cabinets privés, de bureaux, d’ateliers se ressemblent toutes, et ne donnent plus à penser un réel déplacement géographique. D’où cette impression de surplace: la vraie progression se fait avec le film qui s’écoule, et jamais par ses itérations qui l’amènent de Moscou à Paris en passant par Cologne, Dunkerque, ou Porto. Dans ses derniers opus, Lehman épuise les lieux au point d’annuler toute dynamique spatiale: les cartes postales remplacent les travellings urbains, les récits remplacent les voyages. L’environnement devient progressivement atopique. La deuxième partie de A comme Adrienne nous fait alors pénétrer en Iran par le seul jeu des sons (intonations mélodieuses, musiques sacrées, citations persanes), et du temps en puissance qui les habite. En somme, le mouvement s’est intériorisé, et concerne exclusivement le passage des figures (humaines ou pas) dans le temps du film. Erreur serait de voir en Lehman un obsédé du passé. Son cinéma s’est vidé de toute nostalgie, même quand il va sur la tombe de ses parents ou quand il affirme: “Il y a des lieux dont je me souviendrai toute ma vie”. Sa mise en scène travaille la frontalité, pas la résurgence incertaine et vaporeuse de souvenirs virant à l’onirisme. Méthodique, son expérience du monde est celle d’un encyclopédiste, plus intéressé par la reproduction et l’organisation du réel que par le magnétisme des fantômes qui nous entourent (dans tel lieu, dans telle photo). D’où son intérêt pour les mécaniques et les mécaniciens : optométriste, photographe, réparateur... Pour autant, cette “frontalité”, ce “pragmatisme” mène Lehman à une énergie vitale transcendantale. Un au-delà qui n’a rien de religieux (même si Robert Kramer et Stephen Dowskin s’amusent à le comparer à un rabbin, dans Mes entretiens filmés, deuxième partie) : au contraire, un au-delà de la pensée (une philosophie en image), un au-delà de l’affect (un amour absolu, avec l’altérité comme seul horizon). Ses films observent le monde, avec cette croyance que le réel délivrera à celui qui le regarde, puis le capte, une énergie capable de braver la finitude qui le menace. Avec Lehman, on oscille donc, aussi étrange que cela puisse paraître, entre le rationalisme le plus forcené et l’animisme le plus dévot, sans transiter par aucune figure tutélaire. Ses visiteurs sont tout entier avec lui dans l’immanence de la discussion, préliminaire suprême à la réconciliation avec l’univers, qui reste, par essence, une figure du chaos. D’ailleurs le “faiseur de film” ne parlera, il l’avoue, que de bonheur, jamais de malheur. “Rien que le bonheur léger de l’amateur insouciant”. Pas de nazis, d’hôpitaux, de Cuba, de Moscou, d’Israël. Un champ restreint (Bruxelles, des quais de gare presque vides, des troncs d’arbres entr’aperçus, des lieux intimes disséminés dans quelques grandes capitales) lui permet d’expérimenter toutes les aventures, sans parabole, et sans cascadeurs. “Mes acteurs sont dans mon carnet d’adresse”, dit-il, en nous montrant ses notes et ses griffonnages. L’écriture est, avec la discussion, une technique de travail pour l’ethnographe athée, portant en lui le désir de donner au temps et à l’image mouvante une stabilité. Peu à peu, Lehman ne fait alors plus que des plans fixes, mais des plans fixes qui n’ont jamais été aussi (é)mouvants. De là, son goût pour les rituels du familier, ceux que chacun crée avec discrétion dans l’espace clos de son habitat. Il ne s’agit pas là d’une gestuelle symbolique. Juste du comment vernaculaire des choses. Ainsi Adrienne mettant la table ou lavant le riz, Ulrich Gregor devant l’écran de son ordinateur, Claudia von Aleman postée devant une photo grand format représentant sa fille. Le familier de Lehman, lui, a quelque chose de démesuré. Derrière le puzzle morcelé de sa vie, se cache une figure géante, celle d’une oeuvre “babelienne”, englobant toutes les strates de l’existence. Cette oeuvre est à la fois sa raison (comme on dirait un film raisonné - on le dit bien pour un catalogue), et sa folie. Lehman, dans une sorte de discours sauvage dont on ne saurait jauger le degré de parodie, dit que “personne ne l’écoute, ne l’entend, alors qu’il dit des choses importantes ”. Son délire de persécution le conduit à voir dans sa caméra sa “camisole de force”. Alors, héros luttant pour sa liberté ou burlesque jouant avec les mots? Nul doute en tout cas, que Lehman joue avec les images, injecte des redites, échos, coïncidences bizarres. D’un plan (en couleurs) d’une femme nue dans une baignoire, on glisse vers une photographie (en noir et blanc) d’une femme nue dans un ruisseau (Histoire de ma vie racontée par mes photographies). Cette photographie bouge, emportée par un coup de vent miraculeux: c’est un de ces dispositifs où Lehman donne de la vie à ces choses que le néophyte voit inanimées, mais qui sont pour lui une “seconde peau”, une trame dont le pouls peut devenir tempête. Au cinéma, le vent souffle où il veut, et des correspondances se soulèvent, s’exaspèrent, telles des vagues menaçantes. Il y a dans Babel (son film fleuve de 1991) quelque chose de l’Atlantide : un royaume souterrain (intérieur), englouti (passé et restitué sur l’écran), vaste (terrain de rencontres multiples et connexes), majestueux et détruit (riche et sans argent). Lehman est un autarcique, ayant organisé son système-cinéma en lonesome cow-boy. D’ailleurs, pour voir son travail, il suffit d’appeler le “faiseur de films” à Bruxelles, ou de le happer dans la rue (tous les bruxellois vous le diront, il est l’éternel rencontré), pour organiser chez vous un home cinema sans effusion high-tech. Vous louez un projecteur, et Lehman se déplace pour vous montrer son oeuvre et venir à votre rencontre. De ce “cinéma en chambre”, ressort une impression mêlée de complot rivettien et de précarité. Arrachés au néant, ses films vibrent d’avoir su trouver de la lumière, d’avoir su persévérer dans un contexte accidenté et escarpé, voire même hostile vs. le cinéma de masse, le cinéma de consommation, le cinéma des multiplexes. Chaque plan dure longtemps, hésite à se terminer parce qu’il est peut-être le dernier qu’on saura filmer (la menace, proférée par Lehman lui-même, de ne plus tourner de films hante son cinéma). Le spectateur s’installe dans cette urgence qui rend finalement possible la restitution d’un présent et d’une présence, l’artisanat ayant réussi à soustraire son cinéma à la tentation des apparences clinquantes du romanesque. Et c’est humblement que Lehman nous donne à contempler une victoire. Une victoire improvisée et nomade qui n’aura gagné aucun territoire ni aucun trophée. Mais qui aura reconduit le désir frétillant de faire de la métaphysique en images et en sons, dans ce labyrinthe de courses, de surgissements et d’utopies (le Film Idéal comme une Cité Radieuse). L’inventaire devient une archéologie amoureuse, à la recherche d’indices, ayant précipité le temps, d’instantanés ordinaires et extraordinaires, qui le ballottent entre son envie scientifique d’archiver et son envie d’incarnations plastiques fortes et de métaphores visuelles, jusqu’à imaginer faire l’amour à la peloche! Lehman a sauvegardé ce que d’autres ont besoin de la mystique pour sauver: le Tout d’une dérive passionnée où les digressions des autres sont la fiction de votre propre réconciliation avec le réel.
Matthieu Orléan
Yellow Now asbl: 15 rue François Gilon - B-4367 Crisnée - TEL: 32 19 67 77 35
guy.jungblut@teledisnet.be
Autoportrait Babel, 1985-1991 - Histoire de ma vie, 1994-2002, ouvrons la boîte; Nadine Wandel deux fois; ombre, Couple, Regards, Positions. Rue Antoine Labarre, À la recherche du lieu de ma naissance, photo de classe, école numéro 13, Schaerbeek... Chez Henri Storck, Boris au Havre, carnet d'adresses, je parle espagnol; Boris et Norstein à Moscou, Mes voyages filmés, six polaroïds, Samy dans la baignoire, Hadelin Trinon, Gérard Courant, club Antonin Artaud, J'ai peur. B comme Boris. Boris au piano, au Mexique, dans son bain, à la gare du Midi, à la mer, mangeant des glaces à Locarno, dans le coffre d'une voiture, dans la photocopieuse, en homme de terre, au cimetière juif, croix gammée.
Avis de changement d'adresse, Ici va vivre le cinéaste Boris Lehman, Doden Worden, tourner, tourner, tourner (la page et le film)... Boris et quelques autres, beaucoup d'autres. Un projet, un film, quelques repentirs, un épilogue. Une grosse poignée d'images (et d'amis). Un autoportrait? Cinéaste presque belge né à Lausanne en 1944. pianiste et piéton, projectionniste et prestidigitateur, Boris Lehman a réalisé, produit et diffusé tous ses films de façon artisanale: innombrables, courts et longs métrages,documentaires, fictions, essais et expérimentations, autobiographies, journaux... Il a publié chez Yellow Now Lettre à mes amis restés en Belgique (Babel) en 1991. Douze ans après, fidèles, ses amis savaient bien qu'il reviendrait.
Emmanuel d'Autroppe
Boris Lehman: le cinéma d’exister Comment nomme-t-on cet art consistant à faire de sa vie une œuvre d’art? Boris Lehman, au fil de sa vie, nous confie le film d’une existence. C’est un film toujours à faire, toujours à refaire, d’avatar en avatar, réplique permanente et cinglante à son double argentique de lumière translucide, tel un acte d’amour toujours unique et pourtant infiniment répété. Est-ce une philosophie? Assurément: mettre en évidence, en mémoire et en œuvre d’art le fait même de vivre, de penser, de créer, c’est faire œuvre d’Homme debout, d’Homme portant, d’Homme marchant, d’Homme filmant dans la grande tradition du sage traversant, questionnant l’existence, perpétuellement la reconsidérant, la reconstituant même, malgré tous les aléas inhérents à l’imperfection et à l’impermanence des choses. Aussi, la sacro-sainte et fausse dualité réalité/ fiction vole-t-elle ainsi en éclats pour nous permettre de cerner, d’appréhender l’indicible vital: cela qui se construit toujours au-delà du visible et de l’audible, derrière le voile noir des apparences, sur la toile encore vierge de l’écran. Un film de Boris Lehman, c’est une projection à l’envers, une identification notoire de la désidentification du poète, un acte de philosophe passé au crible; à l’épreuve du réel et de son double : le film en soi, toujours fait, toujours refait, émergeant tant au dehors de soi (en la projection) qu’au plus profond de soi (en l’introspection). Boris Lehman connaît quelques secrets de l’existence, c’est manifeste. Son expérience développe la pellicule et le sens, nous laisse un goût de sel d’argent sur les lèvres. Il filme et nous filme en flammes de vie non pas dans les images (comme on écrit dans le texte), mais entre les images (comme on lit entre les lignes). L’art majeur du film n’est-il pas d’élaborer une relation entre les images, entre les sons, dans cette matrice interstitielle passablement inconsciente, de ce qui survient, de ce qui advient de plus authentique en l’irruption de ce que la vie a de plus subtil et de fondamental : l’invisible, l’inaudible, cela qui ne se perçoit et ne se transmet que d’un état particulier à un autre état particulier, d’un point sensible à un autre point sensible, comme à 1600 ASA trois fois au-delà de tout langage articulé, dans cette langue universelle et singulière du sujet enfin révélé : le subjectif rare, éminemment vivant, au-delà même du banal objectif de verre trop poli pour être honnête. Dans l’extrême et ultime démarche d’un cinéma historique à jamais voulu tel quel, trace fameuse d’une ère sensible de l’humanité, pellicule 16 mm, caméra Coutant Eclair 16 et magnétophone Nagra Kudelski, acteurs humains très humains, Boris Lehman résiste à toute forme de numérisation réductrice de la pensée et de ses supports : peinture contre télévision, photographie contre pixels, toile d’écran contre vitre cathodique, analogique sonore contre digital bits. Il ne s’agit pas d’un combat d’arrière-garde, mais d’une position de principe d’ordre éthique face à l’accomplissement d’une œuvre d’ores et déjà inscrite dans l’histoire du cinéma et de ses techniques. Qui osera prétendre, en cet écrit même, que la typographie n’a plus rien à donner à l’imprimerie? Le geste, le regard, la parole sont d’abord analogiques et aucune traduction numérique ne restituera l’ensemble des possibles que recèle l’humanité profonde. Boris Lehman va furieusement et obstinément à l’encontre de toute réduction à l’état d’objet : son cinéma donne ses lettres de noblesse au sujet infiniment suggéré, superbement subjectif, fait cracher son sang bleu à cette vérité nécessairement toujours voilée, aléatoire, incertaine, passagère. Le cinéma de Boris Lehman, c’est cela qui dérange, qui déroute, qui détourne le sens même, car cela dit vrai, sonne juste et jure l’authentique: voilà qui est insupportable dans un monde dominé par le faux, le semblant, la manipulation, le mensonge. Le cinéma-sujet, à l’encontre du cinéma-objet : c’est Eros contre Thanatos. Une partie terrible se joue dans les films de Boris Lehman : c’est la vie elle-même, sans fard, sans la moindre trace de compromission. C’est inadmissible. C’est intolérable. D’aucuns souhaiteraient voir ce cinéma ne pas exister, mais en faire exclure la poésie, c’est exterminer l’Homme qui porte en lui le sublime de l’existence. Qui donc est déjà mort, ici? La question est insupportable. La réponse est dans le cinéma rare, unique, de Boris Lehman.
Jacques DAPOZ
texte Rhizome Essai Après Babel
Un intellectuel m’a dit que «rhizome» ferait penser à Deleuze. Je lui ai demandé ce que Deleuze a dit, il n’a pas su me répondre. Je ne m’appelle pas Boris Lehman. Je ne suis pas né à Lausanne quoique ma famille vienne de Lausanne. Je ne suis pas de parents inconnus, quoique je ne ressente rien pour ceux qui m’ont engendrés, parce qu’ils sont de ma famille et non pas de ma Famille. Ils sont juste ceux qui m’ont introduit dans le Camp d’Existence, qu’on appelle plus communément et symplement la vie (symphonie) - transit Je ne suis pas errant comme aux 4 coins de monde. J’ai castré - (narcisse) cette errance de ma vie il y a 10 ans. Si tu veux trouver ton équilibre, me suis-je ordonné, il faut que tu cesses de partir, de fuir, de tant fuir, jusqu’à ce que tu ne voyages que pour ton travail. Il faut te dire, Brice, que je partais seul, en auto-stop, comme un drogué, mais je n’ai pas réussi à stopper mon errance. Je erre dans Paris ~ Je suis un nomade dans ma propre ville. Mon appartement est un grenier qu’une grand -mère que je n’ai pas aurait pu me prêter. Je n’ai rien installé, rien repeint, rien rangé, rien réparé. J’ y viens comme dans un refuge, je rêve que je le range, qu’il deviendra présentable. Je rêve de partir mais je suis rivé. Je suis rivé au monde qui me suit partout où je vais. Oui. Babel. Depuis Babel, je suis Boric Bansman, Boris Banse. Eris Behman, Ton corps dans mes positions pendant 7 heures, devant ton film dans un ennui fasciné, devant tma création, tma vie, aussi peu la mienne que la tienne. Notre entre tient là où tu es moi si tu me parles de toi. Partout sur les zones ignorées par toi et travaillées par moi, cryptées par toi et hacharnellement étudiées par moi, mon « mon langage n’est pas un langage ». Tu es le maître d’œuvre d'un pont plus grand que celui qui relie l’Europe à l’Asie, celui qui passe au dessus du monde normalisé pour rejoindre la côte de Terra Incognita, là où le normal ne vit pas, où les routes sont toujours en train d’être tracées, où la tempête d’angoisse, le quotidien comme des animaux, des millions de cafards. Père. Père c’est le pont. Celui sur lequel on marche là où on a papier, celui qui a construit de ses mains des zones pavillonnées, passables gués . J’ai enfin les pieds sur tma terre. Ça ne me soulage pas, c’est tmon froncement . Dieu qui me l’appelle cette restriction, l’appelle, nous devons faire la jonction, les travaux ne doivent pas cesser, qui que tu appelles, ki ke tu ta pel. Il me faut les plans les références les listes de moi. C’est sur un quai que je te rencontre toujours sur un quai de la côte qui borde le continent inconnu, toujours au retour de quelque part. Mais témoigner de ce quelque part en dehors de la diffraction d‘un film, d’un écrit ou d’une peinture semble impossible. Il faut toujours parler par miroirs interposés. Même si devant moi dans ton film tu te déshabilles, tout se passe comme si ce vécu n’était pas une étape, comme si, quand nous nous retrouvons face à face, tu doutais que je l’ai vu et que je doutais que tu l’ais fait. Pourtant ta nudité face à cette caméra signifie autre chose que de se montrer nu au cinéma, autre chose que de créer une oeuvre d’art, elle devrait nous mener là où seuls les esprits en fusion peuvent aller, les amoureux par exemple, ou ceux qui sont reliés par de grandes catastrophes, ceux dont le besoin de communiquer dépasse la peur qu’ils ont d’être pris , mangé, attrapé par l'autre. C’est ce qu’il ne faut pas dire qui nous relie tout le monde, plus intimement encore que Babel ou Tentative de se décrire, c’est tentative de se dévoiler entièrement, scientifiquement. C’est entre les corps que l’intervalle est infranchissable ou plutôt infranchi, Tout se passe comme si nous ne pouvions plus sans l’intermission de la pellicule être un seul, peut être parce que pour me diffuser vers toi je ne possède qu’un seul outil et c’est le même que pour acheter du pain ou faire l’amour. C’est ce qui tme brouille peut être. Au moment de l’émission de moi-même à l’extérieur, de la projection, tout se délite, ma monnaie n’a plus cours. Elle est broyée par ce que mes mots et mes attitudes traduisent et par ce qui sera interprété. Le pont n’est plus, détruit, ou n’existant pas à cet endroit. Je suis ici jugé comme un sauvage, inapte à la construction, à l’abstraction, quand c'est symplement mon système de valeur qui est ici sans valeur; mon intérêt sans intérêt, mon ordre désordre. Tu apparais dans ce faux chaos comme un phare (construction signifiant l’existence d’un réseau qui, sans me connaître, ne veut pas que je m’échoue. Rizhome fin y li xa svai saw
Eric Banse, avril 2003
Je dis Boris Lehman et ma pensée va tout de suite vers une phrase de Michelangelo Antonioni : “Faire un film est pour moi vivre.”
Je redis Boris Lehman et, en y réfléchissant mieux, je crois que la même phrase devrait être reformulée de cette manière : “Vivre est pour moi faire un film.”
Les deux phrases semblent égales en apparence ; la seconde se dirait le résultat d’un petit jeu de mots, d’une simple inversion syntaxique de la première. En réalité ce n’est pas ainsi, leur différence est substantielle: ce qui dans la première phrase est le sujet, devient dans la seconde le prédicat. Si pour Antonioni “faire un film” est source de nourriture vitale, une manière de se sentir vivre, pour Lehman ce n’est ni plus ni moins que la vie même, c’est à dire la vie entière comme récit de son propre être dans le monde.
La première est une phrase célèbre, la seconde ne l’est pas (du moins pas pour l’instant – et je ne sais pas si elle pourrait le devenir), non pas parce qu’elle se réfère à une personne non digne d’être remarquée – Boris Lehman est une persone digne d’être remarquée – mais parce qu’elle naît dans ma pensée au moment même où je l’écris, comme le cinéma de Boris Lehman qui naît, lui aussi, naturellement et presque instantanément avec sa pensée. Naturel comme se lever le matin, se laver, s’habiller, sortir, aller travailler… et ainsi, jour après jour, quotidiennement. Ce cinéma “pratique quotidienne” me rappelle la manière de travailler de Alberto Moravia : chaque matin à son bureau, de neuf à douze, à l’image d’un “employé” zélé de la littérature. Mais, dans sa manière de vivre en se racontant, Boris est peut-être plus proche de Pessoa que de Moravia. Le Pessoa hétéronyme, l’employé Bernardo Soares qui, sans jamais s’éloigner de son comptoir haut et étroit d’une agence de transports, remplit jour après jour les pages de son journal intime, de son livre de l’intranquillité. Plus proche aussi de Pessoa par le pessimisme mélancolique et un peu fataliste de son regard sur le monde duquel cependant il se détache en partie grâce à son auto-ironie compatissante, à laquelle il ne peut renoncer et qui lui vient tout droit de ses origines hébraïques.
Présent, passé, futur, extérieur, intérieur, réel, imaginaire, publique, privé: tout se retrouve et se fond avec une grande désinvolture et spontanéité dans le cinéma de Boris Lehman où chaque plan est toujours le résultat du choix du parcours le plus simple et le plus direct, sans pourtant être banal, sans recourir à aucune réthorique ni expédient pour signaler le passage d’un contexte à l’autre. S’offre alors au spectateur l’opportunité de suivre le libre cours des pensées et des sensations de l’auteur de manière à ce que celles-ci puissent être vécues dans une sorte d’identification sans trop d’intermédiaire. Et le tout sur une double voie : la voie phénoménologique (l’histoire) et la voie conceptuelle (les réflexions sur l’histoire). Les personnes, les objets et leur rapport métonymique avec les pensées mais surtout avec les sentiments: fragments épars qui vont s’organiser pour composer cette constellation mystérieuse et imprévisible des actes, des pensées, des sensations, des émotions, des sentiments qu’est la vie. Le film est ainsi diégèse dans la diégèse : film et, en même temps, film en train de se faire dans un sorte de making of du film même.
Je pense qu’en tournant son film, Boris ne reproduit pas mais “produit” sa propre vie. Dans un processus d’inversion chronologique-causale qui frise le paradoxe, le film peut être lu comme scénario en train de se faire de l’existence de son propre auteur. Voilà ainsi devoilé le vrai sens de “vivre est pour moi faire un film” : le cinéma devient l’acte générateur de la vie de son auteur. Double créativité? Créer une narration à travers la création de soi en train de (se) raconter?
Ce choix de construction en abîme est un aspect, à mon avis, parmi les plus intéressants et originaux du cinéma de Boris Lehman. C’est pour cela qu’il sort si facilement des standards linguistiques, narratifs, dramaturgiques et temporels du cinéma traditionnel dans une découverte naturelle du langage cinématographique comme protolangage tout court de l’homme : dans l’interprétation du monde (connaissance), dans le rapport à cette interprétation (conscience) et dans le rapport avec soi-même dans l’acte d’interpréter (autoconscience). Mais il n’a rien ce cinéma de la (dés)organisation chaotique apparente du flux de conscience : il est moderne mais sans suivre aucune mode. Il est moderne dans le sens qu’il est présent à lui-même, au temps de son propre devenir ; qu’il naît et se situe dans le temps présent ; qu’il est instantané, dans toute l’intensité expressive de l’instantané, sans être pour autant ni un “snapshot“ ni un “instant movie” car il s’inscrit dans un environnement sans temps, où le temps semble vraiment ne pas couler mais se coaguler dans un instant unique, et où, au contraire, l’espace s’étend et englobe tout, comprend tout. Il est le cinéma de la “compréhension”, vorace dans le vouloir tout englober et, dans le même temps et pour cette raison, destiné (et avec lui son auteur) à la fagocitation de la part de l’autre, du tout, du monde, qui induit une sorte de jeu (auto)cannibalistique à la fois (auto)ironique et cruel. S’explique ainsi comment et pourquoi l’auteur-acteur devient une figure christique soit dans l’action de se construire dans un rapport d’identité entre père et fils, soit dans le sens plus eucharistique du terme, c’est à dire dans l’acte de donner son propre corps et sa propre âme en repas à l’autre.
Au-delà de la structure binaire fondatrice “évènement-pensée”, il y a dans ses films également une structure ternaire (mais il serait mieux dire trinitaire) sous-jacente : Boris Lehman dans sa vie, Boris Lehman dans ses films (c’est à dire toujours dans sa vie) et le film même qui sert d’intermédiaire dans cette dialectique spéculaire. Dialectique qui ne s’enferme jamais dans une autoréférence solipsistique mais réussit justement, comme il est dit, à travers le champ de forces créé par ce mouvement circulaire trinitaire, un dialogue avec le monde, à l’englober et à le comprendere pour y être à son tour englobé et compris. C’est pour cela qu’il est facile de se retrouver et se reconnaître dans Boris, malgré son exaspérante (seulement à l’apparence) particularité existencielle. C’est justement en vertu de cette exceptionnelle transparence que son discours parvient à être universel.
Il y a un film qui plus que les autres peut se faire interprète des films de Boris Lehman : ce film est Babel. Peut-être parmi les nombreuses oeuvres, il est celui où son auteur se manifeste sur un mode plus direct et à découvert mais non moins riche au regard des significations et de l’originalité de la force de l’expression et de la poétique qui lui sont habituelles.
Je pense que tout est déjà contenu en synthèse et en puissance dans le prologue du film qui a lieu sur la Butte du Lion. Butte comme Tour de Babel (d’accord, nous savons pourquoi) mais butte également comme Mont Sinaï (où on reçoit l’ordre de mission), butte comme Golgotha (où on meurt), butte comme lieu de l’incertitude mais aussi lieu limite de la rencontre entre dieu et l’homme. Lieu de la séparation et de la réunion au travers du sacrifice : le Fils quitte le Père, le Verbe se fait homme et retourne au Père par l’oeuvre d’amour du Saint-Esprit. Boris quitte Boris et retrouve Boris. Boris fils sur scène et Boris père présent in absentia, caché dans un hypothétique hors-champ derrière la caméra. C’est le lieu du départ, de la descente sur terre mais aussi le lieu de l’arrivée, du final longuement attendu, de la remontée, de l’ascèse, de la résurrection avec le resaisissement dans la solitude d’une persone unique originelle.
Avec la descente de la Butte du Lion commence l’itinéraire de la souffrance qui porte avec elle la tentation de la fuite de son propre devoir à travers la chimère libératrice du voyage au Mexique ; là, où chaque pyramide Aztèque se propose comme homologue de la butte originelle, celle du Golgota à monter, de la vie terrestre et de la mort ; destin auquel il n’est pas donné de se soustraire et fuir. Voilà alors, précisément, la peur du départ comme impossibilité de changer son destin, comme peur de la souffrance due à la corruptibilité du corps vécue dans un mode égal par le père et le fils ; peur qui se révèle directement dans l’attention et le soin maniaques portés vers sa propre personne et qui transparaît encore dans une sorte de ricochet métonymique à travers la difficulté, plus d’une fois déclarée, d’amener le film à son achèvement ou à travers l’appréhension continuelle pour le salut de la pellicule, pour les dommages qui peuvent se produire dans l’emulsion et y abîmer les images.
Difficulté du vivre, une véritable “passion” qui ne peut se conclure que par la destruction et la dissolution de soi à travers le don de soi aux autres. Voilà alors la valeur et le rôle des cadeaux rapportés du Mexique aux amis restés en Belgique comme offre eucharistique, symboles de mort et de renaissance à travers le travail minutieux auquel Boris se soumet dans l’acte de déballer ces cadeaux comme s’il s’agissait d’une sortie pénible de son propre corps d’un suaire funèbre, allusion au Saint-Suaire qu’on retrouve dans le récit concernant le portrait du visage de Boris, seule et unique image miraculeusement sauvée d’une pellicule photographique irrimédiablement endommagée. Mais cette résurrection, ce retour au monde de Boris-fils n’est sûrement pas son triomphe, son apothèose. C’est plutôt sa défaite : les amis, l’humanité, le monde… tout a changé et dans ce changement personne ne s’est rapproché de lui mais tous se sont définitivement éloignés. Perdus à jamais.
Et dans tout cela, en plus du sacrifice mis en scène dans le film, il y a un sacrifice ultérieur qui se situe dans un espace metatextuel, en dehors de la diégèse. Il est l’espace de la cérémonie funèbre qui n’est autre que le cinéma-même dans son essence : procédé de mort qui arrache la vie au temps et la tue en l’embaumant dans la fixation chimique de la pellicule qui ne restitue qu’en apparence cette vie-même car elle ne peut le faire que dans une forme fantasmatique, illusoire. Chaque projection du film ne peut que se réduire à une célébration de la répétiton de la mort, de ce rite funèbre qui est filmer la vie. Boris, par ses origines, démontre connaître trop bien et souffrir jusqu’au bout ce rituel lorsqu’il le repropose avec toute la légèreté d’une ironie cruelle dans le sacrifice muet du poisson (poisson, symbole du Christ) dans la préparation du gefillte fisch dans son film Muet comme une carpe. Boris, qui, à la fois mobile et muet comme un poisson (n’est-il d’ailleurs né sous le signe des Poissons?), porte jusqu’au terme son parcours sacrificiel de figure de transition et d’incertitude, pont entre passé et futur en équilibre entre deux cultures qui se situent l’une à l’opposé de l’autre.
Hébraïsme : le père, la mère comme extension du père à travers l’éducation à la règle ; la tendence auto-ironique et mélancolique à se prendre pour une victime ; la complaisance d’un certain fatalisme auto-consolateur. Le sadisme. Le genre masculin. Le conflit oedipien non résolu qui du père-dieu s’étend au dieu-père.
Catholicisme: le fils victime du père, la mère complice-amante du fils et figure du pardon. Le masochisme. Le genre féminin. La possibile résolution de l’Oedipe dans l’acte d’amour du pardon universel, dans la rédemption du monde par le dieu fils et mère.
Boris Lehman figure de synthèse entre hébraïsme et christianisme, surtout dans une dynamique (résolue) du passage de l’un à l’autre. Dynamique vécue à travers l’énigme de la “compréhension” de l’existence, du rachat de la faute originelle, de la recherche de la famille comme reconnaissance-homologation de soi. Et que dire des innombrables figures féminines, des Marie, des Madeleine, des Bonne Samaritaine, de toutes ces femmes du destin dont est disséminé le parcours de rattachement de Boris avec lui-même? Que dire de ces infinies répétitions de mères-amantes (qui parlent et qui chantent) dans lesquelles Boris fils-amant se regarde, virginales et angéliques dans l’acte d’examiner des papiers, de manipuler des cartes et de lui demander de produire davantage des certificats et des certifications de son identité authentique, présumée, révolue? Des véritables anges bureaucratiques. En fait, ne sont-ils pas ainsi, les anges, sinon les acteurs-gardiens de la bureaucratie céleste?
Curieux et contradictoire (contradictoire?) cet hébraïsme chrétien qui traverse et imprègne l’oeuvre (et/ou la vie) de Boris Lehman. En effet on se demande si par hasard il ne serait pas profondément hébraïque, être à la fois autant profondément hébraïque que chrétien. Certes, c’est une interrogation à laquelle il n’est pas facile de donner une réponse. Je crois que seul Boris pourrait répondre, mais je ne suis pas sûr qu’il le voudra. Il se tiendra, je le vois, à un de ses sourires malicieux nous laissant dans un état d’incertitude encore plus grand.
Mario Brenta
(traduction française : Nanou Vandenbroeck)
Dico Boris Lehman e il mio pensiero va subito ad una frase di Michelangelo Antonioni riferita a se stesso: “Fare un film è per me vivere.”
Ridico Boris Lehman e, pensandoci meglio, credo che la stessa frase dovrebbe venire riformulata così: “Vivere è per me fare un film”.
Le due frasi sembrano in apparenza uguali; la seconda si direbbe il risultato di un piccolo gioco di parole, una semplice inversione sintattica della prima. In realtà non è così: la loro differenza è sostanziale. Quello che nella prima frase è il soggetto, “fare un film”, diventa nella seconda il predicato. Se per Antonioni “fare un film” è fonte di nutrimento vitale, un modo per sentirsi vivo, per Lehman non è né più né meno che la vita stessa, cioè la vita intesa come racconto del proprio essere nel mondo.
La prima è una frase celebre, la seconda non lo è (almeno non per ora, e non so se potrebbe diventarlo) non perché non si riferisca a persona degna di nota - infatti Boris Lehman è persona degna di nota - ma perché nasce nel mio pensiero in questo stesso momento in cui la scrivo. Perché il cinema di Boris Lehman nasce anch’esso, naturalmente e quasi istantaneamente con il suo pensiero. Naturale come alzarsi la mattina, lavarsi la faccia, vestirsi, uscire, andare al lavoro… e così di giorno in giorno, quotidianamente.
Questo cinema “pratica quotidiana” mi ricorda molto il modo di lavorare di Alberto Moravia: ogni mattina alla scrivania dalle nove alle dodici, come uno zelante “impiegato” della letteratura. Forse però, in questo suo vivere raccontandosi, Boris è più vicino a Pessoa che non a Moravia. Il Pessoa eteronimo, l’impiegato Bernardo Soares che, senza staccarsi mai dal suo stretto e alto banco di contabile presso una ditta di spedizioni, riempie giorno dopo giorno le pagine del suo diario segreto, del suo libro dell’inquietudine. Più vicino a Pessoa per il pessimismo malinconico e un po’ fatalistico del suo sguardo sul mondo da cui però in parte si distacca per quella sua irrinunciabile autoironia pietosa e partecipe, senz’altro diretto retaggio delle sue origini ebraiche.
Presente, passato, futuro, esterno, interno, reale, immaginario, pubblico, privato: tutto si ritrova e si fonde con grande disinvoltura e naturalezza nel cinema di Boris Lehman dove ogni inquadratura è sempre il risultato della scelta della via più semplice e più diretta (ma non per questo banale), senza dover far ricorso a nessun espediente retorico per segnalare il passaggio da un contesto all’altro. Si offre così allo spettatore l’opportunità di seguire il libero corso dei pensieri e delle sensazioni dell’autore, così come questi possono essere vissuti in una sorta di immedesimazione senza troppa intermediazione. E il tutto su un doppio binario: il piano fenomenologico (la storia) e il piano concettuale (le riflessioni sulla storia). Le persone e gli oggetti e il loro rapporto metonimico con i pensieri ma soprattutto con i sentimenti: frammenti sparsi che si vanno organizzando per comporre quella costellazione misteriosa e imprevedibile di atti, pensieri, sensazioni, emozioni, sentimenti che è la vita. Il film è così diegesi nella diegesi, il film e il farsi del film in una sorta di making of di se stesso.
Penso che girando il suo film Boris non riproduca ma “produca” la propria vita. In una sorta di inversione cronologico-causale, paradossalmente il film può essere letto come “sceneggiatura” dell’esistenza del suo autore. E’ questo il senso di “vivere è per me fare un film”. Il cinema diviene l’atto generatore della vita del suo autore. Doppia creatività? Creare una narrazione attraverso la creazione di se stesso?
E’ questo, mi pare, l’aspetto più interessante e originale del cinema di Boris Lehman. E’ per questo che si esce così facilmente dagli standard linguistici, narrativi, drammaturgici e cronologici del cinema tradizionale, in una ritrovata naturalità del linguaggio cinematografico come protolinguaggio tout court dell’uomo nell’interpretare il mondo (conoscenza), nel proprio rapporto con esso (coscienza) e nel proprio rapporto con se stesso (autocoscienza). Ma non ha nulla della (apparente) caotica (dis)organizzazione del flusso di coscienza; è moderno ma senza seguire nessuna moda. E’ moderno nel senso che è presente a se stesso, al tempo del suo farsi; che nasce e si colloca nell’attimo presente; che è istantaneo (e ha tutta la densità espressiva dell’istantanea) senza essere per questo un “instant movie”, perché sembra addirittura inscriversi in un ambiente senza tempo, ovvero, dove il tempo sembra non fluire ma coagularsi in un unico istante e dove lo spazio invece si espande e tutto ingloba, tutto comprende. E’ il cinema della comprensione, vorace nel voler tutto inglobare e, nello stesso tempo e per questa ragione, destinato (e con lui il suo autore) alla fagocitazione da parte dell’altro, del tutto, del mondo, che induce una sorta di (auto)ironico e a volte crudele gioco (auto)cannibalistico. Si spiega così come e perché l’autore-attore divenga una figura cristica sia nel costituirsi di un rapporto di identità tra padre e figlio sia soprattutto nel senso più marcatamente eucaristico del termine, del dare cioè il proprio corpo e la propria anima in pasto all’altro.
Oltre alla struttura binaria fondante “evento-pensiero”, c’è in fondo nei suoi film anche una struttura ternaria (ma sarebbe meglio dire trinitaria) soggiacente: Boris Lehman nella vita, Boris Lehman nel film (ovvero sempre nella vita) e il film stesso cha fa da tramite in questa dialettica speculare che non si chiude mai in un’autoreferenzialità solipsistica ma riesce appunto, come si è detto, proprio attraverso il campo di forze creato da questa circolarità trinitaria, a dialogare con il mondo e inglobarlo e comprenderlo per esserne a sua volta inglobato e compreso. Per questo è facile ritrovarsi e riconoscersi in Boris, malgrado la sua esasperata (solo in apparenza) peculiarità esistenziale. E’ proprio in virtù di questa trasparente eccezionalità che il suo discorso riesce ad essere universale.
C’è un film che più di ogni altro si può fare interprete del cinema di Boris Lehman: questo film è Babel. Forse tra le varie opere è quella dove il suo autore si manifesta in modo più diretto e scoperto ma non per questo meno ricco per quanto riguarda i significati e l’originalità della forza espressiva e della poetica che gli sono abituali.
Penso che tutto sia già contenuto in nuce nel prologo sulla Butte du Lion. Butte come Torre di Babele (e va bene, sappiamo perché), ma butte anche come monte Sinai (dove si riceve l’ordine di missione), butte come Golgota (dove si muore), butte luogo dell’incertezza ma anche luogo limite dell’incontro tra dio e l’uomo. Luogo della separazione e del ricongiungimento attraverso il sacrificio: il Figlio lascia il Padre, il Verbo si fa uomo e ritorna al Padre per opera d’amore dello Spirito Santo. Boris lascia Boris e ritrova Boris. Boris figlio in scena e Boris padre presente in absentia, nascosto in un ipotetico fuori campo dietro la macchina da presa. E’ il luogo della partenza, della discesa sulla terra ma è anche il luogo d’arrivo dell’atteso finale, della risalita, dell’ascesi, della resurrezione con il ricomporsi nella solitudine di un’unica originaria persona. Con la discesa dalla Butte du Lion ha inizio l’itinerario della sofferenza che porta con sé la tentazione della fuga dal proprio compito attraverso la chimera liberatoria del viaggio in Messico dove ogni piramide Atzeca si ripropone come omologia della butte originaria, quella del Golgota da salire, della vita terrena e della morte, destino a cui non è dato sottrarsi e fuggire. Ecco allora, appunto, la paura per la partenza come impossibilità di mutare il proprio destino, come paura della sofferenza dovuta alla corruttibilità del corpo vissuta in egual modo da padre e figlio, paura che si rivela in modo diretto nell’attenzione e nella cura maniacale rivolta alla propria persona e che traspare ancora in una sorta di rimbalzo metonimico attraverso la difficoltà più volte dichiarata nel portare a compimento il film (difficoltà del vivere) o la continua apprensione per la buona salute della pellicola, per i danni che possono prodursi nell’emulsione e deteriorarne l’immagine. Una vera e propria “passione” che non può che concludersi con la distruzione e dissoluzione di sé attraverso il darsi agli altri. Ecco allora il valore dei doni portati dal Messico agli amici come offerta eucaristica, simbolo di morte e rinascita attraverso il minuzioso lavoro cui Boris stesso si sottopone nello scartare i regali dal loro imballaggio come messa in atto di una faticosa uscita del corpo dal suo sudario funebre. Così come è allusiva alla Santa Sindone, la fotografia del volto di Boris, unica immagine che si è miracolosamente salvata di un rollino fotografico irrimediabilmente danneggiato. Ma questa resurrezione, questo ritorno al mondo di Boris-figlio non è certo il suo trionfo, la sua apoteosi. E’ bensì la sua sconfitta: gli amici, l’umanità, il mondo… tutto è cambiato e in questo cambiamento nessuno si è avvicinato a lui ma tutti si sono irrimediabilmente allontanati. Definitivamente perduti.
E in tutto questo, oltre al sacrificio messo in scena nel film, c’è un ulteriore sacrificio che si colloca in uno spazio metatestuale, fuori dalla diegesi. E’ lo spazio della cerimonia funebre che altro non è se non il cinema stesso nella sua essenza, procedimento di morte che strappa la vita al tempo e la uccide imbalsamandola nella fissità chimica della pellicola che sembra restituirci quella stessa vita ma lo può fare solo in forma fantasmatica, illusoria: ogni proiezione del film non può che ridursi ad una celebrazione della ricorrenza della morte, alla ripetizione di quel rito funebre che è il filmare la vita. E Boris, per le sue note origini dimostra di conoscere fin troppo bene e di soffrire fino in fondo questo rituale quando ce lo ripropone con crudele ironica leggerezza nel muto sacrifico del pesce (e il pesce è il simbolo del Cristo) nella preparazione del gefillte fisch nel suo film Muet comme une carpe. Boris che a sua volta, mobile e muto come un pesce (forse perché nato sotto il segno dei Pesci), porta a termine il suo percorso sacrificale di figura di transizione e di incertezza, di ponte tra l’ieri e il domani in bilico tra due culture che si collocano l’una all’opposto dell’altra.
Ebraismo: il padre, la madre estensione del padre attraverso l’educazione alla regola, il vittimismo autoironico e malinconico, il compiacimento di un certo fatalismo autoconsolatorio. Il sadismo. Il genere maschile. Il conflitto edipico irrisolto che dal padre-dio si estende al dio-padre.
Cattolicesimo: il figlio vittima del padre, la madre complice-amante e figura di perdono. Masochismo. Il genere femminile. Possibile soluzione dell’Edipo nell’atto d’amore del perdono universale, nella redenzione del mondo del dio figlio e madre.
Boris Lehman figura di sintesi tra ebraismo e cristianesimo, soprattutto in una dinamica (risolta?) di passaggio dall’uno all’altro. Dinamica vissuta attraverso l’enigma della “comprensione” dell’esistenza, del riscatto dalla colpa originaria, della ricerca della famiglia come riconoscimento-omologazione di sé. E che dire delle innumerevoli figure femminili, delle Marie, delle Maddalene, delle Buone Samaritane, tutte donne del destino di cui è disseminato il percorso di ricongiungimento di Boris con se stesso? Che dire di queste infinite ricorrenze di madri-amanti, in cui Boris-figlio si specchia, virginali e angeliche nell’esaminare documenti, manipolare carte, e chiedergli sempre maggiori certificazioni circa una sua presunta, compiuta autentica identità? Veri e propri angeli burocrati. Cosa sono infatti gli angeli se non i custodi-attori della burocrazia celeste?
Curioso e contraddittorio (contraddittorio?) questo ebraismo cristiano che attraversa e permea tutta l’opera (ovvero la vita) di Boris Lehman. Viene infatti spontaneo il chiedersi se per caso non sia profondamente ebraico essere ad un tempo così profondamente ebrei e così profondamente cristiani. E’ di certo un interrogativo al quale non è facile dare una risposta. Credo che solo Boris, il ricongiunto, potrebbe rispondere a tono ma non sono sicuro che vorrà. Si limiterà per certo, lo so, ad uno di quei suoi soliti sorrisi maliziosi che ci lascerà in un’ancor più grande incertezza.
Mario Brenta
« Perdi-me dentro de mim
Porque eu era labirinto »
(Mário de Sá-Carneiro)[2]
Boris Lehman se présente à nous comme un labyrinthe. Dans les films qui composent le cycle Babel se construit un paradoxe: au fur et à mesure que le cinéaste se dévoile et se montre, il semble se faufiler parmi des miroirs et des jeux de masques, dans un kaléidoscope du vécu, entre le témoignage quotidien et la fiction. Le réalisateur s'exhibe et s'escamote, se révèle et se cache en même temps, malgré sa présence persistante[3] dans ces films et l'insistance avec laquelle il souligne le « pacte autobiographique »[4]. Un jour, Boris Lehman, fatigué, se demande combien de fois il devra prononcer son nom, dans combien d'imprimés il devra le faire constater. Il met en relief cette dépendance nominale au générique de Tentatives de se décrire (2005), égrénant inlassablement plusieurs anagrammes de son nom, qui se transforme alors en un humoristique galimatias.
Même si Boris Lehman apparaît presque toujours dans ses films, il met l'accent sur son identification avec la caméra, de telle sorte que dans Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique (1991) il peut assurer : « Ceci est un film sur moi, sur ma vie, un portrait de moi par moi-même. (…) Et comme un miroir ne suffit pas, je me suis dit : "La caméra peut-être ?" » Et puis il émet des doutes : « Comment traduire mon errance, mon état ? Filmer ma solitude en me mettant dans l'image ou en m'effaçant ? Avec ou sans moi ? Parce que la caméra ça sera toujours moi. » Dans les films de Babel, Boris Lehman trame un cinéma du corps, de son corps. Quand il se rend chez le dentiste dans Histoire de ma vie racontée par mes photographies (2002), il insère un plan de la radiographie de sa denture. Le docteur prend dans ses mains l'une de ses dents arrachées autrefois à côté d'une serviette où l’on peut lire : « Boris Lehman ». Le « pacte autobiographique » ne peut être plus physique ! Plus tard, Boris Lehman retire ses cheveux d’un peigne dans le but de les garder dans un sac en plastique, où il notera la date correspondante, pour les intégrer dans une collection toute particulière. Dans Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique, après une autre visite médicale, Boris Lehman fait une curieuse comparaison entre les films et les corps, entre leurs maladies et leur disparition : « Les films aussi souffrent : plis, taches, griffes, rayures, décomposition physique et chimique, jusqu'au jour où il n'en reste plus rien. » Le cinéaste filme et explore son corps au moyen du fragment, minutieusement, en coupant en morceaux son image, en la soumettant au collage et à la discontinuité. C'est dans ce sens qu'une séquence de Tentatives de se décrire est très significative, car il se photocopie et il essaie ensuite de recomposer son image par l'intermédiaire de la juxtaposition des paysages fantomatiques qui se détachent de cette action. Dans le cycle Babel, Boris Lehman s'offre donc comme un hiéroglyphe, comme une énigme presque impossible à déchiffrer. Plus il s'exhibe, plus nébuleux et compliqué il devient ; plus proche, plus insaisissable. Il manifeste le désir de mieux se connaître grâce à ses films, mais son moi lui échappe comme du sable entre les doigts, toujours changeant et fuyant, comme le moi décrit par Montaigne dans ses Essais.
En outre, quelque part dans Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique, Boris Lehman fait allusion à son travail en cours comme un « film impossible » et se met sous le signe de l'échec : à la voix enregistrée en direct dans la première séquence en haut de la Butte du Lion, à Waterloo, se superpose une autre qui nous parle six années plus tard, et qui nous éclaire sans ambages : « Babel, une entreprise impossible, vouée à l'inachèvement, à l'échec. » Il met ainsi en doute, dès le début, tout son plan et ses possibilités de succès. Peu après, on trouve Boris Lehman solitaire et pensif dans un café, pendant qu'il continue son monologue intérieur, marqué par cette idée de l’inévitable désastre : « Tourner en rond, marcher sans but (…) Ou bien je ne suis qu'une ombre, qu’une mécanique souffrante ? Je ne ferai pas ce film, je le sais maintenant. Il me pèse trop, il m’écrase, il me paralyse (…). Ça sera un film en train de vouloir être un film. » Dans Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique, Boris Lehman parle justement de ses « projets utopiques », c'est-à-dire des films comme des rêves d'autres films impossibles. D'ailleurs, dans Tentatives de se décrire, une amie lui adresse quelques mots que l'on pourrait appliquer à ce faisceau de films : « Même mise en scène par moi-même, je n'arrive pas complètement à me dévoiler. J'arrive tout de même à fictionner ma vie. »
Cette présence de l'échec dans le noyau même de son discours – en raison du caractère ouvert de tout journal et de la volonté d'attraper sa propre vie en constante fuite, sur le coup de la disparition, comme Boris Lehman le signale plus d'une fois – implique une continuelle conscience réflexive sur son travail, qui fait que ces journaux filmés s'enroulent sur eux-mêmes dans une dynamique de spirale. Ainsi, au début de Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique un tas de livres sur le mythe Babel et de documents en rapport avec ce film apparaît comme reflet de son « work in progress ». Une voix chuchote, comme un cri en sourdine : « Babel, Boris Lehman… ». La lettre du cinéaste se montre alors en premier plan, au stade embryonnaire du projet de ce film.
La Petite Tour de Babel, peinte par Bruegel l'Ancien, qui ouvre Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique, sert de leitmotiv à Boris Lehman pour manifester autant l'enchevêtrement de soi que l'emmêlement des autres. Dans ce labyrinthe nécessairement confus où le moi s'embrouille, il est irrémédiable que celui-ci se manifeste fracturé, déchiqueté, fragmenté. Au début d’Histoire de ma vie racontée par mes photographies, Boris Lehman nous montre son visage coupé en morceaux par l'intermédiaire d'un autoportrait dont les bouts apparaissent progressivement à l'écran. Le premier morceau correspond à son œil, le guide de ce regard intérieur, de ce voyage tout au long de sa vie au moyen de ses images. En effet, on peut considérer tout le cycle Babel comme un gigantesque et interminable puzzle, voué à l'inexorable défaite que suppose en réalité toute quête du moi, toute initiative autobiographique, tout autoportrait. La fragmentation est donc inévitable, il n'y a pas de linéarité possible. Tout visage, tout corps s’échappe et s’enfuit continuellement. Tentatives de se décrire présente un prologue similaire, mais à travers la multiplication des images : Boris Lehman incorpore à l'écran des photos de passeport de gens anonymes, parmi lesquelles il place soudainement la sienne, tandis qu'il chantonne (comme Jonas Mekas dans Walden) sur ces « tentatives » dont il parle dans le titre de son film. Dans cet autoportrait, le réalisateur choisit l'accumulation, la saturation de l'image, comme souvent dans ses films.
Le concept de vie qui se dégage du cinéma de Boris Lehman est donc indissociable de l’enregistrement du vécu. Il s'ensuit que, au début d’Histoire de ma vie racontée par mes photographies, il laisse l'écran en noir, pendant qu'on entend les pleurs d'un bébé, et il affirme : « Au commencement, il n'y avait pas d'image. » De même, auparavant, il dit dans Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique : « Mon film se tisse lentement, comme la toile de l'araignée. » Dans cette comparaison se concrétise la fragilité d'une vie suspendue parmi les photographies et les enregistrements que Boris Lehman a classifiés dans des boîtes, dans l'attente du moment où ces instants s'imbriquent à côté d'autres selon le hasard ou une certaine disposition vitale : « Les photos prises au hasard finissent par désigner quelque chose, un itinéraire, avec un plan secret qui s'ordonne », dit Boris Lehman. Ainsi l'idée d’empilement est-elle à la racine de son « système », si un tel terme est possible à propos de ces films.
Dans Histoire de ma vie racontée par mes photographies, Boris Lehman se déplace parmi des tas de documents et d'images qu'il a réunis pendant des années et il se lamente : « Il n'y a pas une chaise où l'on peut s'asseoir. Même mon lit est encombré .» Il soupèse ensuite ce mot et l’adopte comme l’expression de lui-même : « Je suis un homme encombré. » Les souvenirs de Boris Lehman se disposent en plusieurs strates, en attendant patiemment d’être récupérés. De telle façon que dans Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique il ouvre des boîtes qui ont été fermées depuis longtemps et qu’il en sort des vieilles photos de ses parents. Boris Lehman se laisse emporter par un chaos créatif, magmatique, il traite ses propres souvenirs comme des « objets trouvés ». Il évolue avec difficulté parmi les amoncellements de boîtes et d’archives, parmi les montagnes de photos et de papiers qui contiennent sa mémoire personnelle. Alors émergent des expériences qui peut-être sont ressenties comme encore vivantes, ou qui, au contraire, sont déjà des bribes lointaines et un peu floues survenant comme de soudains éclairs de « mémoire involontaire », à la façon dont cela survient chez Marcel Proust. Les photos, assemblées en séries par Boris Lehman, donnent l'occasion d’un discours sur les possibilités de l’autoportrait ; elles dialoguent comme des pièces détachées de la vie du cinéaste. Il dit : « Toute ma vie enfermée dans une boîte », et il désigne les photos oubliées dans ces boîtes comme de « belles endormies ». Plus tard, il poursuit cette idée d'attente et de latence de ces images : « Les photos. Elles dorment, elles attendent. » Ces espaces bourrés d'objets et d'images donnent forme au marché aux puces particulier de Boris Lehman. La Petite Tour de Babel de Bruegel l'Ancien, emblème du premier film du cycle, trouve dans ces lieux une espèce de calque, d'écho, de répétition fantasmatique ; on y trouve la même aspiration vers l'impossible, la même idée d'échec. Dans ce contexte, l’image du réalisateur en plongée sur son lit, encerclé par le désordre, est significative. Il y médite sur la vanité du désir de retenir le cours du temps, doublement enregistré par les photos puis le filmage.
Boris Lehman s’applique à l'enregistrement systématique et persistant de sa vie avec la soif obsessionnelle d’un collectionneur. Ainsi « collectionne »-t-il des moments vécus, des visages, des écritures. Les livres apparaissent empilés en tours. Il les retire un par un pour les montrer à la caméra. Dans Tentatives de se décrire, il filme les amoncellements de négatifs et son échantillonnage de boules à neige, tandis qu'il étend cette inclination de son caractère à la totalité de sa pratique filmique : « Il n'y a pas de déchets dans mon cinéma. Tout est intéressant », ce qui inclut, au passage, les mêmes imperfections dont le film peut souffrir : « les bavures, les fins de bobine, les flous, les digressions ». Il montre sa collection de sacs en plastique pendant qu'il dit, en se plaignant de l'impossibilité d'exposer et de faire un inventaire réellement exhaustif de tous ses objets personnels : « Je ne peux tout montrer, l'intérieur de mes armoires, mon linge sale, mes objets intimes, je n'arriverai jamais à me dévoiler, à montrer l'intérieur de moi. » En dépit de cela, il continue avec le même acharnement, avec le geste déictique de se révéler à travers ses objets personnels, et il expose ses nombreux cahiers où, outre sa petite lettre en couleurs, s'emmagasinent des billets de train et des cartes postales. Ce n'est donc pas par hasard qu'il demande à ses élèves qu'ils se décrivent devant la caméra, au moyen d'objets avec lesquels ils s'identifient, dans l'atelier qu'il organise pendant son séjour à Montréal.
Par ailleurs, les souvenirs sont justement les objets-phares de Boris Lehman. Ces bibelots touristiques offrent d'emblée une signification trop figée, mais Lehman la détourne subtilement. Même si quelques-uns de leurs attributs restent, comme l’exotisme vulgaire, il se superpose d'autres valeurs nouvelles, ainsi que des éclairs d'humeur, indices du monde imaginaire de Boris Lehman. À ce propos, au début de la deuxième partie de Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique, les souvenirs qu'il rapporte de son périple mexicain sont révélateurs, comme un squelette acrobatique. Quand il rend visite aux amis, il leur donne en cadeau plusieurs de ces objets insolites et kitsch.
Afin d'illustrer son enracinement dans les images et la nécessité presque irrépressible d'enregistrer le vécu, dans Histoire de ma vie racontée par mes photographies, Boris Lehman se présente ironiquement avec une longue chevelure de négatifs et se montre ensuite habillé d’un costume confectionné avec des polaroïds, par l'intermédiaire duquel les instants de sa vie fusionnent avec son corps ; « La photo serait-elle une deuxième peau ? », se demande-t-il. Plus tard, il insère l'image d'une femme enceinte dans une baignoire comme métaphore de la mise au monde des images, pour apparaître à nouveau sous un manteau de photographies. Juste après, quelques diapositives sont attachées à son dos tels des tatouages, et il en parle comme d'un « souvenir de la peau ». Le cinéaste s'en met d'autres aux yeux, alors qu'on entend sa voix : « Avant que mon œil ne perde sa capacité de voir, fermez les yeux », comme une invitation à garder un regard intérieur, à la manière de celui qui régit ses films, où le vécu glisse vers le territoire de la rêverie et de la fiction. Dans une séquence postérieure, il se trouve devant une table où se reposent des photographies – l'entassement, à nouveau –, qu'il fouille et jette en l'air, précisément comme un « tourbillon » (selon son expression) de souvenirs et d'oublis. Puis il dispose une photographie grandeur nature de son corps contre un mur, afin qu'elle soit criblée de flèches. La première atteint son œil, qui est ainsi aveuglé. Cette idée se prolonge dans un premier plan de la caméra, auquel succède un autre plan de l'œil du réalisateur se fermant. Après, dans une cérémonie ironique, Boris Lehman et un ami dévorent mutuellement leurs photos de passeport. Plus tard, après la lecture de quelques fragments du Temps retrouvé de Proust, Boris Lehman projette sa propre image sur sa poitrine et son visage, tandis qu'il assure : « Je ne suis plus qu'une surface sensible. » Son œil apparaît en surimpression sur son front, pendant qu'il regarde fixement la caméra. De même, dans Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique, Boris Lehman avait filmé un petit miroir où se reflétaient successivement certaines parties de son corps, pendant qu'il déclarait : « Ce film est un miroir pour moi, miroir de moi, je me filme. Mon corps, comme ma maison, est un élément important de cette psychanalyse filmée. » En revanche, dans Histoire de ma vie racontée par mes photographies, le Boris Lehman qui se montre et en même temps se cache, dans les plis d'une certaine autofiction, se dérobe derrière un masque à gaz.
Dans Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique, Boris Lehman parle du caractère « imaginaire » de son voyage ; il estompe la frontière entre les faits réellement vécus et ceux imaginés. Dans son cinéma, tout glisse vers l'éclosion de la pleine subjectivité, que ce soit dans ses flâneries à travers le labyrinthe quotidien des rues, que ce soit dans les appartements et mansardes où il est de passage. Boris Lehman filme ses promenades dans les pas des dérives urbaines surréalistes et il fixe son attention sur des détails qui revêtent soudain des allures de mystère, comme les numéros des maisons écrits sur la bordure des trottoirs ou les affiches publicitaires qui invitent aux voyages lointains. Ces flâneries lui servent pour formuler l'agitation de sa propre existence et de ses capricieuses trajectoires : « Je ne peux pas m'arrêter, c'est un mouvement perpétuel, c'est la vie. » D'autre part, quand il filme ses domiciles successifs, la caméra se promène parmi les choses entassées, dispersées et désordonnées, parmi les traces de sa vie, comme dans le cas d'autres cinéastes, tels David Perlov dans son Diary (1973-1983) ou Stephen Dwoskin dans Trying to Kiss the Moon (1994). Dans Tentatives de se décrire, quand il est sur le point de déménager, Boris Lehman filme son appartement en guise d'adieux. La caméra enregistre quelques natures mortes intimes, signes de son passage : un téléphone, des journaux et des livres jetés par terre, un pull-over sur une chaise… Dans Babel / Lettre à mes amis restés en Belgique, une séquence rappelle le journal filmé de David Perlov. L'état dépressif se projette sur les détails contemplés dans l'espace privé, quotidien. Mais, contrairement à Perlov, dont la caméra s'attardait sur les planchers de son appartement, au seuil des chambres, ici elle glisse sur les murs et les fissures, comme si elle suivait le regard de Boris Lehman, contemplatif, suspendu dans ses méditations, jusqu'à ce qu'elle atteigne la lumière qui s'infiltre par la lucarne de sa mansarde, comme un espoir qui s'ouvre vers le voyage rêvé, qu'il finira par entreprendre comme presque imaginaire, en flottant par-dessus le vécu, et qu'il décrit ainsi : « Un départ de moi et une arrivée jusqu'à moi. » Toutefois, dans une séquence postérieure, il filme le désordre de son appartement avec des plans similaires à ceux de David Perlov, puisqu'il s'en sert pour manifester la tristesse, la solitude qu'il ressent dans cette période de sa vie. Mais, au contraire de Perlov, qui ne montrait pas son corps, Boris Lehman entre finalement dans le champ après les promenades solitaires de la caméra. On le voit avec la tête appuyée sur la table, en état d'abattement, lorsqu'il dit : « Je suis chez moi. Mais est-ce que je suis encore moi ? » En ce moment de découragement et d’isolement, il rejoint aussi David Perlov en mettant en question sa propre activité de cinéaste, envisageant même d’« arrêter de fabriquer des images ». Ce sentiment de détachement transitoire prend forme dans le premier plan d'un porte-photo où les visages ont été significativement coupés.
De même que Stephen Dwoskin, David Perlov ou Alain Cavalier, Boris Lehman filme des intérieurs avec des fenêtres au fond, tandis qu'il réfléchit sur le sens de son cinéma, et, par là, de sa vie. Dans Tentatives de se décrire, sur une photo où l'on voit sa silhouette floue devant une fenêtre, une ombre triste qui se découpe dans la lumière, sa déconnexion passagère des choses se cristallise : il dit se sentir « loin du centre, coupé du monde ». D'ailleurs, Boris Lehman répète ses adresses postales en raison d'un certain besoin d'ancrage au milieu de ses déambulations existentielles, au milieu de ce « tourbillon » décrit par le cinéaste, qui se plaint de ses déménagements, car il se sent perpétuellement de passage.
Néanmoins, tous les gens de ces films sont prédisposés à la rencontre. Ainsi, dans Histoire de ma vie racontée par mes photographies, Boris Lehman s'entretient avec les personnes qui ont posé face à son appareil photographique dans le passé et, à l'affût de leurs subtiles réactions, il filme leurs visages absorbés contemplant des albums. La photographie et le cinéma se manifestent alors comme des tentatives de faire face à l'implacable durée. Boris Lehman et un ami et voisin d'enfance entreprennent le travail de reconstruire leurs souvenirs, que tous les deux essaient de fixer et de sauver à l'aide des photographies.
Les films de Babel oscillent entre les états pleinement intérieurs de Lehman et ces rendez-vous amicaux. Dans les moments de plus grande rêverie, les autres semblent aussi devenir des ombres. En dépit de cela, Boris Lehman réaffirme le sens collectif de son projet quand il dit : « Je c'est nous ».
Gregorio Martín Gutiérrez
[1] Relu par Claudine Lemaître et Pascal Vimenet, pour la langue française utilisée directement par moi. Je les en remercie.
[2] Mário de Sá-Carneiro, «Dispersão», Obra poética, Madrid, Hiperión, 1990, p. 32.
[3] Cependant, Boris Lehman n'emploie pas toujours cette formule : par exemple, dans À la recherche du lieu de ma naissance (1990), film étranger à ce cycle, il choisit de rester derrière la caméra.
[4] Selon les termes utilisés par Philippe Lejeune, dans Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975 (1996).

CINEMA SUBJECTIF par Boris Lehman
« Ma vie est devenue le scénario d’un film qui lui-même est devenu ma vie » (in Babel/Lettre à mes amis restés en Belgique)
Subjectif s’opposerait à Objectif. Qu’est ce qui, dans le cinéma, serait considéré comme « objectif » ? On serait tenté de revenir aux débuts du cinéma, aux premiers films des frères Lumière, qui considéraient leur invention comme quelque chose d’absolument scientifique, destiné à capter, à capturer la réalité, le réel. Filmer scientifiquement, donc objectivement, sans intervention de l’auteur et d’ailleurs personne, alors, ne se pose en auteur. Pourtant on convient aujourd’hui que les « vues » Lumière (dues à plusieurs opérateurs et non aux seuls Frères, loin de là !) ont instauré un « style » reconnaissable (aucune confusion possible avec les vues du Kinétoscope d’Edison, avec Demeny ou d’autres). Pour nous elles ont donc un auteur : il a fallu cadrer (sans viseur), choisir un moment, gérer le temps d’un événement, construire. Cette contradiction objectif-subjectif , je la retrouve dans le dessein que j’ai souvent exprimé à propos de mes derniers films, de vouloir atteindre le « degré zéro du cinéma ». Effacer en quelque sorte l’auteur (et la notion même d’auteur, qui revient sans cesse dans la défense des droits d’auteur) comme au Moyen Age quand on construisait une cathédrale, par exemple. De la vie d’Hergé, l’auteur de Tintin, on ne savait pas grand-chose. Ce n’est qu’après sa mort qu’on s’est mis à décortiquer les moindres détails de sa vie pour en découvrir des facettes pas très glorieuses (racisme, colonialisme, antisémitisme…). De toute façon, ce qu’on retiendra (et ce qui est le plus important à mes yeux) c’est Tintin, c’est Charlot, c’est pas Chaplin. Est-ce que les biographies (comme les making of) nous éclairent sur les œuvres ? La question reste ouverte.
Le cinéma à la première personne existe dès les origines du cinéma : les Lumière filmant leurs ouvriers sortant de leur usine, ou le petit-déjeuner de leur bébé. Dans l’histoire du cinéma, ces façons de filmer la famille, les enfants, les mariages, les vacances…, les amateurs les ont reprises à leur compte, alors que les professionnels, se sont mis à raconter des histoires (ce à quoi les Lumière s’étaient aussi essayés – L’Arroseur arrosé) pour faire du cinéma un divertissement et un spectacle, utilisant des stars, des décors, des costumes, des maquillages, filmant en studio, etc. Quelques professionnels vont faire comme les amateurs, filmer leur entourage, leurs amis : Sacha Guitry (Ceux de chez nous), Jean Cocteau (Villa Santo Sospir) et plus tard Andy Warhol (Screen test)ou Gérard Courant (les Cinématons)…Filmer ses amis, ce que Jonas Mekas, le quasi inventeur du journal filmé (Film diary) a toujours fait, à partir des années 60 (Walden, Lost lost Lost…), suivi par mille autres, dont Ross Mc Elwee, David Perlov, Alan Berliner, Joseph Morder et moi-même.
Encore faudrait-il s’entendre sur le mot « journal filmé ». Genre apparenté à ce qu’on nomme le journal intime en littérature. Ici le journal tenu par l’auteur serait la caméra + la voix qui commente. La voix est importante, elle garantit souvent l’authenticité, plus que l’image même (On se souvient des voix d’ Orson Welles, de Nanni Moretti, de Joseph Morder, de Jonas Mekas, de la mienne). On ne verrait donc jamais l’auteur, comme dans l’écrit, puisqu’il serait confondu avec la caméra, sauf dans les rares moments où il passerait devant un miroir. Et cependant, la caméra a ceci de particulier qu’elle permet d’avoir plusieurs points de vue, on pourrait dire des yeux dans le dos et donc, dans mon cas, de pouvoir se retourner sur l’auteur, qui devient alors
Ce miroir en quelque sorte réfléchit l’auteur, il l’authentifie. C’est bien un cinéma de la preuve que je pratique. C’est bien moi, j’étais là à Marseille, j’ai bien parlé avec Beauviala, je portais ce costume, il pleuvait. (On sait qu’aujourd’hui, toutes ces preuves, on peut les fabriquer.) J’ai commencé à expérimenter ce mode de filmage au début des années 80. Avant j’avais fait des films documentaires, didactiques et scientifiques, des films expérimentaux aussi et des petites fictions improvisées. Soudain, m’est venue l’idée de « me mettre dans mes films », mais ce n’était pas prémédité, c’était sans intention, quelque chose de naturel plutôt, un peu comme Van Gogh sans doute, qui ne trouvant pas de modèle, se prit lui-même comme modèle. Cela est dû à la pauvreté des moyens, à une espèce d’évidence. Babel commencé en 1983 serait la matrice, le film fondateur de cette façon de faire. Je voulais être dans le film, dans l’image, mais je voulais aussi rester derrière la caméra, et c’est là que les problèmes ont commencé. Si comme acteur je jouais mon propre rôle (comme tous les protagonistes du film), celui d’un type déprimé, mal dans sa peau, comme réalisateur il fallait que je prenne des décisions, éclairer, diriger les opérations choisir les cadrages, les emplacements de la caméra, décider des coupes , c’est-à-dire me comporter à l’inverse de mon « rôle » de dépressif. D’où une contradiction, voire une impossibilité d’être des deux côtés à la fois, ou alors la mise en évidence d’une certaine imposture, et de ce fait une « mise en fiction »,
Le film pose évidemment la question première de la pudeur et de l’impudeur. Qu’est-ce qu’on peut montrer de son intimité (et de l’intimité des autres), jusqu’où on peut aller ? Dans la fiction traditionnelle, on a des comédiens, il y a des contrats, « toute ressemblance avec des faits et des personnes réelles n’est que pure coïncidence ». Avec les personnes réelles, tout reste ambigu et tacite. En général c’est sans problème, mais parfois il peut y avoir des conflits parce qu’il y va de la vie privée. Dans toute autofiction, il y a exhibition. L’exposition du corps de l’auteur peut mener à l’obscénité. Ce n’est pas tant la nudité qui pose problème, mais certains aspects de l’intimité, qui peuvent engendrer de la répulsion (ou du rejet) de la part du spectateur-voyeur.
Mais il ne saurait être question dans mes films de reportage sur ma vie, de documentaire sur moi-même. Ce sont des fragments de ma vie qui sont mis en scène. Cela pose la question du faux et du vrai, de la vérité, la question de la fiction, tout simplement. J’appelle ça volontiers « fiction autobiographique ».
Bien entendu l’inconscient parle, le film révèle toujours quelque chose de nous-mêmes qu’on avait pris soin de dissimuler. Le film serait plutôt un autoportrait par procuration. J’ai toujours eu besoin des autres pour me filmer, pour me décrire (Tentatives de se décrire). La caméra , si elle est miroir pour moi, elle le devient pour le spectateur à qui le film s’adresse et qui prend, en quelque sorte, ma place. Le subjectif de l’auteur renvoie au subjectif du spectateur.
On pourrait dire que le « cinéma à la première personne » est d’abord un cinéma pauvre (arte povera), un cinéma de l’intimité, des interstices (les choses et les moments que le cinéma traditionnel ne montre pas, le temps qui passe, les temps morts par exemple), de petites choses accumulées. En revanche s’il existe, aujourd’hui, grâce aux caméras numériques miniaturisées, un cinéma qui se conçoit tout seul, dans l’isolement, personnellement, moi j’ai toujours eu besoin d’une équipe (2 personnes minimum, 3 ou 4 le plus souvent) pour filmer, fût-ce ma solitude. Ce qui peut sembler paradoxal.
C’est une des idées conductrices de mes films : le temps. C’est le temps qui façonne mes films. Le temps mis à faire le film, mais aussi le temps pour le monter (souvent quelques années plus tard pour avoir un recul, une distance avec soi-même) et la durée finale de l’œuvre. Le journal implique de filmer de façon permanente, par accumulation de petites scènes, de descriptions, de réflexions, de digressions. Je le dis dans
J’en viens à une notion corollaire, celle de la collection, de l’encyclopédie. Accumuler, c’est collectionner, collecter. Je collecte les images, je fais l’inventaire de mes amis, de mes lieux, de mes voyages, etc. Je fais mon musée, je le montre aux visiteurs, aux spectateurs, je m’expose et je leur sers de guide.
D’autres réalisateurs ont fait des films autobiographiques autrement : en racontant des histoires provenant de leur propre vie, en prenant souvent un double pour jouer leur rôle – Mastroianni pour Fellini, Jean-Pierre Léaud pour Truffaut, et même Nanni Moretti qui joue son propre rôle dans tous ses premiers films, notamment Journal Intime. De retomber alors dans une forme codée, scénarisée, classique du cinéma.
Dans mon cas, il y a peu de distance entre le Boris Lehman dans la vie et le Boris Lehman dans le film.Et c’est là que peut être mon cinéma rejoint la performance. Une performance, un happening est quelque chose qui ne se présente, qui ne se produit qu’une seule fois. Dans mon cinéma, je ne fais qu’une seule prise. Il n’y a pas de préparation, pas d’intention, juste l’acte de faire, ici devant la caméra pour garder trace. C’est presque du tourné-monté. L’idée devenue film. C’est pour cela qu’une fois le film projeté, le spectateur a l’impression que cela se passe au présent, que la chose est en train de se faire.
A noter que chez moi c’est le cinéma qui crée la performance, contrairement à Joseph Beuys ou Francis Alÿs par exemple, où la performance précède le filmage, existe d’abord sans le cinéma. Sans caméra, moi je ne le ferais pas, je n’irai pas chez X ou Y, je ne dirais pas ceci ou cela, je n’existerais pas.
Il reste que ce que je filme a peu à voir avec le cinéma même. Je ne veux rien raconter, je ne veux pas m’exprimer ni même documenter. C’est plutôt un besoin, un jeu, , une manie, une obsession, peut-être une drogue, quelque chose d’existentiel, à la fois de maladif et thérapeutique, qui a à voir avec ma vie même, avec la vie que je mène, nomade, chaotique, déambulante, « mouvementée ». C’est le film qui fait le lien avec les autres, avec le monde, qui m’aide à le voir, à lui parler et donc à vivre. Boris Lehman, timide provocateurEntretien avec Linda Lewkowicz Suivant la leçon de Socrate, à travers plus de quatre cents films et des centaines de milliers de photos, le cinéaste Boris Lehman n’a qu’une obsession : se connaître et, à travers lui, le monde. Petit Fragment d’une vie à la frontière de l’obscène.
L’obscène, c’est quoi ? C’est ce qui offense la pudeur. Cela a à voir en premier lieu avec le sexe, ( ce n’est évidemment pas pareil en Iran ou au Japon) , mais aussi avec la politique, les excréments, la bouffe, l’argent.
Y a-t-il des films que tu considères comme obscène ? Je pense, par exemple, au marquis de Sade et l’adaptation qu’en a faite Pasolini dans Salo. Je pense à Bataille, Histoire de l’œil, aux poupées de Pierre Molinier, aux nus de Mappelthorpe, à L’Origine du Monde de Courbet, à L’Iliade d’Homère que je considère comme obscène par cette délectation qu’il a à décrire des batailles et des meurtres. Je pense à La grande Bouffe (La grande abbuffata/Marco Ferreri,1973), un film obscène, mais d’une obscénité saine, si j’ose dire. Un film que j’aime beaucoup parce que c’est une image de notre monde qui surconsomme, qui finit par crever de ses propres jouissances. Je trouve cela obscène et formidable à la fois que ce soit quelqu’un d’autre qui l’ait réalisé, je n’aurais pas pu. Mais dans Muet comme une carpe (1987) ça mange aussi, c’est pas obscène ? C’est un film sur le sacrifice du poisson. On tue la carpe, on la dépèce, on la mange. Mais tout est ritualisé. Filmer des gens qui mangent, cela à l’air simple et je ne suis ni le premier ni le dernier à filmer des gens qui mangent, mais pour moi cela pose un problème qui est proche de l’obscénité. S’approcher d’une bouche qui ingurgite, j’y vois comme un sexe... Comment prendre distance sans faire un film culinaire ? J’utilise la plongée, le ralenti, j’enlève le son direct, j’ajoute de la musique, ça transforme le film en une Puisque tu abordes la question par toi-même. Parmi les films qui ont traité de la Shoah, et « dieu » sait s’il y en a eu, lesquels te semblent obscènes ? Prenons en trois « au hasard » : Shoah de Lanzmann, La liste de Schindler de Spielberg et La vie est belle de Benigni. Shoah c’est un grand film sur l’immontrable et l’inacceptable Spielberg au contraire montre tout et réduit l’Histoire des camps à une histoire sentimentale et Benigni, prend l’histoire à la légère, par dessus la jambe, c’est dérisoire. Le sujet est obscène ? Ce n’est pas que l’on ne puisse pas en rire ; mais quand Lubitsch fait To be or not to be ou Chaplin Le dictateur : on rit, on est dans une autre dimension. Ce n’est pas obscène, ce qui l’est vraiment obscène, ce sont les Allemands qui filment les cadavres des gens qu’ils viennent d’assassiner , comme des chasseurs avec leur proie. C’est le comble de l’obscénité. Jamais d’images d’obscénité dans tes films ? Dans Histoire de ma vie racontée par mes photographies, je m’attarde sur une de ces images. Dans Voyage au pays de ma mère (2003), j’ai aussi filmé une scène à Auschwitz. C’est la fin de mon voyage et je dis dans ce film « Je me sens bien ici , je reste ». C’est une décision grave et qui semble vouloir dire que je porte la culpabilité d’être vivant alors que d’autres sont morts. Mais c’est vraiment mon « chez-moi » Ton cinéma est celui de l’intimité, un journal infini filmé à la première personne, c’est pas obscène ? C’est l’impudeur de tout journal intime. Mais tout le monde peut se reconnaître dans ces faits et gestes. Ce que je montre de moi est pure fiction. Cette nuance n’est pas toujours perceptible pour le spectateur, puisque je joue mon propre rôle. Il y a souvent confusion entre la personne que je suis et le rôle que je joue dans mes films. Bien entendu les pistes sont brouillées et je joue sur cette ambiguïté. C’est pareil avec mes amis, les gens que je rencontre, que je photographie ou filme ( à propos, est-ce que je peux prendre une photo de toi ?), ensuite tous ces fragments de vie, je les mets en scène, je les manipule, je crée une fiction. C’est pas obscène ? Je ne cherche pas à choquer ni à provoquer. L’image résulte toujours d’un accord tacite, d’un consentement mutuel, d’une évidence, et aussi d’une démarche, d’une morale et d’une éthique personnelle. Mais certaines de tes images sont choquantes (obscènes) non ? Celle-ci, par exemple ? Ça dépend de qui regarde, et comment on regarde. Je ne filme jamais l’horreur ou l’horrible. Certes, j’ai filmé des accouchements, des circoncisions, des séances chez le dentiste, et aussi des scènes reconstituées où je reçois des flèches dans le corps, où je brûle, scènes parfois dures à regarder, j’en conviens. Si ça choque, tant pis, ça ne regarde que le regardeur. Mon intimité, une fois filmée, ce côté privé et secret des choses devient soudain public. C’est une espèce de don de ma personne, de mon corps, c’est, je le reconnais, un peu christique. Mais je ne cherche pas à filmer des « choses à ne pas montrer », comme dirait Sei Shônagon dans ses Notes de chevet (Japon, XIè siècle). Je suis plutôt contre le spectaculaire, le scoop, le reality show Mais cette façon de t’exhiber, c’est un peu obscène, non ? « Je ne peux tout montrer, l’intérieur de mes armoires, mon linge sale, mes objets intimes, je n’arriverai jamais à me dévoiler, à montrer l’intérieur de moi. Je m’acharne à multiplier les plans, à les recommencer sans cesse, à les varier à l’infini, rien ne passe, rien ne vient, rien ne sort de tout ça, vaines tentatives de se décrire ». La nudité chez moi est très pudique, elle est édénique. C’est le temps du paradis, l’innocence d’avant la chute. Le plus gênant n’est pas de se déshabiller devant la caméra, c’est de montrer des choses qu’on veut cacher de soi, par exemple mon pied dans le lavabo, ma calvitie. Au début, c’était très difficile et puis, je me suis jeté à l’eau, comme on dit, je me suis accepté tel. Où est ta limite ? Je ne peux pas le dire. À chaque film, à chaque nouvelle expérience, et pour ne pas me répéter, pour échapper à un certain confort, j’essaye d’aller un peu plus loin dans le dévoilement. C’est toujours une épreuve, il faut mettre sa vie en danger sinon il n’y a pas d’art. Evidemment, j’use volontiers de figures de style, de métaphores, c’est le propre de la poésie. Pour moi tout est fiction. Mais revenons à tes films(ceux-là sans argent), la circoncision, les accouchements ... Il y a sans doute chez moi l’obsession de l’accouchement, de la gestation. On voit par exemple beaucoup de femmes enceintes. Ici, j’accouche de mes photos (voir photo ci-contre). Filmer un enterrement, j’y suis pas encore vraiment arrivé. Dans Tentatives de se décrire (2004), tu as filmé une scène de massage de ton propre sexe, c’est pas obscène ? Au fond, cette séquence devait me faire du bien. Se faire masser le sexe par une jolie femme. Mais en même temps, je suis très préoccupé par le filmage et la mise en scène et je donne des ordres, je suis terriblement autoritaire et la scène montre cette contradiction. Je suis peut-être assez proche de ce qu’on a appelé body art, je fais beaucoup d’expérimentations sur moi-même. Dans celle-ci , on pourrait appeler cela martyrologie, mystique, masochisme… C’est une allusion à Saint Sébastien (Martyr romain souvent représenté attaché à un poteau, le corps transpercé de flèches). Mais là, par exemple, c’est une photo (Il montre une photo de son pied tirée de Babel. C’est obscène ! Mais non, c’est une photo qui m’a marqué pendant longtemps. Et c’est plus fort que moi tout nu. C’est pas vraiment obscène, mais c’est terriblement gênant.. Là, cette photo de ma bouche chez le dentiste. C’est comme quand on filme à l’intérieur de ton sexe… Tous les orifices sont sexuels. Mais moi, je les montre, du moins je l’espère, toujours au second degré. Il y a la distance de l’humour, de l’autodérision. Tes questions sont bonnes, Linda, mais pourquoi cette insistance à chercher à tout prix l’obscène dans mes films ? Il n’y en a pas. Certaines scènes, certains plans – rares – peuvent y faire penser. Mais je ne suis pas Reiser (que j’aime bien). Je ne pense pas qu’à ça. Il y a chez moi une auto-mise à l’épreuve de mon identité (d’homme, de juif, de belge, de cinéaste, de fou!) qui passe nécessairement par le corps. Ce serait plutôt le support photographique (et donc cinématographique) qui est pour ainsi dire obscène et pornographique. Il agit à la fois d’une arme et d’un œil. Une machine qui n’a pas de sentiment, ni de complexe, ni de remords à tout filmer en toutes occasions. Elle ne sait pas ce qui est beau, ni ce qui est laid, ce qui est bon ou mauvais, ce qui est pudique ou obscène. La machine scientifique munie de lentilles et d’objectifs enregistre ce qui est, « garantissant » l’authenticité, la vérité, l’objectivité. On peut dire que la caméra est impitoyable, froide, on ne peut plus voyeuriste, surtout quand elle s’aventure dans ce que l’œil humain ne peut (ou ne veut) voir. Aussi le cinéma (comme la photographie) a beaucoup à voir avec la mort. Il capte toujours quelque chose qui est en train de disparaître, de mourir. Mais à partir de quand une image devient-elle obscène ? Une image n’est jamais détachée de son contexte. La même image est obscène pour l’un et pas pour l’autre. Dans Le Cauchemar de Darwin (documentaire de Hubert Sauper, 2004), par exemple, on sent le discours préexistant au film, l’intention malveillante. Cette espèce d’accusation gratuite. C’est obscène. C’est comme s’il venait sur mon tournage et qu’il m’accuserait d’avoir tué des carpes et me traiterait d’assassin, preuve à l’appui. Dans La Domination masculine (documentaire de Patrick Jean, sortie à Liège le 17 mars), le réalisateur fabrique un discours (sur les femmes battues, violées ou assassinées) prend des images sorties de leur contexte pour servir et confirmer son propos . C’est de la pure propagande idéologique. Mais nous sommes entourés quotidiennement de choses obscènes, la télévision qui nous force à regarder les horreurs et la misère du monde. Donc, c’est le contexte de l’apparition d’une image qui lui donne son sens obscène ou pas ? Une même photo publiée dans le journal Libération ou Lui change totalement sa perception. D’où l’envie de voir le magazine Scènes avant d’accepter l’entretien ? On ne peut pas tout accepter. On n’a pas envie que l’on utilise quelque chose contre soi. On ne peut tout maîtriser. Mon image s’envole et m’échappe. C’est sans doute la raison pour laquelle j’ai toujours voulu accompagner mes films, une démarche que d’aucun trouve peut-être ridicule et contraire à l’idée que l’on se fait du cinéma. Une œuvre cinématographique voyage seule, moi je l’accompagne à chaque fois, un peu comme un acteur de théâtre, je vois la projection comme une « performance », un « happening ». Pour moi chaque projection est différente. La salle est différente, le public, le temps, l’ambiance. Mais comment comptes-tu accompagner tes films après ta mort ? Ils se promèneront tout seuls si on les laisse vivre. Ce sera plus mon problème et puis de toute façon tout est en train de se déglinguer. Je découvre des images de moi sur Internet, je ne sais pas qui les a mises et de photos ou des films que l’on m’attribue et que je n’ai pas fait. Je ne vais pas prendre mon temps pour protester ou rajuster le tir. Ce qui compte, c’est les films et les photos que j’ai faits. Ce que j’ai mis de ma vie privée dans mes films. Quelqu’un qui porte le poids du monde, la souffrance des hommes.(Rire). D’origine judéo-chrétienne, un père tyrannique. Elevé dans la religion, le pur et l’impur. Le cinéma est un moyen que je me suis donné pour prendre une distance avec tout ça, pour critiquer transgresser, aller peut être au-delà de la pudeur, de la morale, de la religion, de l’autorité. Pour me sortir de cette prison, pour devenir quelqu’un, pour exister. C’est juste une leçon de courage, de ténacité, de combat pour l’indépendance et la liberté. Tout cela sans trop de sérieux, avec beaucoup de naïveté, humblement et timidement, non je ne suis pas un grand provocateur. Et si tu trouves de l’obscénité là-dedans, alors tout l’art est obscène. D’où vient la rumeur qu’un film ou qu’un metteur en scène ont de l’importance ? Est-ce l’intervention de critiques ou de programmateurs qui ont notre confiance, ou est-ce un bruit de fond, difficile à déterminer mais persistant ? Ces cinéastes que l’on garde pour le plus tard vague des soirées d’hiver mythifiées, qu’est-ce qui fait que s’actualise leur existence à notre attention ? Une diffusion, un article, une discussion ? Et si l’hiver ne venait jamais, que ce pas ne soit jamais franchi ? Aussi loin qu’on s’en souvienne, Boris Lehman a toujours existé, sans qu’on puisse tracer précisément la source de notre connaissance. Il fait pourtant parti du groupe restreint des réalisateurs modernes qui nous agrippent dès qu’on le découvre, quel que soit l’angle d’attaque et le film considéré. Comment a-t-on pu le négliger aussi longtemps et qui d’autre languit dans un purgatoire équivalent ? Serait-ce à cause d’une sorte de discrétion ou de politesse excessive de l’auteur, qui pourtant n’hésite pas à apparaître à l’écran ?
Il n’y a pas plus modeste qu’un orgueilleux, et pas plus orgueilleux qu’un modeste. Il faut une dose certaine d’orgueil pour se placer devant la caméra, et dire « je » par l’insistance de sa présence. L’abîme de l’impudeur devient impudeur de l’abîme, et cette présence concrète renvoie directement à notre propre béance individuelle : l’auteur et le spectateur dépassent la limite de l’écran, d’une communion possible au-delà du miroir. Mais le soupçon d’un masque est permanent, qui se cache en se montrant, dans le paradoxe du larvatus prodeo : à côté du « être c’est être perçu ou percevoir » de Berkeley, il y aurait alors un « se donner à voir c’est se donner à disparaître », comble de la modestie. Quand Lehman met en scène sa mise en tombeau dans Funérailles (de l’art de mourir) (2016) en annonçant la clôture de son œuvre, il pousse cette logique jusqu’à sa limite, dans sa littéralité butée et donc absurde. Hanté par Kafka et sa tentation d’autodafé, ce film et cette référence offrent l’une des clefs pour appréhender le travail du cinéaste. Pour reprendre le sous-titre du livre de Deleuze et Guattari, c’est une « cinématographie mineure » qui se déploie, en affirmant donc son devenir minoritaire, c’est-à-dire l’inverse de la constatation passive d’une identité figée dès l’origine[1]. Tout comme Kafka était pris dans la toile de l’équilibre instable d’être un écrivain juif écrivant en allemand à Prague, Lehman est un cinéaste juif filmant en français à Bruxelles : même culture ancienne affleurant sous une « majoritaire » dans un lieu décentré, qui travaille (d’un deuil) la « langue » de l’intérieur[2].
Cette instabilité entre modestie et orgueil par la présence/absence du réalisateur se double par un sceau de lui-même dans toutes ses images, même quand il n’y apparaît pas. C’est un cinéma habité par son filmeur : il s’induit que l’une des formes que prend une telle approche est souvent celle d’un « journal filmé », dont Babel en est l’exemple le plus fameux. Démesuré de par sa durée, il devient une épopée presque malgré lui, générant quasi spontanément son propre foisonnement monstrueux. Mais cela suppose par voie de conséquence qu’il ne soit pas abandonné au tout venant de la distribution et qu’il soit accompagné par son auteur : de là le choix systématique de présenter ses films, de les suivre. Dans le même ordre d’idée, si certains sont mis en ligne sur internet, c’est en conditionnant leur accès après une prise de contact, comme s’il fallait d’abord se connaître et se parler, aussi peu que ce soit. La technologie aidant, ou plus probablement pour contrecarrer la froideur de ladite technologie, on atteint alors ce qu’avait prédit Daney : « Et puis à la longue pointe le spectre que connaît bien le critique professionnel : la projection « pour lui seul » d’un film sur la solitude avec l’auteur qui l’attend à la sortie. L’involution touche à son terme[3] ». Il n’y a plus de public, mais des cinéphiles que l’on connaît presque un à un[4] : après tout, quand un cinéaste se met à nu, il n’est que justice que le spectateur mette à son tour un peu de lui-même en balance. Cette cohérence jusque dans les modes de diffusion n’est que l’ultime conclusion d’une démarche d’intimité à partager.
Mis à part quelques films sortis en VHS et DVD que l’on achète pour ne pas les regarder, l’immense partie de son travail est enfouie (plusieurs centaines de films sont évoqués). C’est donc une montagne suffocante pour le curieux de bonne volonté, ce qui explique en partie la relative mise de côté de cette œuvre : quelques rares diffusions sur Arte, une rétrospective lacunaire au Centre Pompidou en mars-avril 2003, des projections par-ci par-là à intervalle irrégulier. Découvrir le cinéma de Boris Lehman est pourtant un voyage vers un continent qui ne cesse de révéler des facettes et des interconnections. L’idée d’auteur induit le talent, la maîtrise et la constance dans des thèmes et/ou dans un style ; mais c’est aussi ce qui offre ce sentiment que chaque opus que l’on découvre approfondit tous les autres, qu’un sillon ne se creuse pas seulement dans la ligne droite d’une filmographie, où chaque film est la station d’un chemin de croix, mais dans la spirale où tout se met en écho dans la chambre noire de la mémoire. On ne peut alors qu’enrager d’avoir si peu accès à ce corpus quand c’est justement la régularité d’une diffusion qui permettrait par entraînement de lui rendre justice, ce qui devrait être le but de certaines institutions muséales. La culture, laissée à elle-même ou dans les mains incompétentes d’administrateurs sans âme, est décidément aberrante et méprisable.
Pour s’en convaincre, il suffit de découvrir Muet comme une carpe (1987), où exceptionnellement l’auteur n’apparaît pas, même s’il semble être partout. On y suit toutes les étapes de la pêche, de l’achat d’ingrédients, de la préparation, de la cuisson puis de la dégustation d’une carpe farcie pour la fête du nouvel an juif. Si l’approche est par principe documentaire, sa composition et en particulier certaines tangentes rendent difficile sa détermination stricte (en général, on parle alors d’« essai », à défaut de mieux). Cette « genèse d’un repas » est ainsi à la fois une description pointilleuse de la confection du plat par l’addition de gros plans en caméra fixe[5], et une scène de dégustation du met en famille. L’usage de la musique et du ralenti élève ce moment dans un lyrisme de la convivialité et de la joie, que renforce le dernier plan qui élargit la scène en plan large et en plongée dans un mouvement ascendant, avant que ne disparaissent les personnages dans le flash de surexposition de l’arrêt de caméra. Si l’essentiel du film est dans un lieu clos, entre cuisine et salon, il s’ouvre pourtant sur l’extérieur : par les scènes de pêche et de commissions initiales, par l’usage sonore de la radio pendant la préparation, par le chant suivi de quelques plans d’un rabbin en synagogue, par un moment de recueillement rituel près d’une rivière, mais surtout par l’insert d’images d’informations télévisés évoquant le Moyen-Orient et d’un dessin animé[6]. De proche en proche donc, comme les ronds dans l’eau s’écartant d’un centre précisément défini, le film appelle l’extérieur par touches progressives, principalement dans une même thématique renforçant l’idée de communauté, mais surtout en s’élevant dans l’abstraction, jusqu’à la poésie[7]. On a similairement été frappé dans d’autres de ses réalisations par certains passages qui sont comme des éclairs d’onirisme : le vol d’oiseaux qui conclut La Dernière (s)cène (comme si le titre pointait aussi dans cette direction), la séquence « je vole » de Homme portant (qui utilise également le mélange des formats dans un effet de reprise tout à fait surprenant), etc. Muet comme une carpe réussit dans de tels moments de grâce à faire cohabiter et à réconcilier ce qui pourtant s’oppose : le matériel et le spirituel. Le concret des gestes est mis en équilibre avec la prière, et le souci d’indiquer précisément au générique les instruments ayant permis sa réalisation (type de caméra et de magnétophone, vitesse de défilement) ne nie pas le désir manifeste d’exprimer la transcendance du rituel. L’un s’appuie et glisse vers l’autre
La fidélité du cinéaste pour la pellicule 16mm s’explique alors, car comment pourrait-on demeurer matérialiste sur un « support » digital ? Il ne s’agit pas seulement d’une différence d’esthète, mais c’est plus profondément un différent contrat qui est passé avec le spectateur : les contraintes de ce qui fixe l’enregistrement, avec sa rugosité, ses marques d’usure, ses défauts inhérents, son poids et son coût somptuaire semblent aujourd’hui niés, pour une sorte d’idéal d’immatérialité. Et si la différence ne se voit plus, elle se sent. Pour qui veut dire un au-delà de ce qu’il montre, évoquer un hors-monde ou une métaphysique des origines, il faut ainsi probablement poser avant tout une empreinte concrète, ce que seul permet le celluloïd. Dernier des matérialistes, Lehman peut alors devenir à cette condition et par suite le premier des mystiques Jean-Paul Combe, Vincent Heristchi, Jeune Cinéma n°387, mai 2018
[1] Et donc fondamentalement différente (voire opposée) au militantisme contemporain des « minorités », qui se posent comme telles, alors qu’il s’est toujours agi pour Deleuze d’une « ligne de fuite » active, mouvante et incessante, jamais exempte du risque de (re)fixation majoritaire. [2] « Une littérature mineure n’est pas celle d’une langue mineure, plutôt celle qu’une minorité fait dans une langue majeure. Mais le premier caractère est de toute façon que la langue y est affectée d’un fort coefficient de déterritorialisation. » G. Deleuze et F. Guattari, Kafka, éd. de Minuit, p. 29. [3] Serge Daney, « Pour une ciné-démographie » (1988) repris in Devant la recrudescence des vols de sacs à mains, Aléas, p. 148 (éd. 1991). [4] Cette autarcie court le risque de complaisance de l’entre soi avec des fidèles déjà acquis et le syndrome du “film de plus”, entre copains pour des copains, à la Rouch. Miraculeusement (vu son isolation), Lehman évite cet écueil. [5] Comment imaginer que Lehman ne connaisse pas le Jeanne Dielman de sa compatriote Chantal Akerman ? Mais là où l’insistance dans la fameuse scène des pommes de terre était velléitaire en forçant le contraste entre l’aura de l’actrice célèbre et la tâche ménagère ennuyeuse, on a ici une simple volonté d’exactitude des gestes et de la durée nécessaire pour les accomplir. [6] Babel utilise également ce type de contrepoint, en citant ironiquement Luis Mariano ou des extraits de western. On y trouve également quelques moments en vidéo, qui marquent le passage du temps mais qui font dériver parfois leur statut d’origine dans un sens flottant. [7] « L’effet vidéo devient, de fil en aiguille, de plus en plus opaque. Si l’apparition de sa texture signifie plus que ce que l’image décrit en soi, s’il est déjà transmis une impression ou une émotion supplémentaire, peut-être peut-il se libérer de sa stricte surdétermination télévisuelle, de contrôle ou amateur, directe ou pervertie, pour se faufiler sereinement vers d’autres possibles. (…) [C]’est justement en brouillant lesdites surdéterminations, en créant en fait un glissement permanent de l’une sur l’autre pour suspendre la moindre assurance en ce domaine, que l’effet vidéo peut s’offrir en contrepoint, et trouver sa réalisation poétique[7]. » V. Heristchi, Entre vidéo et cinéma – Neige électronique, tome 2, éd. L’Harmattan, p. 105.
INCIPIT. Sur la butte du Lion, à Waterloo, le 18 juin 1983, au sommet de l’escalier, fouetté par le vent, Boris Lehman amorce le tournage de son film Babel en s’adressant directement à la caméra. Il n’a pas vraiment préparé son propos, bafouille un peu, perd le fil. Des visiteurs exténués par la montée des marches passent derrière lui. Sa tirade, étourdie, surprenante, répond à deux exigences. Il tient, d’une part, à introduire le film en annonçant son titre, en rappelant que l’idée initiale lui est venue il y a dix ans sur ce même site. Le tournage est déjà une reprise. Il souhaite, d’autre part, mettre en branle la machine, il tient à s’assurer que la caméra tourne (ce sont d’ailleurs ses premiers mots : « ça tourne ? »), à se prouver qu’il a commencé à filmer, comme on touche du bois, par superstition, et le bruit perceptible du moteur, la présence de l’équipe, semblent le rassurer. Son discours joue le rôle d’un performatif, il réalise le film par la parole. Les conditions de félicité, nécessaires au succès de tout énoncé performatif, sont-elles au rendez-vous ? Le cinéaste ne semble pas totalement convaincu à ce sujet en affirmant, doué d’un savoir obscur quoique démenti par les faits, que Babel est voué à l’inachèvement et à l’échec. Suffit-il d’énoncer le film pour qu’il ait lieu ? À l’interface de la superstition et du performatif s’ouvre le projet Babel, œuvre-somme, au bord de l’autobiographie et du journal, qui réunit douze films de durées variables réalisés sur une période de trente-huit ans. ART POÉTIQUE. Cette séquence d’ouverture de Babel peut être interprétée comme un art poétique du cinéaste. De proche en proche, de façon pédestre, ses films se construisent sous nos yeux. On passe d’une scène à l’autre, au fil des heures. Chaque séquence, au cadrage et à la mise en scène d’une grande précision, en entraîne une autre comme une série de blocs qui s’encastrent au petit bonheur. Le film se fait en chemin, il avance en conservant les scories, les doutes, les errances. On entend la caméra, on voit les claps, les micros rentrent dans le champ. Le cinéaste ne souhaite pas effacer les marques d’énonciation. « C’est vrai que mes films ne ressemblent pas toujours à des films. Ils ont plutôt l’air de brouillons, d’esquisses de films qui resteraient à faire, de propositions où la genèse, le processus de fabrication, sont inscrits dans le film lui-même[1] ». Au-delà de leur strict caractère autobiographique, ses films témoignent d’un art plus conceptuel. Performatif, disions-nous. Le film repose sur la présence du cinéaste, visible à l’image et sur la bande sonore, à la fois personnage cocasse et artiste inquiet, qui commente et décrit le tournage et ses aléas. Il dit et répète qu’il tourne, il se confie, il émet des hypothèses. Les actes de parole, les énoncés nous rappelant qu’il s’agit bien d’un film, les situations théâtrales, les performances exhibant le corps dénudé du cinéaste, devenu bobine folle ou projecteur, enrubanné de pellicule, chevauchant une photocopieuse, crachant un film, attestent l’auto-réflexivité du dispositif. L’aventure du film et la vie du cinéaste finissent par se confondre. SOUSTRACTION. Si Lettre à mes amis restés en Belgique, premier opus du cycle Babel, s’ouvre par des énoncés performatifs pour conjurer l’aléa (« j’ai l’impression que la caméra tourne », « j’avais l’idée de me prouver que j’avais commencé à tourner ce film »), les quatre films qui forment le présent coffret ont pour vocation de conclure la geste autobiographique. Non plus s’assurer que le film aura lieu par des injonctions magiques, mais au contraire produire de l’absence, de l’intervalle, de l’espacement, pour mieux s’éclipser et disparaître. D’où la nature paradoxale d’un performatif qui ne consiste plus à réaliser le film, mais à effacer son auteur, à défaire l’œuvre, à la déréaliser. Bien sûr, le motif n’est pas totalement nouveau. La disparition est un thème fondateur du cinéma de Boris Lehman, lié à l’exil, à la recherche des origines, à la tragique dispersion familiale. Lettre à mes amis restés en Belgique est aussi le récit d’un voyage du cinéaste au Mexique sur les traces d’Artaud dont nous sont montrés uniquement les préparatifs et le retour. Mais la question se pose à nouveaux frais. Comment performer le retrait ? Comment disparaître ? C’est l’enjeu paradoxal et troublant de ces quatre films teintés de mélancolie. DISCRÉTION. Le sociologue Howard Becker distingue les professionnels intégrés (integrated professionals) qui acceptent les règles et les conventions de leur discipline des francs-tireurs (mavericks) qui refusent d’obéir à ses contraintes[2]. Si le franc-tireur, à l’inverse de l’artiste brut (outsider), a bénéficié d’une formation artistique, s’il connaît les règles de l’art, il ne se plie pas pour autant aux conventions établies, il use de procédés originaux volontiers excentriques, à l’écart des modes et des courants dominants. Boris Lehman appartient à cette catégorie. S’il fit ses études à l’INSAS à Bruxelles, s’il connaît parfaitement l’histoire du cinéma et s’entoure de techniciens professionnels, si ses films sont montrés dans des festivals internationaux, sa filmographie reste singulière, intempestive. Le cinéaste revendique volontiers un art de la discrétion. L’œuvre est à cet égard paradoxale. La volonté de son auteur de se tenir à la marge, de privilégier le cercle de ses amis proches, de s’éclipser par un jeu de pirouettes ou de disparaître, au plan social et artistique, tempère, sinon contredit, le caractère narcissique du pacte autobiographique. L’artiste apparaît et disparaît. Doit-il s’évanouir ? DE L’ACCIDENT. Si le cinéaste prédisait que le film Babel resterait inachevé, c’était par peur prochaine de l’accident, technique ou économique. Ce n’est plus le cas dans ses derniers films. L’accident a déjà eu lieu. Il est même fondateur. Le film en est l’écho ou le glas. Fantômes du passé s’ouvre sur le récit du récent infarctus du cinéaste. Funérailles ne cesse de revenir sur le déménagement de son atelier. Oublis, regrets et repentirs évoque en ouverture le vol de sa caméra en mai 2011. Autant dire qu’un accident ou un aléa est à l’origine du film et témoigne d’un contretemps, d’un obstacle, interprété par le cinéaste comme l’annonce d’une fin proche, qu’il s’agisse (les choses se confondent) de sa disparition ou de la fin de l’œuvre. Il est temps, pense-t-il, de conclure, de parachever la geste. À cet égard, Oublis, regrets et repentirs travaille dans son matériau la question de l’accident. Non seulement il s’agit de la bobine oubliée d’un autre film (elle est présentée comme le 6 bis de Mes sept lieux), mais l’enregistreur Nagra fait des siennes, ne respecte plus la vitesse et le son s’accélère. La machine se grippe. Boris commence d’ailleurs son tournage un jour de grève générale en Belgique. Sur le seuil fragile de la quasi-disparition ou de la quasi-absence, le film promis à la destruction et à l’oubli subsiste comme ruine avec ses défauts et ses lacunes. PALIMPSESTE. Boris Lehman revendique de parler avec la voix des autres. « Emprunts et citations : je suis voué à copier, à refaire ce que tout le monde a déjà fait avant moi, à piquer dans le patrimoine commun, dans le réservoir mondial des mots, des images et des idées, à palimpsester à l’infini[3]. » On peut citer les références qui apparaissent dans les quatre films de ce coffret : Charles Aznavour, Blaise Cendrars, Astolphe de Custine, Fanchon Daemers, Casimir Delavigne, l’abbé Delille, Regina Guimarães, Homère, Victor Hugo, Franz Kafka, Raoul Vaneigem, Jules Verne, Arthur Rimbaud. J’en oublie sans doute. Position délicate pour un cinéaste de l’autobiographie, très présent physiquement dans ses films, au point d’en habiter la plupart de ses plans, que de laisser parler les autres et de s’effacer. Double mouvement d’affirmation et de retrait, entre signature et anonymat. D’un côté, raconter sa vie ou la mettre en scène, se filmer sous toutes les coutures, s’interroger sur le devenir de ses films et le destin d’une œuvre volontiers impudique. De l’autre, disparaître comme auteur, citer les pensées d’autrui, laisser le film se dérouler comme un processus autonome, travailler l’accident ou la ruine. Le paradoxe est au cœur de sa filmographie. Lors d’une visite à la Cinémathèque royale de Belgique dans Oublis, regrets et repentirs, le cinéaste furète parmi les cartons abandonnés et s’emporte en qualifiant l’institution d’« entreprise de destruction des films ». La pulsion de mort semble habiter secrètement l’archive. MAL D’ARCHIVE. Boris Lehman conserve tout (un bocal de ses ongles apparaît sur une étagère de son atelier dans Fantômes du passé). Des boîtes de films, des caisses, des cartons de photographies envahissent son lieu de travail. Il compose à la photocopieuse des collages tirés de sa collection de cartes postales et de ses carnets ; ses films dressent une archive singulière de sa vie. « Par exemple, à un certain moment, je photographiais tout ce que je mangeais. J’ai gardé tous mes cheveux, mes dents, mes brouillons de lettres, les chutes de mes films, les cartons d’invitation, les enveloppes où figurait mon nom[4]. » D’où le trauma de devoir quitter son atelier où l’archive s’est déposée comme une nacre. Désir de conservation systématique, sans lacune, redoutant les trous noirs, à savoir « les jours », dit-il, « où je n’ai pas tourné et dont il ne restera aucune trace ». Pourtant cette fièvre de l’archive est contredite par les gestes de destruction qui parsèment ses derniers films. Dans Funérailles (de l’art de mourir), il filme pas à pas les différentes étapes (préparatifs, cérémonie, hommages, deuil) de ses obsèques. Sa disparition est abordée de façon concrète. Le ton du film est cocasse, drôle et distancé, quelque peu mélancolieux. On voit le cinéaste rentrer d’un long voyage comme Ulysse, trier ses vêtements, s’occuper de la façade de son atelier qu’il doit quitter, visiter un magasin funéraire pour éprouver le confort des cercueils, se prêter au lavage du corps et à la prière avant le défilé du cortège amical et mortuaire à Waterloo, l’ensevelissement dans la terre et les discours de consolation. En toute fin, devant des piles de boîtes de films dans son atelier qui forment une tour de Babel, il confie à la caméra : « Eh bien voilà. C’est la fin. C’est la dernière fois que je me filme, que j’apparais à l’écran. C’est la dernière fois que vous me voyez. Je me retire, je m’efface, je disparais. » Performatif contrarié. Funérailles (de l’art de mourir) révèle la profonde ambivalence de la relation entre conservation et destruction. On en trouve une trouble allégorie dans la séquence du rêve de Kafka où le cinéaste filme un autodafé des livres de l’écrivain, illustrant le souhait exprimé par celui-ci dans sa lettre à son ami Max Brod. À l’exception de quelques titres, dit Kafka, tous ses manuscrits, sans exception, doivent être brûlés. Le cinéaste dispose les livres en tas et allume un brasier. Si la séquence peut sembler une illustration littérale du vœu de l’écrivain, l’autodafé ne laisse pas d’emporter un goût amer. Peu après, le cinéaste brûle ses propres vêtements et ses films, jetés dans le sable depuis le toit d’un blockhaus. Difficile de ne pas interpréter ces autodafés comme un rappel des épisodes les plus tragiques de l’histoire mais aussi comme la difficulté pour l’artiste d’anticiper sa propre postérité. Le rôle des livres dans ses films participe d’une même ambiguïté, à la manière d’une vanité. Ce sont à la fois des objets vénérés, sacrés, parfois religieux, auxquels on se réfère pour leur autorité. On lit beaucoup dans ses films (la Torah, Kant, Tintin). Mais le livre est aussi souvent maltraité : porté en piles croulantes dans le film attachant, au ton burlesque, Histoire d’un déménagement (1967), déchiré de façon rageuse par Romain dans Symphonie (1979), jeté en l’air dans Mes entretiens filmés (2016) ou le facétieux Combat des mots (co-réalisé avec David Legrand, 2023). CORPS-PELLICULE. Boris Lehman n’hésite pas à se dénuder dans ses films, transgressant le seuil de l’intime. Nombreuses sont les scènes de déshabillage, de bain, de massage, qui montrent son corps soumis aux caprices du temps, voûté et fripé, quoique leste. Je pense à la toilette rituelle dans Funérailles, où Boris, allongé comme un gisant, est lavé soigneusement d’une éponge, recouvert ensuite d’un linceul blanc (une main d’enfant glisse dans sa bouche trois petits galets), ou à celle d’Une histoire de cheveux, le corps fouetté d’une branche de pin, près d’une citerne, avant la séance de massage. Il ne s’agit pas seulement de réfléchir à la fin et à la postérité d’une œuvre, mais d’envisager sa propre finitude. La vieillesse est le sujet de ces films. Ce lien entre l’œuvre et la vie emprunte la figure du corps-pellicule. On peut déjà noter la présence insistante des boîtes de films qui encombrent son atelier. La pellicule est présente physiquement, comme un élément de décor familier ou un outil de travail. Mais la proximité entre le film et le corps est plus curieuse encore. Dans l’un de ses précédents opus, Histoire de mes cheveux (2010), il compare la pellicule aux cheveux, c’est-à-dire à une matière organique. « Elle est comme un être vivant, elle s’enroule, se déroule et s’emmêle. On en fait des tresses et des nœuds. Elle est solide et en même temps extrêmement fragile. » On sait que la pellicule argentique est composée de gélatine d’origine animale à partir de la peau ou des os. Le cinéaste finit par s’enrubanner de la tête aux pieds d’un film 16 mm qui forme une seconde peau. Les cercles de celluloïd autour de son corps anticipent la scène de la prière dans Une histoire de cheveux, le bras gauche cerclé de phylactères où sont écrits des versets de la Torah. Dans Fantômes du passé émerge de sa bouche un ruban de film qui semble sans fin. On pense à la clé extraite des lèvres de la rêveuse dans Meshes of the Afternoon (Maya Deren et Alexander Hammid, 1943) ou au collier de pierreries avalé par le magicien Shiva dans Inauguration of the Pleasure Dome (Kenneth Anger, 1954), rappelant le scarabée égyptien lové dans la bouche des défunts. Le cinéaste avale le film, littéralement. Est-il d’une douceur de miel, comme le rouleau d’Ézéchiel ? PRIÈRE. Tourné en 2009, monté en 2020, Une histoire de cheveux répond au film précédent, Histoire de mes cheveux, qui retraçait le voyage du cinéaste en quête de trace familiale en Pologne, à Odessa, puis au camp de concentration des îles Solovki en Russie. Une histoire de cheveux en prolonge l’arabesque par un long voyage en Sibérie. Si le motif exact du voyage n’est révélé que tardivement — visiter Birobidjan, enclave autonome juive, lieu de déportation volontaire, où se sont établis les grands-parents du cinéaste dans les années 1920, venus d’Ukraine et de Biélorussie —, le ressort du film semble lointain et obscur. « Me perdre définitivement », dit le cinéaste, reconnaissant lui-même que la trajectoire de son œuvre peut sembler tortueuse. « En cours de toute, j’ai peut-être aussi perdu mon film ». On peine à élucider la conjonction des motifs. S’agit-il d’un simple journal de voyage, marqué par les étapes, les difficultés, les accidents (la crevaison d’un pneu, la chute dans la neige, le bandage de fortune d’une main), les rencontres ? Mais quel en est l’enjeu exact ? S’agit-il d’une méditation sur la vieillesse ? On suit le périple d’un vieil homme au fil d’un voyage difficile, aride, silhouette solitaire parmi des paysages enneigés. S’agit-il d’un film sur la blancheur ? On est frappé par le caractère minimaliste du cadre qui s’attache à montrer des surfaces enneigées, des routes invisibles, des lacs gelés (le cinéaste aime à s’allonger dans la glace, à plat ventre, comme une boussole perplexe). « J’allais n’importe où, dans le blanc, dans l’infini, sans savoir où j’allais. » Curieusement, le ton devient plus animé avec l’arrivée du transsibérien à Birobidjan et la rencontre avec la communauté juive. Boris filme la lecture de la Torah. Au cours de la séquence de la prière, le bras gauche cerclé de phylactères, revêtu du châle à bandes noires, il récite les phrases que lui souffle le rabbin. Il se souvient : « Cette prière que je récitais à ma bar-mitzvah quand j’avais treize ans m’est revenue instantanément, comme si elle ne m’avait jamais quitté. » Sa relation avec la culture juive semble soudain pacifiée alors qu’elle se révélait plus trouble dans ses films précédents. Je pense à Muet comme une carpe ou À la recherche du lieu de ma naissance qui montrent le repas de la carpe ou une circoncision avec un sentiment d’étrangeté déconcertant, entre fascination et rejet. Le film semble conclure le cycle Babel avec apaisement. La blancheur est-elle perçue comme une délivrance ? POST-SCRIPTUM. On se souvient du texte d’Eisenstein, « P.S., P.S., P.S. », rédigé à la suite de son infarctus en 1946 : « Tout ce qui se passe maintenant est déjà un post-scriptum à ma propre biographie[5]. » Fantômes du passé a le ton, lui aussi, d’un post-scriptum. La promenade dans les archives annoncée au début du film prend une couleur plus inquiète à la suite d’une attaque cardiaque. Le cinéaste essaie de se remémorer des souvenirs oubliés. Et ce sont des fantômes qui lui apparaissent. « Les fantômes », dit-il, « ce sont les choses, les lieux et les personnes que j’ai filmées et qui ont disparu, qui n’ont pas laissé de traces. » L’effort de remembrance s’accomplit ici avec une complice, Sarah Moon Howe, co-réalisatrice, figure d’Ariane dans le labyrinthe de la mémoire. La tâche est délicate. « Je ne veux pas me retourner. Je ne veux pas regarder en arrière. » Paradoxe. Le film suit des pistes successives : jeux de masques, cartes divinatoires, chansons de plein air. Chemin étoilé, décousu, impromptu, en zigzag. Les fantômes ne veulent pas venir, semble-t-il. Mais n’est-ce pas le film lui-même qui se refuse ? On lance, on relance la toupie à plusieurs reprises. Au cours d’une très belle séquence, à la table de montage, Boris et Ariane visionnent des extraits de ses films anciens. On y découvre les visages de ses amis, souriants, complices, timides, parfois bavards, le regard souvent adressé à la caméra ou au cinéaste qui se tient à ses côtés. Esprit du cinéma de Boris, délicat, attentif, précis. Les fantômes sont-ils venus ? À l’énumération de différents prénoms par le cinéaste sur certaines images, on devine que l’absence affleure. « Plein de morts dans ces images », constate-t-il. Le trouble traverse le film, comme une flèche du temps, comme une sidération, comme la lézarde apparue sur le mur de son atelier. Comment conclure ? Si Funérailles et Une histoire de cheveux relèvent du projet Babel de façon concertée, au bord de la fiction, Oublis et Fantômes en sont plutôt des suppléments ou des post-scriptum, même si l’auteur s’en défend. On se souvient que le cinéaste, au sommet de la butte du Lion, tenait à nous informer que l’idée de Babel lui était venue dix ans plus tôt, sur ce même lieu, nous invitant à considérer, dès le départ, le projet comme un post-scriptum. L’œuvre n’en finit pas de se commenter et de se redire, multipliant les strates et les rajouts, les rimes et les digressions, exauçant peut-être la crainte (ou le vœu) d’un inachèvement originel. Erik Bullot [1] Boris Lehman, « Être quelqu’un ou n’être rien (confessions) », Trafic, n°79, p. 29. [2] Howard S. Becker, Les Mondes de l’art, trad. Jeanne Bouniort, Paris, Flammarion, 2010, p. 235-275. [3] Boris Lehman, « Être quelqu’un ou n’être rien (confessions) », op. cit., p. 25. [4] Boris Lehman, « La fin de mon — du — cinéma. Confessions, 2 », Trafic, n°98, p. 59.
Bruxelles revisited, septembre 2024 Lettre à un ami resté en Belgique « Le script, c’est le mal absolu », disait un de tes frères en cinéma, Jonas Mekas. David Perlov a répété ce credo avec d’autres mots et l’a mis en œuvre lui aussi. J’ai reçu cette photo prise par toi – une des rares photos où nous apparaissons tous les deux, Valérie Vouchka Barranger et moi – peut-être parce que j’ai craint les images toute ma vie, en même temps que je chérissais la nostalgie, le souvenir, les instants de bonheur tel que celui qui rayonne sur cette photo, sur laquelle se dessine un troisième sourire qui illumine les deux visages, le sourire de l’ami qui prenait la photo. Lieu de la photographie : hall de départ de la gare Cornavin de Genève, date : hiver 2019. Vingt ans plus tôt, à l’été 1999, j’arrivais à Bruxelles – en éclaireur, comme toujours –, en provenance de cette gare, dans la commune de Saint-Gilles, non loin du Parvis Saint-Gilles et de la Place Stéphanie, rue Berkmans, au numéro 56. Peu après mon arrivée, en me promenant un dimanche sur l’avenue de la Toison d’or, je m’arrêtai dans une galerie, où je découvris le livre de Boris Lehman, Lettre à mes amis restés en Belgique. De Boris, j’avais entendu parler depuis mes premières visites à Bruxelles, en 1976, quand je venais à la rencontre de William Cliff, que Raymond Queneau m’avait fait connaître en m’offrant un exemplaire du Cahier de Poésie dans lequel il avait fait publier Homo sum, le premier recueil du poète belge. En le lisant, j’eus une révélation poétique : enfin, une poésie qui se nourrissait du monde réel et non de mots inertes. C’est ce même sentiment que j’eus en découvrant le cinéma de Boris Lehman, de Chantal Akerman, de Samy Szlygerbaum : trois enfants terribles qui formaient ce que j’appellerais la Nouvelle Vague de Bruxelles, auquel j’adjoindrais plus tard le pionnier de Hal, Edmond Bernhard. J’avais attendu plus de vingt ans avant d’aller à la rencontre du piéton de Bruxelles, silhouette aimable et attachante d’un personnage du cinéma muet coiffée d’une casquette, sacoche et caméra en bandoulière. Souvent, je m’étais posé la question : « Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? » Pendant ces années, j’étais allé voir Chantal, Samy… Je me reconnus sur le coup, à peine me fus-je plongé dans les images et les mots de ces individualistes forcenés ; leur cinéma était projeté dans les salles et la première fois que je vis Boris, ce fut sur un écran de cinéma, dans le film Bruxelles-Transit de Samy, tourné en yiddish à la fin des années 1970, dans lequel il incarnait un immigré juif pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui faisait son petit commerce dans l’attente d’obtenir un visa pour l’Amérique. Les longs plans de la gare du Midi en noir et blanc, les doux visages du couple Hélène Lapiower/Boris Lehman s’imprimèrent en moi comme une image de mon passé. « Pourquoi avoir attendu toutes ces années pour cette rencontre ? » Peut-être étais-je retenu par la peur de ce que je pressentais être une forme d’art « radical », de me retrouver spectateur de zones inexplorées de mon histoire, qui se dévoilait dans la sienne… rester dans l’ignorance, préserver le mystère parfois est une bénédiction. Plus de vingt ans avaient passé. Nous nous vîmes dans le café portugais du bas Ixelles, où il avait ses habitudes ; quelques mots suffirent pour que nous comprissions ce que nous avions à nous dire. Quelque vingt années passèrent encore. Nous nous voyions à Bruxelles, puis, au fil des déménagements et au hasard des projections des films, à Bruges, à Lausanne, à Verbier, à Genève, parfois à Paris. Un matin de la fin de l’été 2024, j’appelai Boris, qui me répondit comme à l’accoutumée d’une voix lasse : « C’est encore toi ? Qu’est-ce que tu veux ? Tu as de la chance que je sois encore réveillé à cette heure de la nuit… Et cet entretien, tu y penses toujours ? Je viens de fêter mes quatre-vingts ans, n’oublie pas… je ne suis pas éternel… » « Nous sommes tous éternels, eus-je envie de répondre », mais je me retins. À quoi bon la provocation… « Tu veux qu’on se voie ? Je suis là, tu n’as qu’à venir… Mais il faudrait quand même que tu voies quelques-uns de mes films avant qu’on commence cet entretien… » Quelques jours plus tard, le mardi 17 septembre 2024 (j’aime ces dates, ces noms de jours et de mois), j’atterrissais à l’aéroport de Brussel-Zaventem, dans le Brabant flamand. À bord du train pour Brussel Centraal, dont le nom résonnait toujours poétiquement en moi dans l’antique idiome néerlandais, mes émotions se réveillèrent quand j’entendis parler la langue locale du pays. Ma passion pour les parlers de la Flandre intriguait et irritait inlassablement mes amis francophones belges, qui me mettaient volontiers à l’épreuve. « Parle un peu avec la serveuse ? » me défiait en public Boris quand nous nous trouvions sur la côte belge au bord de la mer à manger des gaufres. Et quand la charmante Ostendaise me répondait dans sa langue avec un sourire en s’excusant de s’être adressée à moi en français, Boris jaloux commentait : « Elle n’a rien compris de ce que tu lui as dit, elle veut te faire plaisir ! » Boris m’attendait place de l’Europe, à la sortie de la gare, en surplomb de la galerie de la Reine. Il me regarda avec un air indulgent, quasi compatissant : « Alors tu es venu, finalement ? Tu es quand même incroyable ! » Nous nous sommes dirigés vers mon hôtel rue Royale. J’avais d’abord réservé dans un hôtel de la porte de Namur, La Troupe Le Berger, avant de me raviser en lisant de plus près la présentation de cet hôtel sur leur site : « Les chambres de l’hôtel Le Berger, une des plus anciennes et des plus réputées maisons de rendez-vous de Bruxelles, vous transporteront dans un monde secret et clandestin où se rencontrent les amoureux du passé. Ses chambres au décor intime et sensuel donnent à ce lieu magique une atmosphère sexy. » J’avais craint de me retrouver dans une ambiance trouble et j’avais changé pour un hôtel plus conventionnel, moins flatteur pour l’éveil des sens. « C’est dommage, me dit Boris, c’est un hôtel fréquenté par les artistes, j’y suis allé souvent pour rencontrer des gens, ils ont un petit déjeuner fabuleux et il y a un tram direct de chez moi. Mais non, toi évidemment, les artistes, ça te fait fuir… il te faut un hôtel anonyme, pour businessmen… » À l’hôtel, le réceptionniste bruxellois conversait avec une parfaite aisance avec les hôtes en anglais, français et néerlandais. Et, discrètement, avec sa collègue, en arabe dialectal. J’avais demandé une chambre au dernier étage. La vue s’étendait sur toute la ville. Il pleuvait, un temps qui sied à Bruxelles. Il y avait une table et deux chaises, une bouilloire avec des tasses. Nous nous fîmes du thé et commençâmes notre entretien. « Bon, ce soir, nous allons dîner chez Karine de Villers, elle habite avenue du général Médecin Derache maintenant, c’est dans Ixelles. — C’est près de chez toi ? — Non, moi j’habite le bas Ixelles, où on va, c’est dans le haut Ixelles, près du bois de la Cambre ! C’est assez loin d’ici, mais c’est ton choix de séjourner dans le Pentagone ! » Ce surnom donné au centre de Bruxelles m’avait intrigué quand je l’entendis pour la première fois mais j’avais constaté, comme toujours, que les noms de rues et de quartiers à Bruxelles correspondaient à ce qu’ils énonçaient, rue de l’Escalier il y avait un escalier, rue du Puits on trouvait un puits, rue du Pré… il n’y avait pas de place pour la métaphore, la coupe de la poésie était remplie à ras bord par le réel, par la vérité. Seuls les noms de rues hérités de la Révolution – rue de l’Égalité, rue de la Fraternité, etc., empruntaient un air à la métaphore, mais ne réussissaient pas à accéder totalement à l’illusion métaphysique de l’abstraction. La Belgique avait quelque chose d’incorruptible dans sa fidélité au réel, c’est-à-dire à l’humain. Les noms des destinations sur les trams vibraient de leur évocation d’un paysage, d’un évènement historique, d’un personnage… *Karine vit entre Bruxelles et Rome, avec son compagnon le cinéaste vénitien Mario Brenta. Elle a préparé un repas oriental à base de semoule, houmous, aubergines, pois chiches. On ne s’était plus vus depuis la projection du film de Boris à Lausanne, À la recherche du lieu de ma naissance, quinze ans plus tôt, dans l’une des salles de l’unité cinématographique de l’université, à Dorigny. Après le film, nous avions pris un goûter sur l’herbe du campus, par une belle journée de printemps. À cette époque, elle m’avait rendu visite à Venise, dans le sestier Dorsoduro, lors d’un dernier déménagement. Par la fenêtre, on voyait la pancarte de l’embarcadère San Samuele. « Tu as le don des lieux », m’avait-elle dit d’une voix inquiète. Elle repartait le lendemain pour Rome, où elle travaillait à un film avec Mario. « C’est important que tu rencontres mes amis », m’avait dit Boris. Je m’aperçus que ce qui me retint pendant si longtemps d’aller à sa rencontre, c’était ce pluriel du mot « ami » dont je pressentais l’existence, une appartenance à un collectif. J’avais le culte de l’amitié et pour moi chaque amitié était unique, irremplaçable et totalement individualiste. J’avais vu des photos de Boris figurant dans un groupe d’amis et j’avais éprouvé la même terreur que lorsque je devais poser, enfant, pour une photo de famille ou de classe. *Le lendemain matin, je voulus revoir Manuela, l’amie libraire de Tropismes, galerie de la Reine. Nous nous sommes donnés rendez-vous au Mokafé, lieu historique du centre de Bruxelles. Ben, le gérant de plusieurs décennies, n’est plus là. Je demande un café filtre. Le serveur me demande d’un air compatissant : « Vous n’êtes plus venu à Bruxelles depuis combien d’années, Monsieur ? Le café filtre n’existe plus ! » Manuela arrive souriante, d’un pas sautillant et un instant, je me serais cru protagoniste d’une scène d’une comédie musicale. J’aurais pu l’accueillir en chantant. Elle m’apporte un cadeau, deux livres : Bibliuguiansie ou l’effacement de la lexicographie (Riga, 1941) de Nicolas Auzanneau et Ne vous inquiétez plus, c’est la guerre, recueil de proses du poète Daniel Fano. Daniel fut le compagnon de sa sœur Graziella, autre libraire de Tropismes, pendant de longues années. « Daniel était très ami de Boris Lehman, me dit-elle. Quant à ce livre d’Auzanneau, te connaissant, j’ai pensé qu’il t’intéresserait… »
Conserver ou détruire
|